L'intégration ne s'arrête pas à l'entrée en lice.
Nous sommes confrontés à une phase d'intégration très différente de celle d'il y a 10 ans. Le monde ne fonctionne plus selon une logique linéaire, mais met en place un ordre multicouche et multinormatif, où les principaux pays rivalisent pour établir et imposer de nouveaux ensembles de normes : normes carbone, normes technologiques, normes de données et même normes éthiques pour l'intelligence artificielle (IA).

Au vu de la situation mondiale, les principales tendances qui affectent directement le Vietnam aujourd'hui sont les suivantes : la transformation des chaînes d'approvisionnement, non seulement pour des raisons de coûts, mais aussi de sécurité, de valeur et de normes environnementales ; la concurrence dans les normes technologiques, notamment en matière d'IA, de données transfrontalières et de cybersécurité ; l'élargissement de l'espace stratégique aux domaines de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire et la formation de blocs de normes hautement contraignants, obligeant les économies en développement à s'adapter très rapidement.
Dans ce contexte, l’intégration du Vietnam ne peut se limiter à une simple participation aux enjeux internationaux ; elle doit lui permettre de définir son rôle et de contribuer activement à l’élaboration des règles du jeu. Il s’agit d’un changement qualitatif dans la conception de l’intégration, et la résolution de l’Assemblée nationale relative à un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques visant à améliorer l’efficacité de l’intégration internationale doit devenir un outil pour opérer cette transformation.
En conséquence, la résolution doit se concentrer sur trois axes stratégiques, qui correspondent également aux trois principaux défis auxquels le Vietnam est confronté : la capacité à anticiper et à planifier les stratégies nationales ; les obstacles juridiques à l’intégration ; et les ressources humaines en matière de politique étrangère – un facteur déterminant pour la réussite ou l’échec.

Il n'existe pas encore d'écosystème de prévision stratégique robuste.
Dans le contexte de la compétition entre grandes puissances, des changements technologiques rapides et des fluctuations politiques imprévisibles mentionnés ci-dessus, la capacité de prévision stratégique devient un atout stratégique, au même titre que les ressources ou le capital d'investissement.
Actuellement, le rapport du gouvernement mentionne ce contenu, mais à mon avis, il subsiste encore 3 lacunes importantes.
Premièrement , le Vietnam ne dispose pas d'un système de prévision stratégique performant. Les ministères réalisent leurs propres analyses, mais il leur manque un mécanisme intégré pour dresser un tableau national. Par conséquent, nous sommes parfois passifs face aux chocs externes, tels que les normes carbone, les politiques relatives aux nouvelles technologies ou la restructuration des chaînes d'approvisionnement.
Deuxièmement , nous manquons de véritables centres de réflexion stratégique nationaux. Je ne fais pas référence aux pays développés comme les États-Unis ou le Canada, mais si l'on considère la région aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle équivalent au KDI ( Korea Development Institute ) en Corée ou à la Lee Kuan Yew School of Public Policy à Singapour, où la réflexion stratégique et les recommandations politiques sont élaborées au niveau national.
Troisièmement, nous manquons d'un mécanisme permettant de mobiliser les intellectuels et les experts indépendants étrangers. Il s'agit d'une ressource considérable, mais le cadre juridique actuel ne suffit pas à exploiter ce potentiel de manière régulière, systématique et efficace.
Sans prévisions stratégiques, nous ne pouvons pas intégrer de manière proactive, mais un seul pas en arrière peut entraîner la perte de toute une génération d'opportunités.
Par conséquent, je recommande la mise en place d'un réseau national de prévision stratégique, doté d'un groupe de travail stable et pérenne, appliquant de manière sélective les normes internationales d'analyse des risques avec des échéanciers et un suivi clairs, et expérimentant un mécanisme permettant d'inviter des experts indépendants à mettre en œuvre les politiques.
Dans cet axe , à mon avis, le rôle de l'Assemblée nationale est d'harmoniser la vision, d'exiger des comptes et de contrôler la qualité des prévisions afin qu'elles constituent le fondement de l'élaboration des politiques nationales.
La résolution doit témoigner d'une vision stratégique, d'une détermination et d'une intelligence nationale, non seulement pour lever certains obstacles, mais aussi pour jeter les bases d'une intégration proactive, en servant de modèle et en définissant les normes. Dans ce cadre, la capacité de prévision stratégique est essentielle, la réforme du droit international est l'outil et les ressources humaines en matière de politique étrangère sont la condition déterminante.
Le champ d'application des projets stratégiques est trop vaste.
Le deuxième axe concerne la réforme du droit international afin de remédier aux obstacles et de ne pas être laissés pour compte dans la compétition mondiale.
On constate que l’intégration internationale progresse très rapidement, mais que les législations nationales ne peuvent suivre le rythme, comme en témoignent la longueur des procédures, la lenteur de la mise à jour des lois et les chevauchements entre les législations nationales et les engagements internationaux.
Le projet de résolution propose un mécanisme pour traiter les difficultés liées à l'article 8, mais à mon avis, trois points doivent être clarifiés.
Premièrement , la portée des projets stratégiques actuels est encore trop vaste. Si elle n'est pas réduite, le mécanisme spécifique risque de devenir un détour institutionnel et d'aller à l'encontre de l'esprit de la réforme.
Deuxièmement, la période pilote, qui court jusqu'en 2030, est trop longue. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a également demandé de la réduire à 2027 afin de garantir le contrôle du pouvoir et la sécurité des institutions.
Troisièmement, la frontière entre flexibilité et violation de l'état de droit est floue. Il faut faire preuve de flexibilité pour saisir les opportunités, mais il est absolument impératif de ne pas outrepasser le cadre établi par l'Assemblée nationale.
L’objectif de ce mécanisme spécial n’est pas d’ouvrir un cadre général, mais de préparer le terrain. C’est pourquoi je propose que le projet de résolution restreigne l’article 8 aux seuls projets liés aux partenaires stratégiques, à la sécurité et à la défense nationales, ou susceptibles d’entraîner la perte d’opportunités majeures en cas de retard ; que la phase pilote soit limitée à 2027 ; que l’agence de l’Assemblée nationale ne soit pas intégrée au conseil d’évaluation afin de garantir l’indépendance du contrôle ; et que le gouvernement soit tenu de justifier auprès de l’Assemblée nationale chaque cas d’application de ce mécanisme spécial.
Sur le deuxième axe, à mon avis, le rôle de l'Assemblée nationale est d'établir un cadre juridique, de superviser, de contrôler les risques, de protéger l'état de droit et de ne pas empiéter sur le pouvoir exécutif.

Trois axes pour le développement des ressources humaines en affaires étrangères
Le troisième axe concerne les ressources humaines en matière de politique étrangère ; c’est le pilier qui détermine la réussite ou l’échec de l’intégration internationale. Si je devais choisir un facteur déterminant pour le succès de l’intégration du Vietnam au cours des dix prochaines années, ce serait, à mon avis, non pas le capital ou la technologie, mais les personnes, et plus particulièrement les ressources humaines travaillant dans les domaines de la politique étrangère, du droit international et de la prospective stratégique.
Nous manquons cruellement d'experts en droit international, d'experts en traités, d'experts en prévision stratégique, de personnel maîtrisant des langues étrangères rares, de ressources humaines spécialisées dans les technologies et de données pour assurer l'intégration numérique.
Le rapport a exposé de nombreuses politiques importantes, mais à mon avis, trois axes doivent être mis en avant.
La première priorité est de développer les ressources humaines en droit international – pilier de la protection de la souveraineté juridique. Ce groupe est essentiel, mais il fait actuellement cruellement défaut et aucun programme de développement à long terme n'est prévu.
La seconde orientation concerne la politique relative aux langues étrangères rares, qui doit impérativement reposer sur des critères clairs. La résolution proposant un niveau de soutien de 300 % constitue un progrès important, mais mérite d'être examinée avec attention ; les critères d'évaluation doivent se fonder sur la capacité d'utilisation dans la fonction publique, et non uniquement sur les qualifications.
Le troisième axe consiste à mettre en place un écosystème de formation des ressources humaines pour l'intégration internationale. Un programme de 5 à 10 ans est nécessaire, en partenariat avec des centres stratégiques de premier plan, assorti d'un mécanisme de détachement de cadres pour des études de longue durée.
Dans cet axe, l'Assemblée nationale jouera le rôle de chef d'orchestre institutionnel, en décidant du cadre stratégique des postes, en supervisant la politique d'incitation et en exigeant des rapports annuels sur le développement intégré des ressources humaines.
À mon avis, la résolution doit témoigner d'une vision stratégique, d'une détermination et d'une intelligence nationale, non seulement pour lever certains obstacles, mais aussi pour jeter les bases d'une intégration proactive, en servant de modèle et en définissant les normes. Dans ce cadre, la capacité de prévision stratégique est essentielle, la réforme du droit international est l'outil et les ressources humaines en matière de politique étrangère sont la condition déterminante.
Et à ces points clés, l'Assemblée nationale doit démontrer son rôle dans l'orientation stratégique, en établissant un cadre institutionnel et une supervision indépendante, mais sans outrepasser son rôle ni empiéter sur les prérogatives de l'État, mais en maintenant sa place légitime d'institution législative suprême afin de garantir que tous les mécanismes spécifiques fonctionnent dans un cadre légal, au bénéfice de la nation et du peuple.
Une résolution forte ne réside pas dans le nombre de mécanismes que nous mettons en place, mais dans la manière dont nous construisons un cadre institutionnel suffisamment fiable, sûr et courageux pour soutenir l'intégration sans sacrifier la sécurité nationale.
Source : https://daibieunhandan.vn/pho-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-le-thu-ha-khong-co-du-bao-chien-luoc-thi-khong-the-hoi-nhap-chu-dong-10396217.html





![[Photo] Lam Dong : Vue panoramique de la cascade de Lien Khuong qui déferle comme jamais auparavant](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat de la République tchèque, Miloš Vystrčil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)
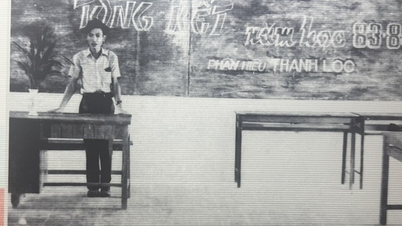







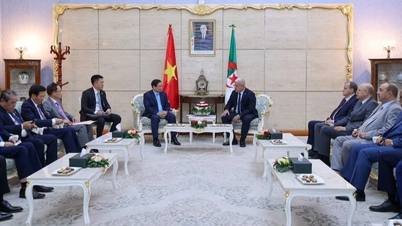




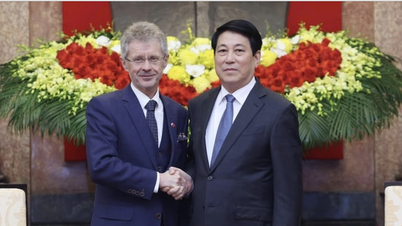



















































































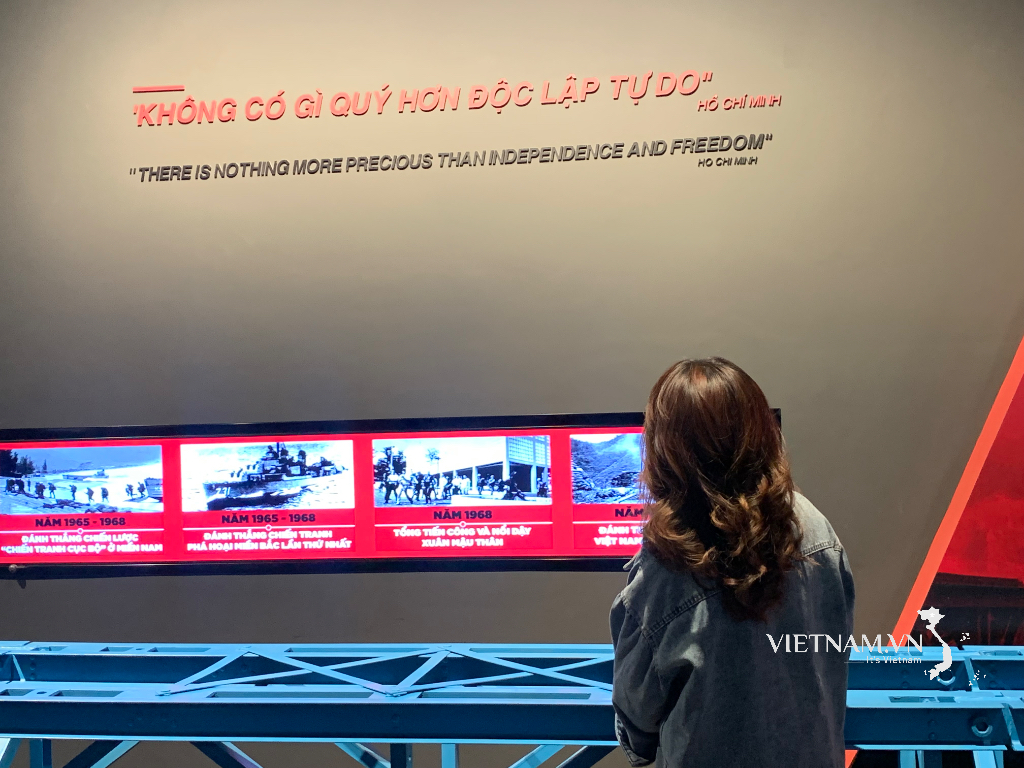



Comment (0)