Leçon 4 : Modèle de référence pour le Vietnam
En Asie, les croissances fulgurantes du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour et l'essor remarquable de la Chine partagent un point commun essentiel : une stratégie gouvernementale pertinente et efficace visant à autonomiser, soutenir et créer un environnement propice au développement des entreprises privées. Les modèles asiatiques qui ont fait leurs preuves peuvent servir de référence au Vietnam dans sa démarche de développement de secteurs s'appuyant sur la force du secteur privé.
Japon : La puissance du keiretsu
Dans l'histoire du développement économique privé en Asie, il est impossible de ne pas mentionner le modèle qui a permis le « miracle économique » japonais après la Seconde Guerre mondiale. Ce modèle reposait sur des alliances d'entreprises multisectorielles : les keiretsu. La stratégie japonaise de l'époque visait à faire des entreprises privées la pierre angulaire de l'économie grâce à une combinaison étroite de soutien financier et de politique industrielle étatique.
La force de ce modèle réside dans son système financier unique : chaque keiretsu s’articule généralement autour d’une banque centrale, lui assurant un accès stable au crédit à long terme. Autre caractéristique : les participations croisées, c’est-à-dire que les entreprises d’une même alliance détiennent des parts les unes dans les autres, créant ainsi un réseau très soudé. De plus, les keiretsu s’appuient sur un système de sous-traitance à plusieurs niveaux, comprenant des centaines de milliers de PME, formant une pyramide industrielle à la fois profonde et très autonome.

Le rôle du gouvernement japonais, principalement par le biais du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (MITI), consistait à orienter les industries prioritaires et à coordonner avec le système bancaire l'apport de capitaux. Par exemple, dans les années 1950 et 1960, le MITI a incité les banques à octroyer des crédits à long terme aux industries automobile et électronique, tout en érigeant des barrières à l'importation pour protéger ces deux secteurs. De ce fait, dès les années 1970, le Japon a rapidement vu ses constructeurs automobiles (tels que Toyota, Nissan et Honda) et ses entreprises d'électronique (telles que Sony, Panasonic et Hitachi) s'imposer sur la scène internationale .
On peut affirmer que cette étroite coordination entre le gouvernement et le secteur privé a été la clé du « miracle économique japonais » après 1945. Le taux de croissance élevé qui a duré 20 ans (1950-1970) a permis au Japon de sortir des « cendres de la guerre » pour devenir la deuxième économie mondiale.
Cependant, le modèle même qui a engendré ce « miracle » a révélé ses limites face à l'évolution du contexte économique mondial. L'intégration étroite et la structure complexe des keiretsu ont réduit leur flexibilité, les rendant lents à s'adapter à la révolution numérique. Ce facteur a contribué à la « décennie perdue » de croissance stagnante au Japon. Néanmoins, le keiretsu demeure un modèle classique de développement économique privé, riche d'enseignements. Et nombre de « géants » issus de ce modèle constituent encore aujourd'hui des piliers du secteur privé japonais, tels que Toyota ou Sony.
Corée du Sud : Les chaebols nouent des partenariats stratégiques avec l'État

S’inspirant de l’expérience japonaise, la Corée du Sud a adopté un modèle plus offensif pour bâtir des chaebols, conglomérats familiaux multisectoriels. Dans ce modèle, l’État sélectionnait et accompagnait directement des entreprises privées prometteuses telles que Samsung, Hyundai et LG, les transformant en puissants chaebols. Ces entreprises bénéficiaient ensuite d’un soutien massif grâce à des dispositifs comme des crédits préférentiels à taux réduit accordés par les banques publiques, des allégements fiscaux sur les sociétés, des devises étrangères pour l’importation de machines et la protection du marché intérieur. En contrepartie, l’État imposait aux chaebols d’atteindre des objectifs d’exportation précis en termes de production et de chiffre d’affaires.
Ainsi, une relation étroite s'est tissée entre le gouvernement et les chaebols : l'État considérait la réussite des chaebols comme celle de la nation, et les chaebols dépendaient du soutien de l'État pour se développer. Grâce à cette stratégie, la Corée du Sud a bâti, en seulement deux décennies, des industries clés telles que la construction navale, l'automobile et l'électronique grand public. Actuellement, le secteur privé contribue à plus de 70 % du PIB sud-coréen, avec 6,7 millions d'entreprises. Parmi celles-ci, Samsung est en tête, contribuant à près de 20 % du chiffre d'affaires à l'exportation. Selon Bloomberg, en mai 2024, les cinq plus grands chaebols représentaient plus de 52 % du chiffre d'affaires des 82 principales entreprises du pays.
Ce modèle a toutefois révélé les inconvénients d'une concentration économique excessive : le risque de corruption et de manipulation des politiques publiques lié à l'expansion des chaebols. La crise financière asiatique de 1997 a contraint la Corée du Sud à entreprendre des réformes, obligeant les chaebols à améliorer la transparence financière et à renforcer leur soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) afin de rétablir l'équilibre économique.
Singapour : L'environnement le plus favorable
Contrairement aux modèles coréen et japonais, qui privilégient la formation de quelques « aigles », Singapour a choisi de créer l'un des environnements commerciaux les plus favorables au monde pour attirer et développer tous les types d'entreprises.
Le gouvernement a mis en place un système juridique transparent, réduisant les procédures administratives et garantissant une concurrence loyale. Les entreprises peuvent s'immatriculer en une seule journée, tandis que le taux d'imposition des sociétés, à 17 %, est considéré comme l'un des plus bas de la région, favorisant ainsi les investissements et le développement des jeunes entreprises.

Le gouvernement singapourien joue un rôle proactif dans le soutien aux PME. Des programmes de subventions, des fonds d'aide à l'innovation et des prêts à taux préférentiels sont conçus pour faciliter l'accès au capital aux jeunes entreprises. Des initiatives telles qu'Enterprise Singapore et le Fonds de développement des entreprises ont permis à de nombreuses sociétés privées de surmonter les difficultés initiales. Le gouvernement s'attache également à améliorer la productivité du travail grâce à des programmes de formation professionnelle. Par ailleurs, grâce à une forte orientation vers l'innovation et l'application des technologies, le pays a développé un écosystème de startups dynamique, attirant de nombreux fonds de capital-risque et des entreprises technologiques de premier plan à l'échelle mondiale.
L’approche de Singapour montre que le rôle d’un « État facilitateur » n’est pas seulement de soutenir quelques grandes entreprises, mais aussi de créer des conditions équitables et un écosystème fertile permettant à toutes les entreprises de se développer.
Chine : Du contrôle à la création dirigée
Depuis le milieu des années 1980, la Chine « libère » le secteur privé. Sa stratégie générale consiste à conjuguer puissance de marché et orientation stratégique de l’État : ce dernier crée un environnement et des politiques favorables au développement du secteur privé, tout en coordonnant d’importantes ressources et en intervenant, le cas échéant, pour garantir la stabilité macroéconomique et la sécurité économique.

La Chine combine de nombreux mécanismes pour soutenir les entreprises privées. Premièrement, les pouvoirs publics, à tous les niveaux, appliquent souvent des politiques préférentielles (fiscalité, foncier, crédit) aux PME, notamment dans les secteurs tournés vers l'exportation ou les industries de soutien. Deuxièmement, l'État crée des parcs industriels et des incubateurs d'entreprises sur l'ensemble du territoire, où les nouvelles entreprises bénéficient d'un accompagnement depuis leurs locaux de production jusqu'à leur accès au marché. Troisièmement, le gouvernement encourage les liens entre les petites entreprises et les grandes entreprises ; ces dernières jouant un rôle de « leader de la chaîne d'approvisionnement », attirant de nombreuses PME qui deviennent fournisseurs, transformateurs, distributeurs, etc. Quatrièmement, la Chine a récemment créé des fonds de capital-risque publics pour investir dans les industries stratégiques, en particulier les hautes technologies. Ces fonds agissent comme des « investisseurs d'amorçage », apportant des capitaux aux côtés d'investisseurs privés aux jeunes entreprises technologiques, partageant les risques et guidant le développement des entreprises dans les secteurs prioritaires (IA, semi-conducteurs, énergies propres, etc.).
Avec la croissance rapide de son secteur privé, la Chine a exigé de ces entreprises qu'elles se conforment à des réglementations juridiques plus strictes, notamment dans des domaines tels que la technologie et la finance.
Dans un contexte de concurrence mondiale féroce et face aux nouvelles exigences du développement durable, la Chine étudie et prépare la publication d'un nouveau document de politique visant à promouvoir l'investissement privé. Ce document stipulera notamment un taux de participation minimal des capitaux privés dans les grands projets de secteurs clés tels que les chemins de fer, le nucléaire et les oléoducs et gazoducs. Il s'agit d'une avancée majeure pour lever les obstacles à l'accès au marché et les monopoles implicites.
Actuellement, en Chine, le secteur privé contribue à plus de 50 % des recettes budgétaires nationales, représente 60 % du PIB et crée 80 % des emplois urbains. D’ici 2024, le pays comptera plus de 55 millions d’entreprises privées, soit 92,3 % du nombre total d’entreprises enregistrées.
Dernier message : Commentaire : Transformez les défis en opportunités en or
Source : https://baotintuc.vn/kinh-te/kinh-te-tu-nhan-tru-cot-kien-tao-dong-luc-tang-truong-moi-bai-4-20251012074355923.htm



![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président de l'Agence de presse latino-américaine de Cuba](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F01%2F1764569497815_dsc-2890-jpg.webp&w=3840&q=75)


























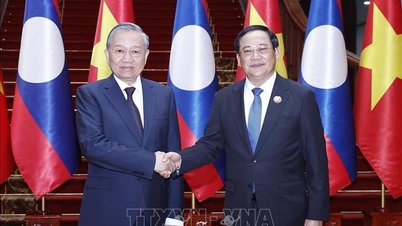
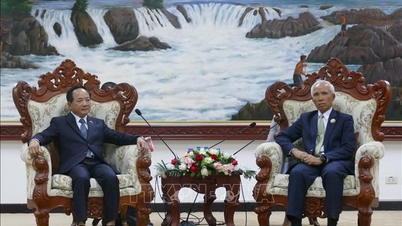
































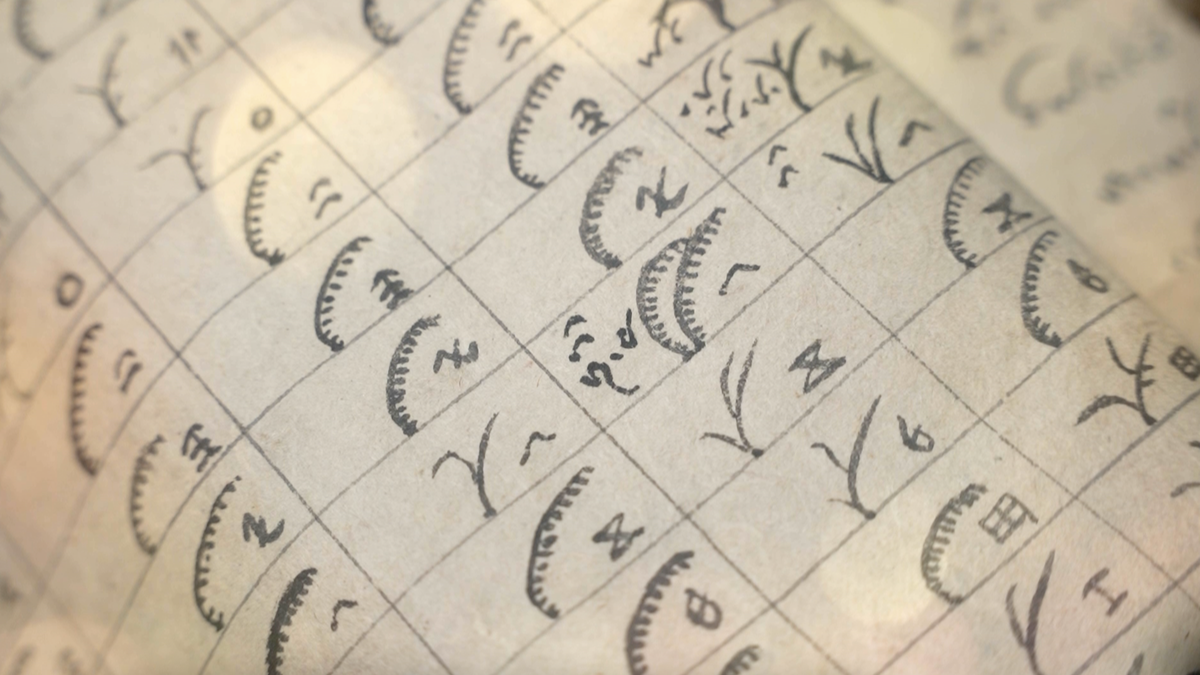











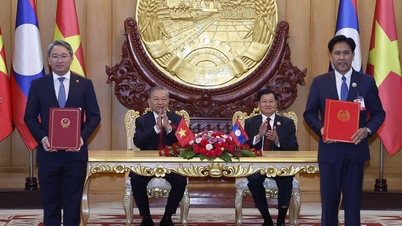
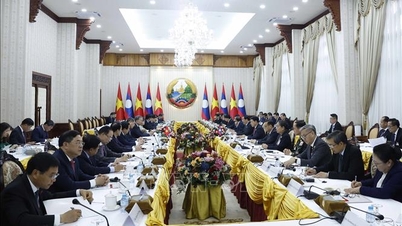






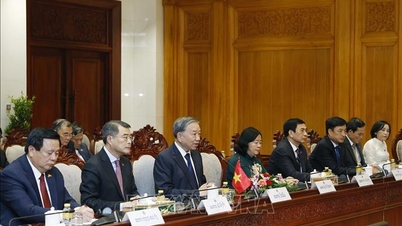






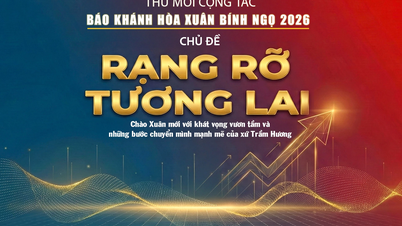















Comment (0)