Conservez vos terres, construisez-vous une vie dans les hautes montagnes.
Fin octobre, le soleil est aussi doré que le miel, et la route de Dien Bien à Si Pa Phin est particulièrement agréable à cette saison. C'est pourquoi nous nous trouvons au village de Nam Chim, dans la commune de Si Pa Phin, là où Vang A La, un homme Hmong qui plantait des forêts et élevait du bétail, est devenu un futur milliardaire.
Sous le soleil sec et doré d'un matin d'automne, le ciel de Dien Bien est clair et haut. À la lisière de la forêt, le garrulaxe à joues argentées chante avec clarté ; le lieu est si paisible et silencieux qu'on sent le souffle de la forêt et la fraîcheur qui émane de la montagne.
Nous étions assis au bord de la route, au kilomètre 35. Le téléphone a sonné plusieurs fois, l'autre bout du fil a décroché, mais personne n'a répondu. J'ai patiemment attendu qu'on me rappelle, mais toujours rien. Impatient, j'ai décroché et rappelé. Ça a sonné deux fois. L'autre personne a dit brièvement : « Bonjour, qui est à l'appareil ? C'est moi, Vang A La. »

Portrait de Vang A La, village Nam Chim 1, commune Si Pa Phin, province Dien Bien. Photo : Hoàng Chau.
Après avoir donné des indications pendant un certain temps, nous avons enfin rencontré Vang A La (né en 1980), un Hmong du village de Nam Chim, commune de Si Pa Phin, province de Dien Bien ; un véritable agriculteur qui a échappé à la misère en partant de rien, au cœur de ces collines arides. A La nous a confié : « En 2004, je ne possédais rien d'autre que l'épouse que mes parents m'avaient mariée, ainsi qu'à mes quatre enfants. Mon principal travail consistait alors à garder des buffles pour subvenir aux besoins de ma famille. Je passais de nombreuses heures à faire paître les buffles sur les 80 hectares de terres incultes de ma famille, rêvant secrètement de posséder des greniers à riz et quelques buffles pour soulager la misère de ma femme et de mes enfants. »
La terre aride ne permettait ni la culture du maïs ni celle du riz, et il n'y avait pas de rizières pour la riziculture irriguée. Mes enfants grandissaient, et si je ne trouvais pas un moyen de subvenir à leurs besoins, ils mourraient de faim. Cette année-là, j'ai commencé à amener les buffles sur ce terrain vague pour y construire un abri, clôturer la propriété et installer un campement. J'ai emprunté de l'argent à des proches pour acheter quelques chèvres, quelques vaches, deux paires de chevaux et deux buffles que nous possédions déjà.
Les chèvres se reproduisent très rapidement, donnant naissance deux fois par an. En seulement trois ans, mon troupeau a donc connu une croissance fulgurante. Les chevaux, les buffles et les vaches, quant à eux, mettent bas une fois par an. Je ne les ai pas vendus immédiatement, mais les ai laissés grandir. Une fois mon troupeau arrivé à 25 chèvres, j'en ai vendu quelques-unes pour financer les études de mes enfants et acheter davantage de vaches et de buffles reproducteurs.
À cette époque, cette région vallonnée était encore sauvage et peu de gens osaient s'y lancer dans l' agriculture . Vang A La, avec audace, demanda à la municipalité de confirmer la carte des pâturages, à la fois pour protéger les terres héritées de ses ancêtres et pour éviter les conflits lors de l'expansion de la production. Sur l'ensemble de la zone vallonnée, A La et sa femme installèrent jour et nuit des clôtures de barbelés et enterrèrent des poteaux B40 : les pentes étaient destinées à l'élevage de chèvres, les zones légèrement plus plates à celui de buffles, de vaches et de chevaux.
« Cette terre était autrefois la terre de notre famille. Nous devons nous adresser à la commune pour obtenir une confirmation afin que nos descendants puissent y exercer leur activité sans litige », expliqua simplement A La. Ainsi, cet homme Hmong « conserva la terre » avec l’intention de la cultiver, convaincu que : « Nous, le peuple Hmong, devons prospérer sur la terre de nos ancêtres. »
Sur une exploitation de plus de 80 hectares, la famille de Vang A La élève près de 300 têtes de bétail, dont 50 vaches, 20 buffles, 20 chevaux et 130 chèvres. La ferme d'A La possède un abri et est entretenue toute l'année par des ouvriers agricoles. Pendant la saison des pâturages, les animaux broutent tranquillement et s'abreuvent au ruisseau. « Mes buffles, vaches, chevaux et chèvres ne mangent que de l'herbe et ne boivent que de l'eau. Le soir, je leur donne un peu de sel pour qu'ils retrouvent leur étable, c'est tout. » A La parle ainsi, comme s'il racontait une histoire du quotidien, avec simplicité et innocence.

Vang A La et son troupeau de chèvres. Photo : Hoang Chau.
Chaque année, après la saison de pâturage, A La ramène le bétail près de chez lui pour stocker la paille et la vendre. « Vers la fin novembre, je les laisse rentrer. Je vends les grosses bêtes et je garde celles qui ont vêlé. En avril, quand l'herbe a repoussé, je les ramène à la montagne. » Ainsi, le cycle du pâturage et des saisons se répète, et A La, sa femme et ses enfants n'ont plus à se soucier de nourrir le grand troupeau.
Grâce à ce modèle, la famille de Vang A La gagne environ 400 à 500 millions de dongs par an. Ce n'est pas une somme négligeable pour les habitants des hauts plateaux. A La explique : « Les gens viennent de loin pour acheter, ils n'ont pas besoin de transporter leur poisson pour le revendre. S'ils acceptent de me vendre du poisson, je n'ai qu'à l'attacher à la voiture. »
Il a confié : « L’État m’a envoyé suivre une formation vétérinaire de base et j’ai obtenu mon diplôme. Grâce à cela, je sais aussi reconnaître les symptômes des animaux pour diagnostiquer les maladies et les vacciner. Le soir, ils retournent dans leur cage et le lendemain matin, je les relâche. Il me suffit de voir des traces de selles ou d’urine, ou de les voir marcher lentement, pour savoir qu’ils sont malades. Une fois la maladie identifiée, le traitement est simple. »
Selon A La, le plus difficile est de se retrouver face à un terrain accidenté, comme lorsqu'un buffle ou une vache tombe d'une falaise en broutant. On ne peut que s'en attrister. Quant au reste, qu'il s'agisse de maladie ou d'intempéries, nous savons comment y faire face.
Modèle économique agricole et forestier
Vang A La ne se contente pas de mettre en place un modèle d'élevage bovin à grande échelle ; cet homme Mong, travailleur et consciencieux, plante également des forêts. Sur six hectares supplémentaires, il cultive du tung, des pins, de la cannelier et des plantes médicinales. « La forêt de tung existe depuis longtemps et j'ai été rémunéré pour les services écosystémiques rendus. Quant à la pinède, je l'ai plantée il y a une dizaine d'années, et les arbres sont maintenant imposants. Le cannelier, planté il y a seulement deux ans, est aussi gros qu'un tuyau », explique-t-il.
A La marqua une pause, puis expliqua : « Pour moi, planter des forêts n’est pas seulement un moyen de gagner un revenu supplémentaire, mais aussi de préserver la terre et l’eau. Si nous ne plantons pas d’arbres sur les terres dénudées, tout sera emporté par les eaux et les champs disparaîtront. Planter des arbres offrira à nos enfants et petits-enfants un trésor à apprécier plus tard. »

La ferme de Vang A La compte actuellement plus de 100 chèvres. Photo : Minh Duy.
Pour les habitants des hauts plateaux comme Vang A La, les forêts ne sont pas seulement des ressources, mais aussi un abri, un lieu où ils peuvent assurer des moyens de subsistance durables. Dans le village de Nam Chim 1, rares sont ceux qui, comme A La, plantent des forêts. « Comme les bienfaits de la plantation d'arbres ne sont pas immédiats, beaucoup abandonnent. Mais je pense que les pins et les canneliers ne révéleront leur valeur qu'après dix ans. Il ne faut pas se précipiter en agriculture », a-t-il réfléchi.
A La raconte : « Les années précédentes, les villageois avaient appris de lui à construire des granges, à engraisser le bétail et à clôturer les terres pour créer de petites exploitations. Mais lorsque le prix du bétail a chuté, beaucoup se sont découragés et ont abandonné. Seul A La a persévéré et a continué à élever du troupeau, passant des buffles et des vaches aux chèvres et aux chevaux. « En 2020-2021, le prix du bétail et des buffles a chuté, alors j'ai élevé des chevaux et des chèvres pour les vendre et avoir de quoi survivre », explique A La. »
Grâce à cette capacité d'adaptation, Vang A La est devenu le pionnier du village en matière d'agroforesterie intégrée, alliant l'élevage de bétail et la plantation de forêts et de plantes médicinales. Ce modèle lui permet non seulement de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de contribuer à la protection des forêts et au reboisement des terres et des collines arides. Dans la simplicité de ses propos, Vang A La exprime la philosophie de vie des montagnards : « Quoi que tu fasses, il faut persévérer, ne jamais abandonner, préserver la terre, préserver le troupeau, c'est assurer la nourriture et l'habillement des enfants. »
Vang A La et sa femme ont quatre enfants, tous étudiants. Leur fille aînée est enseignante, leur troisième fils est policier et leurs deux autres enfants sont diplômés de grandes universités de Hanoï – grâce au modèle économique de l'exploitation agricole familiale.
À cet instant, les yeux de Vang A La pétillèrent d'excitation. Il serra ses genoux contre sa poitrine et hocha la tête en signe d'approbation, souriant joyeusement.
Source : https://nongnghiepmoitruong.vn/mot-nguoi-mong-mau-muc-d781101.html








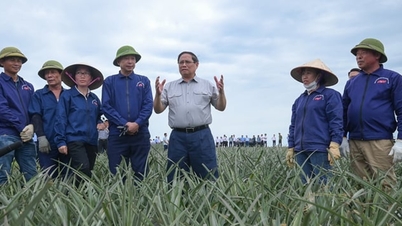











![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)

![Celui qui a « démonté la clôture » pour l’agriculture de Dat Cang : [Partie 2] Préserver la valeur des terres de Doan Xa](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762727497156_2926-nguoi-xe-rao-mo-loi-cho-san-xuat-nong-nghiep-dat-cang-165925_730.jpeg)









![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Partie 2] Ouverture d'un nouveau canal de distribution](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/09/1762655780766_4613-anh-1_20240803100041-nongnghiep-154608.jpeg)










































































Comment (0)