Au début du XIXe siècle, la littérature danoise se tourna vers le romantisme car la bataille navale de 1801, pendant la guerre contre l'Angleterre, attisa le sentiment nationaliste et un jeune philosophe introduisit le romantisme allemand au Danemark.
stade de formation et de croissance
Période médiévale : Du VIIIe au Xe siècle, les peuples nordiques, appelés Vikings (signifiant rois, guerriers de la mer), migraient de la péninsule scandinave vers les côtes du sud, sillonnant les mers, parfois à bord de centaines de navires. Pirates, commerçants, explorateurs et conquérants, ils atteignirent même l’Amérique. Leurs aventures sont relatées dans les épopées (sagas) de la littérature orale.
Après l'introduction du christianisme (IXe-Xe siècle), ce n'est qu'au XIIe siècle que l'historien Saxo Grammaticus a consigné les récits ci-dessus en latin dans les Gesta Danorum, faisant l'éloge du courage, de la franchise et de la simplicité des Vikings.
Sous l'influence du christianisme, une littérature latine se développa, d'abord au service de la religion (hymnes, traditions des saints) et du roi (lois, chroniques). Aux XVIe et XVIIe siècles, la réforme religieuse apporta le protestantisme en Europe du Nord, et la littérature religieuse continua de se développer (hymnes, chants populaires), de même que les ouvrages historiques. La poésie profane, quant à elle, demeura peu abondante.
Au XVIIIe siècle, en Europe du Nord, le Danemark joua un rôle prépondérant grâce à sa richesse, ses terres fertiles, sa proximité avec le continent et son système social similaire (le servage féodal, quasi inexistant en Suède et en Norvège). L'industrie et le commerce y étaient florissants, et la population urbaine très active. Copenhague, la capitale, était la plus grande du pays (elle était alors la capitale commune du Danemark et de la Norvège fusionnés).
Durant cette période, l'écrivain et dramaturge L. Holberg (1684-1754) fut un représentant typique du mouvement des Lumières en Europe du Nord, le père de la littérature danoise et le fondateur de la comédie danoise (influencée par la littérature française).
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'influence de la littérature allemande s'affirme, notamment grâce à la présence du poète allemand Klopstock, favori de la cour. La littérature danoise renoue ainsi avec ses origines et les mythes de la période germanique nordique. Le grand poète lyrique J. Ewald (1743-1781), auteur de deux pièces de théâtre, est une figure emblématique de cette époque.
Après une crise religieuse, sa poésie gagna en profondeur. Dans l'opéra Le Pêcheur, un de ses airs fut utilisé comme hymne royal du Danemark. À la fin du siècle, un courant préromantique (patriotisme, amour de la nature) se manifesta.
Au début du XIXe siècle, la littérature danoise se tourna entièrement vers le romantisme, car la bataille navale de 1801, durant la guerre contre l'Angleterre, attisa le nationalisme et un jeune philosophe introduisit le romantisme allemand au Danemark. La littérature se tourna alors vers ses origines, les anciens mythes nordiques, pour y puiser des thèmes créatifs et innover en matière de formes (images et rythmes de la poésie populaire).
La première génération romantique : L'auteur pionnier fut A. Oehlenschlaeger (1779-1850) avec son recueil de poèmes Les Cornes d'or, utilisant la forme lyrique et épique du « romancero ». Sa tragédie s'inspire des légendes nordiques. Son œuvre la plus célèbre est la pièce La Lampe d'Aladin, basée sur un conte arabe. Lors de son séjour en Suède, il fut salué comme « le roi des poètes nordiques ».
Le pasteur N. Grundtvig (1783-1872) fut le plus grand poète religieux de son temps. Il souhaitait unir la tradition nordique au christianisme, à l'esprit national et à la littérature populaire. Ses hymnes sont encore chantés aujourd'hui. Il fut l'initiateur des « écoles populaires », qui exercèrent une grande influence en Europe du Nord.
Le pasteur SS Blicher (1742-1848) était un réformateur issu du siècle des Lumières. Il écrivit de la poésie et de la prose. Ses nouvelles décrivent le passé et le présent de son Jutland natal.
 |
| L'écrivain Hans Christian Andersen. |
La seconde génération romantique : après l’effervescence de la première, la seconde s’installe dans une atmosphère plus sereine. La littérature bourgeoise atteint sa pleine maturité, marquée par une sensibilité particulière : une conscience accrue de l’intime, du romantisme et des convenances. Le nom de L. Heiberg, dramaturge et critique, se distingue.
Non seulement durant cette période, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun écrivain danois n'est aussi célèbre au pays et à l'étranger que Hans Christian Andersen (1805-1875).
En 1987, il figurait parmi les auteurs les plus publiés au monde . Il incarne à merveille les caractéristiques nationales du peuple danois. Son œuvre la plus célèbre est le recueil de Contes pour enfants, qui comprend plus de 164 histoires.
Il puisait son inspiration dans les légendes, les contes de fées, les récits populaires, l'histoire et des histoires romancées inspirées du quotidien. Ses récits possèdent deux niveaux de lecture : l'un, d'abord captivant grâce à son intrigue dramatique, et l'autre, plus profond, de par sa délicatesse et sa poésie, qui exhale un cœur tendre, sensible et parfois naïf, qui continue de toucher les lecteurs.
Son style mêle poésie et réalisme, ironie et sentimentalité, toujours avec des associations intéressantes et surprenantes, et fondamentalement optimiste. Voici la traduction anglaise des contes d'Andersen publiée en 1999 dans son pays natal – considérée comme la version la plus originale.
Le professeur E. Bredsdroff déplorait que la plupart des traductions à travers le monde présentent deux lacunes : d’une part, considérant Andersen comme un auteur pour enfants, les anthologies ne retiennent que des contes destinés aux jeunes lecteurs. De nombreuses histoires aux réflexions philosophiques profondes, accessibles uniquement aux adultes, sont ainsi écartées. D’autre part, les traductions peinent parfois à restituer le style d’Andersen.
Ces deux observations s'appliquent également aux traductions vietnamiennes, principalement issues du français. J'ai eu l'occasion de comparer trois versions vietnamiennes avec l'édition anglaise de 1999 (imprimée à Odense) et j'ai constaté un manque d'histoires pour adultes, une traduction essentiellement vietnamienne et donc éloignée du style d'Andersen. Pire encore, il arrivait que le traducteur se contente de traduire le texte pour le comprendre, omettant des mots difficiles, voire traduisant parfois le sens à l'envers.
Source





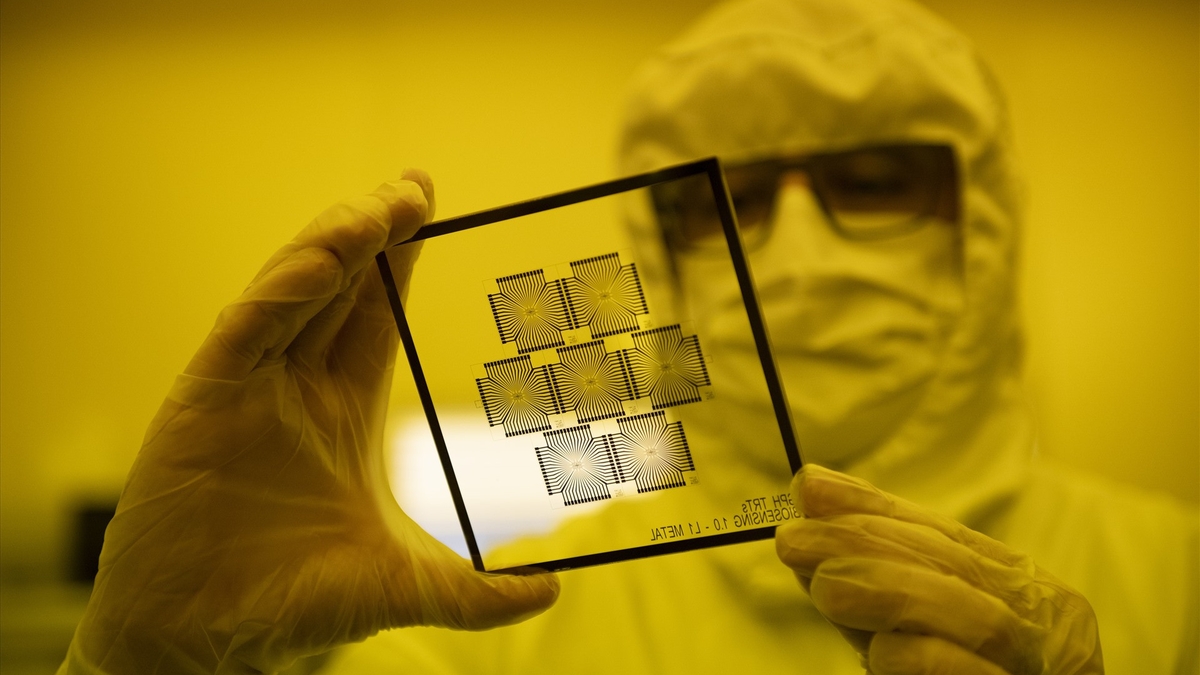

![[Photo] Da Nang : Des centaines de personnes se mobilisent pour nettoyer un axe touristique majeur après le passage de la tempête n° 13](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)























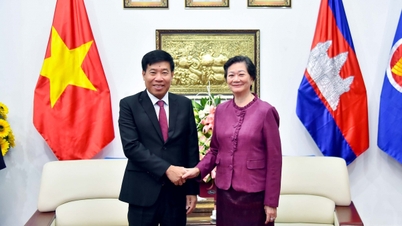
















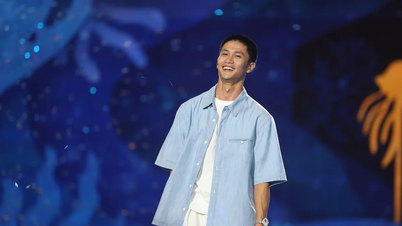

























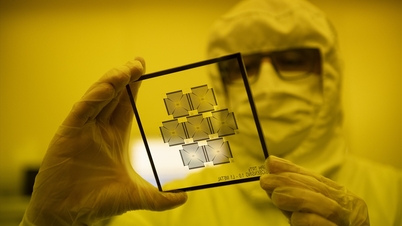




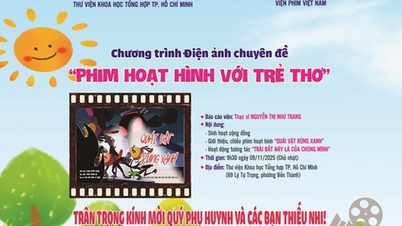































Comment (0)