 |
| Après 80 ans de formation et de développement, riches d'enseignements historiques, la diplomatie vietnamienne a mûri et s'est développée. (Photo : Nguyen Hong) |
Depuis la signature par le président Hô Chi Minh du décret établissant le Gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, marquant ainsi la naissance de la diplomatie vietnamienne moderne (28 août 1945 - 28 août 2025), il fut non seulement le premier ministre des Affaires étrangères, mais il participa également directement aux activités diplomatiques, les dirigea et forma une équipe de fonctionnaires. À cette époque, le corps diplomatique ne comptait que vingt personnes, parmi lesquelles des cadres révolutionnaires et de jeunes intellectuels maîtrisant le français, l'anglais, le chinois et le russe, répartis dans trois départements : le Secrétariat général, le Conseil consultatif et le Bureau.
À cette époque, rares étaient ceux qui imaginaient que ces débuts modestes constitueraient un fondement essentiel aux succès extraordinaires que connaîtrait plus tard la diplomatie vietnamienne. Au cours de ce parcours historique difficile mais glorieux, sous l'égide du Parti et de l'Oncle Hô, la diplomatie devint peu à peu un front stratégique, un bras essentiel de la révolution, contribuant de manière significative à la victoire finale de la nation.
Sous l'égide du Parti, avec la participation et la coordination de l'ensemble du peuple et de l'armée, la diplomatie vietnamienne a surmonté toutes les difficultés et tous les obstacles pour mûrir et se développer. Elle est passée de la faiblesse à la force, de la victoire partielle à la victoire totale. La diplomatie vietnamienne a mûri grâce à la pratique révolutionnaire, reflétant le processus révolutionnaire de la nation. L'ère Hô Chi Minh a hissé la diplomatie vietnamienne à un niveau supérieur, obtenant des résultats remarquables.
Parallèlement, au-delà de la tradition, les résultats dont on peut être fier après 80 ans de service à la Patrie, au Parti et au Peuple vietnamiens laissent de nombreux enseignements précieux, notamment lors des périodes difficiles et ardues, dont les générations de cadres diplomatiques doivent constamment s'inspirer et qu'ils doivent appliquer pour suivre les traces de leurs prédécesseurs au XXIe siècle.
| La diplomatie vietnamienne évolue de la faiblesse à la force, de la victoire partielle à la victoire totale. Elle mûrit grâce à la pratique révolutionnaire, reflétant le processus révolutionnaire de la nation. |
Inébranlable, déterminée à protéger la paix dès le début, même à distance.
Après la Révolution d'août, le gouvernement révolutionnaire, encore jeune, se trouvait confronté à une situation d'ennemis intérieurs et extérieurs. Le président Hô Chi Minh déclara : le Vietnam souhaite « être ami avec tous les pays démocratiques et ne se faire d'ennemis avec personne ». Face au risque de guerre, l'Oncle Hô mena de nombreuses actions diplomatiques pour préserver la paix : il négocia directement avec les représentants du gouvernement français pour la signature de l'Accord préliminaire le 6 mars 1946, puis se rendit personnellement en France pendant près de cinq mois pour diriger la délégation de négociation à la conférence de Fontainebleau, tout en mobilisant l'opinion publique française et internationale pour soutenir les aspirations du peuple vietnamien à l'indépendance et à la réunification.
Cependant, en raison de l'obstination coloniale de la délégation française et du sabotage délibéré des négociations par l'armée française au Vietnam, les pourparlers de Fontainebleau (6 juillet - 10 septembre 1946) échouèrent. Il était déterminé à tout prix à préserver l'Accord préliminaire du 6 mars 1946, à maintenir la possibilité de reprendre les négociations bilatérales et à gagner du temps pour la réconciliation entre les deux parties. Le 14 septembre 1946 et au petit matin du 15 septembre 1946, il s'efforça de négocier la signature de l'Accord provisoire du 14 septembre avec le ministre français des Outre-mer, Marius Moutet, afin de gagner du temps pour se préparer à l'inévitable guerre d'agression.
La visite du président Hô Chi Minh en France en 1946 constitua un phénomène véritablement unique dans l'histoire des relations internationales. En effet, il était le premier chef d'État d'un pays colonial condamné à mort par contumace par la « mère patrie » coloniale à utiliser ses propres avions et navires de guerre pour se rendre en France en tant qu'invité de marque.
Cet acte a démontré le courage et l'esprit d'un dirigeant qui a hardiment « pénétré dans la gueule du loup » avec une foi inébranlable dans la justice de la cause et un esprit d'unité, celui de « millions de personnes comme une seule » population vietnamienne de l'époque.
Comportement habile, transformant le danger en sécurité
Cependant, pour un diplomate, le courage et la bravoure ne suffisent pas. Dans le contexte de la jeune République démocratique du Vietnam, constamment menacée, la marque la plus marquante de la victoire diplomatique de cette période, sous la direction du Parti et du président Hô Chi Minh, fut la stratégie et l'habileté mises en œuvre pour gérer simultanément cinq grandes puissances et faire face à quatre armées étrangères totalisant plus de 300 000 soldats présentes au Vietnam.
Il a habilement tiré parti des contradictions entre les pays et a élaboré des stratégies adaptées à chaque objectif, plaçant systématiquement les intérêts nationaux et ethniques au-dessus de tout. Le Vietnam a exploité les dissensions entre Tchang Kaï-chek et la France pour les diviser et les empêcher de s'allier. Le Parti et l'Oncle Hô ont fait des concessions au moment opportun, alors que la France était sous pression de l'armée de Tchang Kaï-chek qui l'incitait à ouvrir le feu. Le président Hô Chi Minh a alors proposé une nouvelle formule pour sortir de l'impasse : remplacer le mot « indépendance » par le mot « liberté », en déclarant : « Le gouvernement français reconnaît la République démocratique du Vietnam comme une nation libre… »
On peut affirmer sans exagérer que la manière dont l'oncle Hô Chi Minh traitait l'armée de Tchang Kaï-chek relevait de l'art. M. Nguyen Duc Thuy, un révolutionnaire chevronné, a relaté quelques détails intéressants à ce sujet : lors d'une réunion des cadres pour leur assigner des tâches, l'oncle Hô déclara : « Je vous invite à organiser le Comité du ministère des Affaires étrangères, mais n'utilisez en interne que les termes « Comité » ou « Comité », afin d'éviter que l'armée de Tchang Kaï-chek ne les reconnaisse, car elle les considère comme le nom du Parti communiste. À l'extérieur, il convient de parler de « consultant », une fonction courante au sein de l'appareil du Parti nationaliste chinois. » De plus, le président Hô Chi Minh ordonna à ses camarades de graver des sceaux, car l'armée de Tchang Kaï-chek n'accordait de valeur qu'aux sceaux, et non aux signatures !
Ces petits détails montrent que la diplomatie exige une compréhension approfondie de la culture, de la psychologie et des coutumes des partenaires et des adversaires afin d'atteindre l'objectif ultime.
 |
| Le président Hô Chi Minh et le ministre Marius Moutet à Paris le 14 septembre 1946. (Source : Document) |
Indéfectiblement indépendante, autonome et défendant haut l'étendard de la justice
Durant la période de résistance contre la France et les États-Unis, les relations triangulaires sino-soviétiques ont connu des évolutions complexes. La Chine a négocié avec les États-Unis au sujet de la guerre du Vietnam en obtenant le retrait des troupes américaines de Taïwan (Chine). La Chine et l'Union soviétique étaient les deux principaux pays soutenant le gouvernement de la RDV dans la résistance, mais elles étaient en conflit ouvert.
Dans ce contexte, le Vietnam subissait constamment des pressions de la part des deux pays quant au contenu, à l'orientation et aux détails techniques des négociations. En 1950, le président Hô Chi Minh rappelait : « Avec le soutien de l'Union soviétique et de la Chine en matière de matériel, d'armes et d'équipements, nous aurons moins de difficultés, mais la victoire dépendra de nos propres efforts. »
Durant la période de résistance contre les États-Unis, tirant les leçons de la Conférence de Genève de 1954, le Vietnam acquit une précieuse expérience et maintint résolument son indépendance et son autonomie, tout en préservant habilement sa solidarité avec l'Union soviétique et la Chine. Au cours des négociations, les hauts responsables du Parti, du gouvernement de la République démocratique du Vietnam et du ministère des Affaires étrangères entretinrent des contacts diplomatiques réguliers, informèrent l'Union soviétique et la Chine, écoutèrent leurs points de vue, mais n'en retinrent qu'une partie, procédèrent à des échanges et les convainquirent de la position du Vietnam, tout en garantissant une aide en armes et en vivres de part et d'autre.
La période la plus difficile pour le Vietnam fut celle de 1972, lorsque les États-Unis entamèrent une détente avec l'Union soviétique et la Chine afin de contraindre ces deux pays à réduire leur aide au Vietnam. Lors d'une réunion privée, juste après sa visite en Chine et en Union soviétique avec le président américain Nixon, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger exprima son intention d'interroger le camarade Le Duc Tho : « Votre conseiller, via Pékin et Moscou, a certainement entendu vos amis nous faire part de nos opinions dans cette négociation ? »
Le camarade Le Duc Tho répondit : « Nous avons combattu votre armée sur le champ de bataille et nous avons négocié avec vous à la table des négociations. Nos amis nous ont soutenus sans réserve, mais ils n'ont pas pu le faire à notre place. »
Cela démontre une fois de plus que la détermination et la persévérance dans la quête d'indépendance et d'autonomie constituent une leçon profonde de la diplomatie vietnamienne.
| « Nous avons combattu votre armée sur le champ de bataille et nous avons négocié avec vous à la table des négociations. Nos amis nous ont soutenus sans réserve, mais ils n’ont pas pu le faire à notre place. » (Camarade Le Duc Tho) |
Promouvoir la force combinée
La leçon importante de la diplomatie durant cette période fut de promouvoir la force combinée sur le front extérieur ; d'unir étroitement le Nord et le Sud, la diplomatie et l'armée, la force intérieure du Vietnam et le front international...
Cela s'est particulièrement manifesté durant les négociations de l'Accord de Paris. La particularité de cette période résidait dans le fait que le Vietnam disposait alors de deux ministères des Affaires étrangères : celui de la République démocratique du Vietnam et celui du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, également connu sous le nom de CP-72.
Durant les négociations, guidées par la devise « deux mais un, un mais deux », les deux délégations ont veillé à une répartition et une coordination rigoureuses des tâches, de la proposition de solutions à l'attribution des rôles diplomatiques lors de chaque réunion, en tirant parti de l'opinion publique. Soucieuses d'élargir leurs contacts et de mobiliser l'opinion internationale, les deux délégations, dont chaque membre était également journaliste, ont activement contribué au mouvement international, s'appuyant sur le front de solidarité internationale pour soutenir un Vietnam pacifique et stable.
Dès le début du processus de négociation, les propositions de paix, les déclarations et le contenu des conférences de presse des deux délégations vietnamiennes ont été rendus publics afin de recueillir un large soutien populaire, ce qui a causé des difficultés aux États-Unis dans les instances internationales et au sein de la politique américaine.
Nous avons intensifié notre propagande en permanence et partout, avec près de 500 conférences de presse à Paris, centre mondial de l'information. Nos négociateurs de haut rang ont régulièrement accordé des interviews qui ont influencé l'opinion publique.
Devant la presse, l'image de la ministre Nguyen Thi Binh, imperturbable, de la ministre Xuan Thuy, au sourire éclatant, du camarade Le Duc Tho, au caractère affirmé, et du vice-ministre Nguyen Co Thach, aux répliques cinglantes, a fortement marqué le public international de l'époque.
L'intérêt considérable suscité par l'Accord de Paris dans le monde entier est comparable à celui porté aux précédentes grandes conférences politiques internationales telles que Potsdam, Téhéran ou Yalta. Afin de réaffirmer et de clarifier notre position, les deux délégations de négociation ont dépêché des représentants dans toute la France et dans des pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine pour participer à des rassemblements, des manifestations et des conférences.
Combattre tout en négociant, allier diplomatie et action militaire, et obtenir le soutien de la communauté internationale pour la juste lutte du peuple vietnamien constitue la stratégie appropriée et la méthode efficace à ce stade.
Après l'offensive générale du printemps-été 1972, saisissant l'opportunité, le Parti et l'État décidèrent d'entamer des négociations de fond. Durant ce processus, les délégations vietnamiennes mirent en avant un esprit d'indépendance, d'autonomie et de négociations menées en interne, refusant toute influence extérieure.
La coordination harmonieuse entre les deux délégations de négociation, la promotion de leurs forces combinées, la prise en compte de l'opinion publique et la promotion du mouvement populaire mondial en faveur du Vietnam ont permis aux négociations de Paris d'aboutir à une victoire finale, créant ainsi les conditions de la réunification du pays en 1975.
 |
| La ministre des Affaires étrangères Xuan Thuy à Paris, en France, le 10 mai 1968. (Source : Getty Images) |
Changez votre façon de penser, persévérez étape par étape pour surmonter la situation difficile.
Après 1975, la situation mondiale et régionale connut de nombreux bouleversements rapides et complexes. Sur le plan intérieur, la grande victoire du printemps 1975 fit entrer le pays dans une nouvelle phase de développement, marquée par de nombreux événements héroïques, mais aussi par des hauts et des bas. Le Vietnam se retrouva alors dans une situation extrêmement difficile, soumis à un embargo économique et encerclé politiquement et diplomatiquement. Cependant, c'est précisément dans cette période difficile que la diplomatie accompagna la nation, faisant preuve d'une grande force intérieure et d'une détermination sans faille pour permettre au pays de briser l'embargo et d'entrer dans une ère d'intégration internationale.
Le Parti et l'État ont également reconnu que la question cambodgienne serait déterminante pour la résolution des relations régionales et internationales et la levée du blocus et de l'embargo. Le ministère des Affaires étrangères a décidé de créer un groupe de recherche interne, désigné CP-87, chargé d'étudier les politiques permettant de résoudre la question cambodgienne et d'instaurer la paix en Asie du Sud-Est, et d'élaborer des plans de lutte avant, pendant et après la recherche d'une solution.
Dès le début, le secteur diplomatique a considéré le développement socio-économique du pays comme une mission essentielle. La 9e Conférence diplomatique (juillet 1970) a énoncé la politique suivante : « La diplomatie doit étudier les besoins économiques des pays, solliciter l’aide internationale, recueillir les avancées scientifiques et technologiques étrangères et promouvoir les relations économiques, culturelles, scientifiques et technologiques avec les autres pays. » La 10e Conférence diplomatique (janvier 1971) a ensuite souligné : « Après la fin de la guerre, l’action diplomatique s’orientera progressivement vers des enjeux économiques. »
Entre 1986 et 1988, la crise socio-économique au Vietnam atteignit son paroxysme. Animé par un esprit de lucidité et de transparence, le VIe Congrès (décembre 1986) proposa une politique de rénovation globale. En collaboration avec les agences de politique étrangère, le ministère des Affaires étrangères contribua à l'élaboration de la résolution n° 13 du Bureau politique (mai 1988). Cette résolution témoigna d'une volonté affirmée de renouveler la réflexion sur la situation mondiale et de réorienter l'ensemble de la stratégie de politique étrangère du pays.
Partant du constat que la tendance à la lutte et à la coopération entre pays aux régimes sociaux différents se développe de plus en plus, la résolution a proposé une politique visant à « faire passer la lutte d'un état de confrontation à une lutte et une coopération dans une coexistence pacifique » et a souligné que « grâce à une économie forte, une défense nationale suffisamment forte et l'expansion de la coopération internationale, nous serons mieux à même de maintenir notre indépendance et de construire avec succès le socialisme ».
Depuis lors, le Vietnam a progressivement levé l'embargo et mis en œuvre une politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée, devenant ainsi un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.
 |
| La mission vietnamienne auprès des Nations Unies participe à la modération d'un débat général. (Source : Mission vietnamienne auprès des Nations Unies) |
Regarder en arrière permet d'avancer
Il y a 143 ans, le célèbre Nguyen Truong To déclarait : « Le temps est venu pour le monde de s'orienter progressivement vers une ère de prospérité, de déployer ses ailes dans toutes les directions. » C'est le moment pour la nation de se transformer, d'accroître sa force, de rehausser son statut et de s'ouvrir au monde.
Que le pays soit prospère ou en difficulté, que le contexte international soit favorable ou défavorable, la diplomatie recherche, identifie et crée des opportunités ; c’est un art, un engagement à surmonter les obstacles. Face à l’adversité, la diplomatie, à l’instar du pays, la perçoit comme une épreuve de courage et d’intelligence, un tremplin pour se forger une position et progresser.
Tout au long de ce processus, le secteur diplomatique a toujours été présent et a contribué aux moments clés, depuis les débuts de la révolution, en passant par les deux guerres de résistance, le processus du Doi Moi, jusqu'à la phase de développement et d'intégration internationale. Le succès commun du secteur et du pays repose sur les efforts considérables et inlassables de générations de cadres diplomatiques et de nombreuses autres « armées » œuvrant sur le front des affaires étrangères. Le président Hô Chi Minh a dit un jour : « Les cadres sont à la base de tout travail. » Ce n'est que lorsque les racines sont solidement ancrées dans le sol que l'arbre peut être fort, avoir des branches et des feuilles luxuriantes et atteindre le ciel bleu.
S'inspirant des idées du Premier ministre, le secteur des affaires étrangères a accordé une attention particulière au recrutement et à la recherche. La 13e Conférence diplomatique (1977) illustre parfaitement la transformation opérée dans le développement de ce secteur, notamment en matière de recherche et de recrutement. Elle a contribué à jeter les bases d'une carrière diplomatique réussie durant la période de rénovation, favorisant l'intégration internationale du pays et s'inscrivant dans la tendance contemporaine à « se tenir à égalité avec les puissances des cinq continents ».
Le monde actuel est confronté à de nombreux défis et difficultés, et le Vietnam n'y fait pas exception. Dans ce contexte, la diplomatie vietnamienne, riche d'une identité nationale, empreinte de courage, de paix, de respect de la raison et de la justice, forte de son expérience et des leçons de son histoire acquises au cours de 80 ans de formation et de développement, s'efforcera toujours de renforcer son rôle pionnier, au service de la pérennité du pays et de la nation.
Les précieuses expériences tirées d'une longue histoire de gestion harmonieuse et appropriée des relations entre indépendance et autonomie, entre intérêts nationaux et responsabilités internationales, constitueront une base solide pour les affaires étrangères en général et la diplomatie en particulier.
Les leçons tirées de la fermeté dans les principes diplomatiques et de la flexibilité stratégique seront les éléments essentiels pour continuer à promouvoir le rôle clé dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable, au service du développement et du renforcement de la position du pays dans les mois à venir.
Comme l'a souligné l'ancien ministre des Affaires étrangères Nguyen Dy Nien : « L'identité diplomatique du Vietnam repose sur une nation riche d'une identité et d'une culture séculaires. Cette identité culturelle nationale, imprégnée des valeurs d'humanité et d'époque, se reflète dans l'idéologie et le style diplomatique du président Hô Chi Minh, ainsi que dans la profondeur intellectuelle des politiques nationales et des décisions stratégiques du Parti. Elle se traduit par une approche flexible, engagée et persuasive, tout en respectant les principes fondamentaux dans la poursuite des objectifs de politique étrangère. Plus la situation est complexe, plus la stratégie et l'action doivent être flexibles, tout en restant fermement ancrées dans les objectifs et les principes de la révolution. Telle est l'identité de la diplomatie vietnamienne à l'ère moderne. »
| « Plus la situation est complexe, plus la stratégie et la réponse doivent être flexibles, tout en reposant sur une compréhension ferme des objectifs et des principes de la révolution. C’est une caractéristique de la diplomatie vietnamienne moderne. » (Nguyen Dy Nien, ancien ministre des Affaires étrangères) |
Source : https://baoquocte.vn/ngoai-giao-viet-nam-truong-thanh-qua-nhung-bai-hoc-lich-su-200019.html




![[Photo] Action for the Community raconte des histoires de parcours initiatiques – à la fois intimes et grandioses, mais aussi discrets et déterminés](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763179022035_ai-dai-dieu-5828-jpg.webp)


































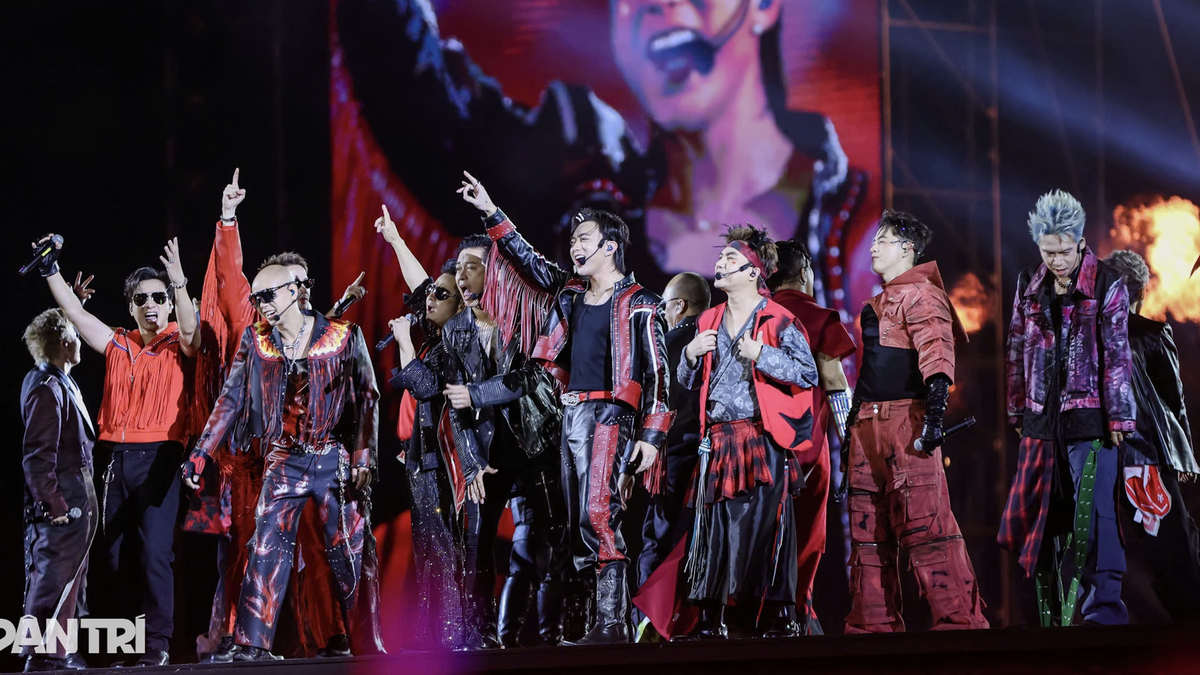








































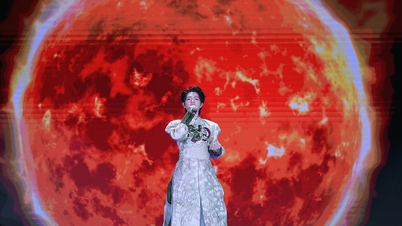





































Comment (0)