Il ne s'agit pas seulement d'exigences techniques pour une élection, mais aussi de normes spirituelles, de valeurs sociales et de comportements culturels qu'il faut créer et cultiver afin que l'esprit du Parti soit en harmonie avec le cœur du peuple, afin que les votes deviennent l'énergie nécessaire pour promouvoir l'aspiration à développer un Vietnam fort et prospère au cours du nouveau mandat.
La culture démocratique : des droits aux responsabilités
Dans son discours, le secrétaire général To Lam a souligné une vérité qui est devenue le fondement de notre régime : « Tout pouvoir appartient au peuple ; notre État est du peuple, par le peuple et pour le peuple . » Mais ce qui est plus remarquable encore, c’est l’esprit culturel qui se cache derrière cette affirmation : une culture démocratique, une culture de confiance, de responsabilité et d’aspiration à construire l’avenir du pays par son propre vote.
Le vote, comme l'a déclaré le Secrétaire général , est « un symbole fort de confiance, de la force de l'unité nationale, du sens des responsabilités et de la volonté de notre peuple de maîtriser son pays ». Il n'est pas seulement un instrument juridique, un droit constitutionnel, mais avant tout un acte culturel. Une nation n'est véritablement forte que lorsque la culture démocratique imprègne chaque citoyen, de sorte que chacun comprenne que voter, c'est choisir non seulement ses représentants, mais aussi la voie de développement qu'il trace pour lui-même, sa famille et son pays.

Depuis de nombreuses années, nous nous sommes habitués à l'image du jour des élections comme une « fête pour tous ». Mais comme l'a souligné le Secrétaire général, l'enjeu est désormais de faire de cette fête non seulement un événement marquant, mais aussi porteur de sens. « Voter, ce n'est pas voter pour voter » , une formule simple qui exprime une exigence culturelle majeure : passer d'une participation passive à une participation active, d'une formalité à une réflexion approfondie, des intérêts personnels à la responsabilité collective.
La culture démocratique évoquée par le Secrétaire général ne se manifeste pas uniquement dans les bureaux de vote ; elle doit être cultivée bien en amont. Il s’agit d’un processus qui consiste à sensibiliser la population aux enjeux juridiques, à créer des espaces de dialogue avec les électeurs, à instaurer un dialogue constructif entre le gouvernement et les citoyens, et à diffuser les valeurs d’une discussion ouverte, transparente et respectueuse. Lorsque les citoyens comprennent la loi électorale, leurs droits et leurs devoirs, voter devient un acte conscient, et non une simple habitude ou une obligation formelle.

Dans un contexte de forte transformation numérique, le Secrétaire général a également souligné la nécessité de « promouvoir l’utilisation des technologies de l’information… afin de garantir la sécurité, la sûreté des réseaux et la confidentialité des informations » . Cela démontre que la culture démocratique actuelle est celle de l’ère numérique : gérer l’information de manière responsable, se méfier des fausses nouvelles et des arguments déformés, savoir utiliser le cyberespace comme un canal de participation à la vie politique , mais cela doit impérativement reposer sur la vérité et le droit.
Ce qui importe davantage, c'est que la culture démocratique ne se mesure pas uniquement au taux de participation électorale, mais doit être évaluée selon la qualité de cette participation : les citoyens comprennent-ils les candidats ? Suivent-ils leurs programmes ? Perçoivent-ils véritablement leur vote comme un engagement pour l'avenir ? Lorsque la culture démocratique est cultivée, le vote revêt le poids de l'intelligence, de la foi et de l'aspiration à l'épanouissement de chaque citoyen vietnamien.
Comme l’a affirmé le Secrétaire général, le succès des élections pour un seizième mandat « perpétuera la tradition démocratique du pays », et cette tradition ne peut être véritablement durable que si elle repose sur la maturité culturelle de chaque citoyen. La culture démocratique est le pouvoir d’influence d’un État de droit moderne – où le pouvoir n’est pas seulement conféré par le peuple, mais aussi préservé, contrôlé et cultivé par sa culture.
Culture représentative - grande unité nationale
Le secrétaire général To Lam perçoit la structure représentative non seulement comme un problème d'organisation, mais aussi comme une valeur culturelle : une culture de la diversité, du respect et de la solidarité dans les différences. Lorsqu'il affirme que l'Assemblée nationale et les Conseils populaires, à tous les niveaux, doivent être « le visage vivant du grand bloc de l'unité nationale », il ne s'agit pas simplement d'une exigence de proportion, de structure ou de répartition des professions. C'est une approche culturelle de la politique : la conviction que l'unité nationale ne peut se construire qu'en écoutant, en respectant et en représentant pleinement les différentes voix de la société.
La culture représentative transparaît clairement dans la demande expresse du Secrétaire général : garantir l’harmonie entre les jeunes délégués, les déléguées, les délégués issus des minorités ethniques, les intellectuels, les ouvriers, les agriculteurs, les chefs d’entreprise, les artistes, les dignitaires religieux, etc. Elle rappelle que le développement du pays n’appartient pas à un seul groupe ou à une seule classe, mais qu’il est le fruit des efforts conjugués de toutes les composantes de la société. C’est cette diversité qui insuffle vitalité, créativité et pérennité au système politique.

Mais la culture représentative ne se mesure pas uniquement par des chiffres ; elle se manifeste aussi par la qualité de notre dialogue. Lorsque le Secrétaire général a souligné que les conférences consultatives devaient se dérouler « démocratiquement, objectivement, publiquement et en toute transparence », il affirmait qu’un consensus social ne peut exister sans dialogue – un dialogue sincère, égalitaire et exempt de conflits d’intérêts ou d’obstacles invisibles.
Dans cet esprit, le processus de consultation n'est pas seulement une procédure, mais aussi un espace culturel où chacun peut exprimer librement ses opinions, où ses préoccupations, ses attentes et ses inquiétudes sont entendues et prises en compte dans la structure du pouvoir d'État. « Promouvoir la maîtrise du peuple tout au long du processus électoral », comme l'a souligné le Secrétaire général, est le fondement d'une culture politique mature qui respecte la participation et l'intelligence du peuple.
Cette culture du dialogue se reflète également dans la manière dont sont traitées les plaintes et les dénonciations des citoyens relatives aux élections. Le secrétaire général a clairement indiqué qu'environ 210 plaintes et pétitions étaient actuellement en attente et a demandé qu'elles soient « entièrement résolues en décembre », afin de ne pas les laisser s'enliser et de ne pas laisser le ressentiment s'installer au sein de la population. Il ne s'agit pas d'une simple gestion administrative, mais bien d'une culture de l'État de droit, où l'État valorise véritablement le droit de pétition des citoyens, les écoute attentivement, traite les problèmes avec patience et recherche patiemment un terrain d'entente.
Plus largement, une culture de la représentation et une culture du dialogue sont les conditions nécessaires à l'instauration de la confiance. La confiance ne se fonde pas uniquement sur les mots, mais aussi sur la capacité du système politique à refléter fidèlement les attentes, les valeurs et les besoins du peuple.
Comme l'a affirmé le Secrétaire général, le résultat d'une élection ne se limite pas à une liste de candidats élus, mais constitue la consolidation de « la force de la grande unité nationale », la poursuite du rapprochement du Parti et de l'État avec le peuple, et une évolution culturelle du système politique vietnamien. La culture représentative et la culture du dialogue sont donc à la fois la méthode et l'objectif de la construction d'un État de droit socialiste dans la nouvelle ère.
Culture du service public : discipline, intégrité et esprit de service
Si la culture démocratique en est le fondement et la culture représentative le visage, la culture du service public est l'âme de l'appareil d'État. Lors de la Conférence, le secrétaire général To Lam a longuement insisté sur les normes de comportement des cadres – ceux qui incarnent directement le pouvoir du peuple et assument la responsabilité de la protection des intérêts nationaux. Pour lui, la culture du service public n'est pas un concept abstrait, mais un système de valeurs clair : discipline, intégrité, responsabilité et audace d'agir pour le bien commun.

Le Secrétaire général a demandé d'éliminer résolument, dès le départ, les « opportunistes politiques, les assoiffés de pouvoir, les conservateurs, les factionnalistes, les opportunistes locaux, les personnes sans envergure et les individus sans scrupules ». Ces termes ne constituent pas seulement une mise en garde contre les risques liés au personnel, mais soulignent également une norme culturelle : le refus de la corruption au pouvoir, le refus de tout compromis avec les intérêts du groupe et l'intolérance face aux comportements contraires aux convictions du peuple.
Au contraire, l'équipe de délégués doit être choisie parmi ceux qui sont « véritablement exemplaires par leurs qualités et leurs compétences », qui font preuve de courage politique, de vision, d'esprit novateur, qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités. Tel est le modèle de la culture du service public à l'ère nouvelle : les cadres doivent non seulement posséder une expertise pointue, mais aussi une personnalité affirmée ; savoir gérer, mais aussi diriger, susciter des aspirations et instaurer la confiance au sein du peuple. Comme l'a réaffirmé le Secrétaire général, reprenant l'enseignement du président Hô Chi Minh : les représentants du peuple doivent « mettre de côté leurs propres intérêts pour le bien du pays, mettre de côté leurs propres intérêts pour le bien commun ».
C’est là le cœur même de la culture du service public : placer l’intérêt général au-dessus de l’intérêt personnel, l’intérêt national au-dessus des calculs locaux ; préserver en permanence la pureté de l’éthique du service public, considérant l’honneur, le prestige et la confiance du peuple comme le critère suprême de réussite. Une administration moderne ne peut être efficace que si la culture du service public devient une force intrinsèque, et non si elle se contente de s’appuyer sur des règles ou des ordres administratifs externes.
Plus en détail, le Secrétaire général a également insisté sur la nécessité d'une coordination fluide entre les agences du système politique, reposant sur une utilisation intensive des technologies de l'information, tout en garantissant la sécurité des données, des réseaux et la confidentialité des informations. Ceci témoigne également d'une culture organisationnelle rigoureuse : travailler avec rigueur, transparence et responsabilité sur chaque donnée, chaque processus et avec chaque personne. Cette culture du service public exige un professionnalisme exemplaire, un travail minutieux, « sans formalités, axé sur le travail concret, avec une attribution claire des personnes, des tâches et des échéances », comme l'a indiqué le Secrétaire général.
Tout cela démontre que le Secrétaire général établit une nouvelle norme en matière de culture du service public pour la période 2026-2031, une étape cruciale pour la réalisation de deux objectifs stratégiques centenaires. La culture du service public ne se limite pas à l'éthique des fonctionnaires ; elle constitue également le moteur du bon fonctionnement de l'appareil d'État et le fondement de l'harmonie entre l'esprit du Parti et les aspirations du peuple. Ainsi, le pays pourra entrer dans un nouveau cycle de développement à l'ère numérique, avec l'ambition de bâtir un Vietnam fort, prospère et épanoui, peuplé d'un peuple libre, chaleureux et heureux.
Et lorsque la culture démocratique, la culture représentative et la culture du service public seront unifiées en un tout, nous aurons une élection non seulement réussie sur le plan du processus, mais aussi sur le plan des valeurs – où chaque vote sera un acte culturel, chaque délégué une norme culturelle et chaque décision l’expression de la culture politique vietnamienne de la nouvelle ère.
Source : https://daibieunhandan.vn/ba-van-de-van-hoa-cot-loi-ve-cong-tac-bau-cu-nam-2026-10395870.html


![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-président du groupe Luxshare-ICT (Chine)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)




![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants d'enseignants exceptionnels](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)






![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le gouverneur de la province de Kanagawa (Japon), Kuroiwa Yuji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763204231089_a1-bnd-7718-5559-jpg.webp)





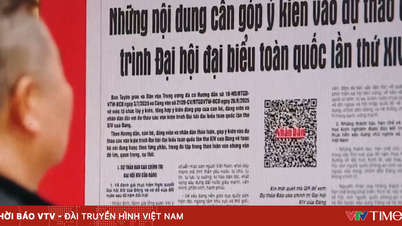


























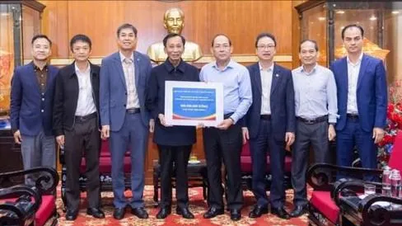







































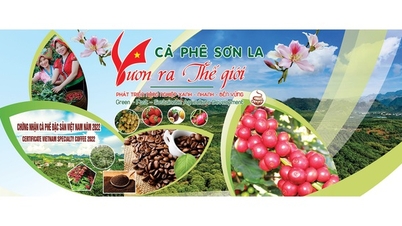


















Comment (0)