À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, la dynamique entre les deux principaux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, influence considérablement les relations sino-américaines. À cet égard, les experts estiment que l'analyse des points de vue des principaux conseillers des deux candidats peut contribuer à mettre en lumière les divergences dans leur approche de la Chine.
Après les conventions nationales républicaine et démocrate, tenues respectivement mi-juillet et fin août, les deux candidats se livrent une lutte acharnée pour la présidence. La vice-présidente américaine Kamala Harris s'est affirmée comme une candidate redoutable après le premier débat télévisé, devançant Donald Trump de 3 à 5 points dans la plupart des sondages au 15 septembre. Cependant, sa réputation en matière de politique étrangère, notamment vis-à-vis de la Chine, reste scrutée de près par les experts.

En réalité, le choix précipité de Mme Harris par les démocrates pour succéder à M. Biden ne lui a laissé que peu de temps pour élaborer une stratégie de politique étrangère globale. Bien que la Convention nationale démocrate ait publié un programme en août, M. Biden y figurait à peine parmi les candidats. Mme Harris est considérée comme inexpérimentée en matière d'affaires internationales, s'étant principalement concentrée sur les questions nationales tout au long de sa carrière politique.
Kamala Harris : entre fermeté et pragmatisme
Dans sa première interview depuis le lancement de sa campagne, accordée à CNN le 29 août, Mme Harris a déclaré qu'elle poursuivrait probablement la politique étrangère de M. Biden. Cependant, le choix de Philip Gordon comme conseiller à la sécurité nationale laisse entrevoir un possible changement de cap vis-à-vis de la Chine, l'approche pragmatique de M. Gordon pouvant différer de la position conflictuelle adoptée par l'administration Biden.
Les opinions de Gordon en matière de politique étrangère étaient profondément marquées par son opposition à la stratégie de changement de régime menée par l'administration Bush en Irak, stratégie qui, selon lui, avait nui à la réputation internationale des États-Unis. En tant qu'« internationaliste pragmatique », Gordon prônait un usage judicieux de la puissance américaine, arguant que l'efficacité de la politique étrangère américaine résidait non pas dans ses institutions, mais dans la qualité de son leadership. Sa vision européenne l'amenait à considérer la sécurité européenne comme un élément central de la puissance mondiale américaine, tout en reconnaissant que la Chine, et non l'Europe, était alors au cœur des politiques étrangère, militaire et économique américaines.
Pour bien comprendre la politique de Kamala Harris à l'égard de la Chine, il est essentiel d'examiner le point de vue d'une autre conseillère, Rebecca Lissner, conseillère adjointe à la sécurité nationale, qui a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la stratégie de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. Les travaux de Mme Lissner sur la stratégie de sécurité nationale de Biden montrent que les États-Unis reconnaissent la fin de l'ère post-Guerre froide et leur engagement dans une compétition stratégique avec la Chine, leur seul concurrent de même envergure. Cette stratégie réaffirme l'engagement des États-Unis en faveur d'un arsenal nucléaire préventif et d'une posture militaire forte, ce qui laisse penser que Kamala Harris pourrait poursuivre cette approche intransigeante si elle était élue.
Donald Trump : La politique étrangère sous un angle économique
Par ailleurs, si Donald Trump revenait à la présidence, il accentuerait probablement sa position « agressive » envers la Chine, en se concentrant notamment sur la compétition économique et technologique. Lors de la Convention nationale républicaine en juillet, des figures clés du parti ont manifesté leur soutien à un programme axé sur Trump en choisissant JD Vance comme colistier à la vice-présidence, soulignant ainsi l'engagement du parti à affronter la Chine. La nomination potentielle par Trump de personnalités comme Elbridge Colby et Robert Lighthizer, connus pour leurs positions intransigeantes sur la Chine, laisse penser que son administration privilégiera la domination économique et le progrès technologique des États-Unis, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'espace.
L’approche de Donald Trump vis-à-vis de Taïwan (Chine) reflète sa stratégie globale à l’égard de la Chine. Il envisage Taïwan sous un angle économique plutôt que politique et stratégique. Il perçoit Taïwan avant tout comme un marché pour les exportations d’armements américains et une source de technologies de semi-conducteurs. Ceci met en lumière la dimension économique de sa politique étrangère. Trump devrait maintenir les ventes d’armes à Taipei, mais sans augmenter les engagements américains en matière de défense. De plus, son administration pourrait réduire la présence stratégique américaine dans le Pacifique occidental et affaiblir les alliances menées par les États-Unis dans l’Indo-Pacifique, telles que le Quad, ou les engagements envers l’ASEAN. Les États-Unis privilégieront plutôt des mesures unilatérales visant à freiner la croissance économique et industrielle de la Chine par le biais de droits de douane et de sanctions punitifs.
Les préparatifs de Pékin
De son côté, Pékin est parfaitement conscient des enjeux considérables de la prochaine élection américaine. Quel que soit le vainqueur, la Chine devra vraisemblablement faire face à une position ferme de la part de la prochaine administration américaine.
Si Kamala Harris devient la première femme présidente des États-Unis, Washington verra vraisemblablement Pékin s'efforcer de maintenir les accords conclus entre la Chine et les États-Unis sous la présidence de Joe Biden, notamment par le biais de mécanismes tels que le sommet de l'APEC organisé par le Pérou et le sommet du G20 organisé par le Brésil fin novembre. Cette stratégie vise à consolider les récents efforts diplomatiques des démocrates, comme en témoignent la visite du conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, à Pékin fin août et la volonté des États-Unis de solliciter la coopération de la Chine sur les principaux conflits géopolitiques ainsi que sur les défis socio-économiques internes des États-Unis.
Cependant, Pékin se prépare également à l'éventualité d'une réélection de Donald Trump. Dennis Wilder, ancien expert de la Chine à la CIA et conseiller principal pour l'Asie à la Maison-Blanche sous George W. Bush, a déclaré que Pékin « recherchait activement des opportunités » pour entrer en contact avec l'équipe de campagne de Trump. Pékin souhaitait notamment utiliser Cui Tiankai, ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, comme intermédiaire, mais sans succès.
Selon les experts, Pékin devrait poursuivre son dialogue avec l'équipe de Donald Trump tout en renforçant ses liens avec la Russie et l'hémisphère Sud. La Chine pourrait encourager l'autonomie stratégique des alliés des États-Unis, notamment l'Union européenne, en leur offrant des incitations économiques et en accélérant la conclusion d'accords commerciaux. Par ailleurs, elle pourrait engager des négociations économiques avec les États-Unis, acceptant de sacrifier certains gains économiques en échange d'avantages stratégiques dans le Pacifique occidental.
L'issue de l'élection présidentielle américaine de 2024 aura des répercussions profondes sur l'évolution des relations sino-américaines. Que ce soit sous une administration Kamala Harris ou Donald Trump, Pékin devra se préparer à une période difficile, marquée par une concurrence stratégique et économique intense. Dans ce contexte complexe, l'équilibre des pouvoirs mondiaux sera fortement influencé par les politiques et les décisions du prochain occupant de la Maison-Blanche.




































![[Photo] Défilé pour célébrer le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)















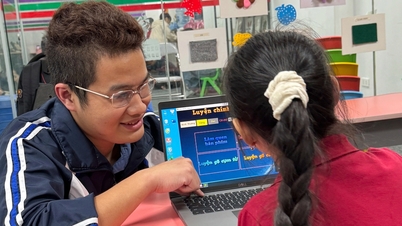

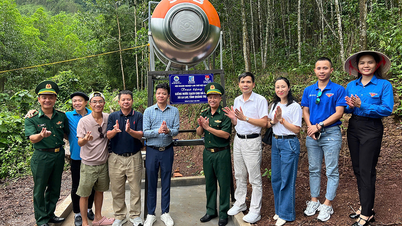





![[VIMC 40 jours à une vitesse fulgurante] Le port de Hai Phong déterminé à percer et à atteindre son objectif de 2 millions d'EVP d'ici 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764816441820_chp_4-12-25.jpeg)




























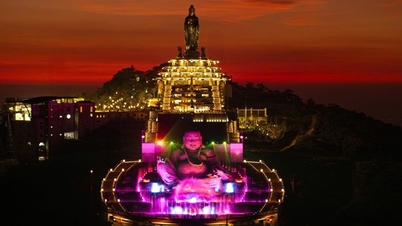



























Comment (0)