Le 25 novembre au matin, le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a présenté à l'Assemblée nationale la proposition du gouvernement relative au Programme national ciblé de modernisation et d'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation pour la période 2026-2035 (le Programme). S'il est approuvé, le secteur de l'éducation disposera des ressources nécessaires pour moderniser en profondeur le système éducatif national, induisant ainsi des changements fondamentaux et significatifs dans la qualité de l'éducation et de la formation et garantissant l'égalité d'accès à l'éducation.
Ensemble d'investissement révolutionnaire
Le programme vise à mettre en œuvre les politiques du Parti, les lois de l'État, les stratégies, la planification et les plans de développement socio -économique du pays en général et du secteur de l'éducation en particulier ; il s'attache tout particulièrement à promouvoir les acquis et les résultats obtenus par le passé et à se concentrer sur les questions urgentes qui présentent encore de nombreuses difficultés et obstacles, nécessitant un soutien du budget de l'État pour réaliser des progrès significatifs.
La période de mise en œuvre du Programme est de 10 ans, de 2026 à 2035, divisée en 2 phases. La phase 2026-2030 est axée sur la résolution des limitations et des défis rencontrés par le passé ; la mise en œuvre et la réalisation de tout ou partie d'un certain nombre d'objectifs clés nécessitant un soutien du budget de l'État, définis d'ici 2030 dans la résolution n° 71-NQ/TW et les réglementations connexes.
Pour la période 2031-2035, la mise en œuvre des tâches et des objectifs fixés à l'horizon 2035 se poursuit. Des objectifs spécifiques de normalisation et de modernisation de l'ensemble du système d'éducation et de formation, visant une transformation profonde et durable de la qualité de l'enseignement et de la formation, sont également définis. Le budget total mobilisé pour la mise en œuvre du Programme sur la période 2026-2035 s'élève à environ 580 133 milliards de VND.
Le professeur agrégé Tran Thanh Nam, vice-recteur de l'Université d'éducation (Université nationale de Hanoï), a déclaré que ce programme marque la transition vers une éducation de qualité supérieure, moderne et équitable, au service de l'essor du Vietnam dans l'économie du savoir. Il témoigne de la détermination à mettre en œuvre les orientations stratégiques de la résolution 71-NQ/TW du Politburo et nous donne l'élan nécessaire pour sortir du piège du revenu intermédiaire.
L'un des objectifs principaux du Programme est de standardiser 100 % des établissements d'enseignement préscolaire et général d'ici 2035, en résolvant définitivement la situation actuelle de 3 000 salles de classe prêtées ou équipées et de 2 500 salles de classe en situation d'urgence. Il ne s'agit pas seulement de construire des bâtiments, mais aussi de restructurer les espaces d'apprentissage selon le modèle STEM/STEAM, en abandonnant toute logique de subvention dans l'allocation des ressources.
Le deuxième axe prioritaire est une transformation numérique globale visant à former 95 % des enseignants et 70 % des élèves à l'IA et aux technologies éducatives d'ici 2030. Ceci créera un système d'« éducation adaptative », dans lequel l'IA jouera le rôle d'assistant pédagogique selon des normes éthiques et des responsabilités définies par les humains, libérant ainsi les enseignants pour guider et développer la pensée créative.
Partageant le même avis sur ce plan d'investissement novateur, le professeur agrégé Dr. Le Hoang Anh, chef du département de technologie financière de l'université bancaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le plan d'investissement de 580 133 milliards de VND sur 10 ans était tout à fait raisonnable dans le contexte budgétaire actuel.
Il a indiqué que le budget de l'éducation devrait atteindre 630 000 milliards de VND d'ici 2026, soit au moins 20 % des dépenses totales du budget de l'État. Concernant la structure du capital, il a constaté que la répartition des responsabilités entre les différents niveaux est relativement équilibrée : le budget central représente 60,2 %, les budgets locaux 19,9 % et les fonds propres des établissements d'enseignement 15,4 %.
Le professeur agrégé Le Hoang Anh a ajouté que le plan d'investissement gouvernemental était divisé en cinq projets : un projet d'amélioration des infrastructures d'enseignement général doté d'un capital de 202 000 milliards de VND ; un projet de modernisation de l'enseignement professionnel doté d'un capital de près de 60 000 milliards de VND ; et un projet d'amélioration des infrastructures des établissements d'enseignement supérieur doté d'un capital de 277 000 milliards de VND. Le projet de développement du corps enseignant, à lui seul, représente un investissement total de 38 800 milliards de VND.

Examinez attentivement la structure des coûts et définissez clairement le contenu de l'investissement.
Mme Tran Thi Thuy Ha, chef du département de la culture et de la société du comité populaire du quartier de Hoa Xuan (ville de Da Nang), a déclaré que l'investissement public reflète le niveau d'attention que l'État porte aux infrastructures, créant ainsi une base pour le développement culturel, économique et éducatif.
Dans le domaine de l'éducation, les importants investissements publics consacrés à la construction et à la modernisation des écoles et des équipements témoignent non seulement de l'engagement du système, mais contribuent également à réduire les disparités régionales, à garantir l'équité sociale et à améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage. « Si l'investissement public bénéficie de l'attention qu'il mérite et si les infrastructures sont assurées, la qualité de l'éducation s'améliorera considérablement », a affirmé Mme Ha.
Il est toutefois nécessaire de trouver un équilibre entre les investissements publics et les dépenses courantes consacrées à l'éducation. Selon le projet, ces dernières ne représentent que 12 % du budget dans un premier temps et 7,5 % dans un second temps. Or, elles comprennent non seulement les salaires, mais aussi les dépenses d'entretien, de maintenance, de matériel pédagogique, d'équipement, de formation continue et de perfectionnement des enseignants. Dans d'autres pays, les dépenses courantes atteignent 75 à 80 % du budget total de l'éducation. « Au rythme actuel, il est très difficile de former les enseignants à l'utilisation des équipements modernes dans les écoles », a-t-elle averti.
Selon Mme Tran Thi Thuy Ha, il est nécessaire de clarifier les critères du programme de construction d'« écoles modernes ». Le concept actuel demeure flou et ne précise pas clairement ce qu'implique une école moderne : infrastructures, personnel, programmes, documents, matériel pédagogique et équipements. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce programme requiert la révision et l'harmonisation des réglementations antérieures relatives à l'acquisition et à l'équipement des infrastructures.
Par exemple, les écoles maternelles doivent aujourd'hui se doter de matériel pédagogique, de jouets et d'équipements conformes à la circulaire 02, même si ces derniers sont obsolètes et inadaptés aux besoins actuels d'enseignement et d'apprentissage. Faute de cadre légal, les établissements scolaires ne pourront pas s'équiper correctement, ce qui compliquera également l'accès du personnel enseignant aux normes actuelles.
D'après Mme Tran Thi Thuy Ha, l'investissement foncier est également crucial pour la construction d'écoles et de salles de classe, notamment en milieu urbain. Dans le quartier de Hoa Xuan, les écoles sont actuellement surchargées, et les fonds fonciers destinés à la construction de nouvelles écoles sont presque épuisés.
Mme Ha a demandé : le plan d’investissement prévoit-il l’acquisition de terrains pour l’éducation ou se concentre-t-il uniquement sur la construction d’infrastructures ? Même investir dans la construction d’écoles en zones montagneuses n’est pas chose aisée, car de nombreuses régions comptent plusieurs petites écoles. « Si l’on ne construit qu’un seul grand établissement au centre, les élèves des petites écoles n’en bénéficieront pas. L’essentiel est de trouver le moyen de rendre l’école aussi proche et pratique que possible pour les enfants », a analysé Mme Ha.
Mme Tran Thi Thuy Ha a déclaré qu'il est nécessaire de prendre en compte l'incohérence entre les critères des écoles aux normes nationales et l'objectif de construction d'écoles modernes. Actuellement, le taux d'écoles aux normes dans les centres-villes et les zones urbaines est inférieur à celui des zones périurbaines, ce qui démontre que la méthode d'affectation ne reflète pas les besoins réels. Par ailleurs, la détermination des niveaux d'investissement pour chaque unité et région doit être clairement définie, en fonction des caractéristiques spécifiques et des besoins réels de chaque localité.

Par conséquent, selon le chef du département de la Culture et de la Société de l'arrondissement de Hoa Xuan, l'investissement public dans l'éducation est indispensable, tant au niveau des infrastructures que de l'équité sociale. Toutefois, il est nécessaire d'examiner attentivement la structure des coûts, de définir clairement le contenu de l'investissement, de mettre à jour la réglementation relative aux équipements et aux achats, et de tenir compte des spécificités de chaque région. Ce n'est qu'après avoir clarifié ces points que le plan d'investissement sera véritablement efficace et contribuera à améliorer la qualité de l'éducation, conformément aux objectifs nationaux.
Par ailleurs, M. Vo Dang Chin, directeur de l'école primaire et secondaire internat de Tra Nam pour les minorités ethniques (commune de Tra Linh, ville de Da Nang), a déclaré que dans les zones montagneuses, il est nécessaire de reproduire le modèle d'internat inter-niveaux que l'État s'efforce de mettre en place dans les communes frontalières.
« Dans les écoles de village, où l’enseignement se déroule en deux sessions par jour avec un seul professeur, sans enseignants spécialisés pour des matières telles que la musique, les langues étrangères, l’éducation physique, l’informatique, etc., les élèves ne peuvent pas se développer pleinement sur les plans culturel, artistique et sportif. Une fois leurs études terminées, ils n’ont ni accès à leurs amis ni possibilité d’étudier en groupe, ce qui rend difficile l’amélioration régulière de leur vietnamien », a analysé M. Vo Dang Chin.
Chaque école de village ne compte qu'une vingtaine d'élèves, mais doit disposer d'au moins un enseignant. Par ailleurs, si des élèves sont transférés dans l'établissement principal, l'école n'a pas à disperser ses ressources et bénéficie des conditions nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement général et garantir l'égalité des chances à tous les élèves.
Par ailleurs, lors de l'acquisition de matériel et d'outils pédagogiques, il est également nécessaire de revoir les perspectives d'investissement, le secteur de l'éducation et de la formation préconisant d'investir dans la construction d'écoles intelligentes. Ces écoles peuvent ainsi remplacer les expériences réelles par des expériences virtuelles, des modèles de simulation, etc.
Toutefois, pour appliquer efficacement les technologies de l'information et l'intelligence artificielle dans l'enseignement, il est nécessaire d'investir davantage dans la formation des enseignants afin d'éviter qu'ils n'abusent des présentations au lieu d'écrire au tableau ; un mécanisme d'évaluation clair et une motivation pour le développement de carrière sont également nécessaires.

Utilisation efficace et surveillance étroite des ressources
D'un point de vue professionnel, le professeur agrégé Tran Hoai An, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil de l'Académie d'aviation du Vietnam (Hô-Chi-Minh-Ville), a déclaré que le capital total de plus de 580 000 milliards de dongs sur dix ans représente un investissement considérable, bien supérieur aux programmes précédents, témoignant de la priorité accordée par le gouvernement à l'éducation et à la formation. Il a toutefois précisé que la faisabilité et l'efficacité globale de cet investissement dépendront fortement de la structure du capital, du mode d'allocation des fonds et du mécanisme de mise en œuvre.
En ce qui concerne la structure du capital, bien que le capital du budget central représente la majorité (environ 60,2 %), contribuant à réduire la pression sur les budgets locaux, le professeur agrégé Dr Tran Hoai An a souligné deux défis majeurs.
Premièrement, obtenir une source de financement de plus de 580 billions de VND provenant des dépenses publiques totales sur 10 ans constitue un défi majeur, alors qu'en réalité, la part des dépenses du budget de l'État consacrée à l'éducation au Vietnam n'atteint souvent pas le niveau minimum de 20 % des dépenses budgétaires totales prescrit par la loi sur l'éducation.
Deuxièmement, le mécanisme de contrepartie en capital exige que les universités et les établissements de formation professionnelle mobilisent jusqu'à des dizaines de milliers de milliards de VND (Phase 1 : 20 429 milliards de VND ; Phase 2 : 68 645 milliards de VND), ce qui est considéré comme irréalisable pour de nombreuses écoles publiques.
En ce qui concerne l'allocation des capitaux, il a analysé que l'enseignement supérieur a reçu la plus grande part de capital, soit 227 000 milliards de VND (représentant près de 47,75 % du capital total sur 10 ans), dans le but de moderniser les principaux établissements d'enseignement supérieur pour atteindre les normes régionales et mondiales, créant ainsi des percées dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation.
Ce changement stratégique montre une feuille de route et une orientation vers une réflexion sur l'investissement, la phase 2 (2031 - 2035) déplaçant l'attention vers l'enseignement supérieur, lorsque la proportion grimpe en flèche pour atteindre 52,47 % du capital total de la phase.
Toutefois, le professeur agrégé Tran Hoai An a exprimé sa profonde inquiétude quant au déséquilibre de la structure des investissements : les investissements publics (construction, modernisation des infrastructures, acquisition d’équipements) représentent une part trop importante du capital total, soit respectivement 83,9 % et 90,3 % lors des deux phases, ce qui engendre des risques de dispersion et de gaspillage. Parallèlement, les dépenses courantes (investissements dans le personnel, tels que les salaires, la formation et la recherche fondamentale) ne représentent que 10,9 % et 5,5 %, illustrant ainsi le déséquilibre entre les investissements dans la « qualité » (le personnel) et la « quantité » (les infrastructures).
Concernant la part du budget consacrée aux investissements, la proposition prévoit que le budget central représente 60,2 %. Le professeur agrégé Tran Thanh Nam a déclaré que cela démontre le rôle de pilotage et d'orientation du gouvernement dans le cadre d'un programme national.
Il a proposé qu'au lieu de répartir le budget uniformément, le budget central se concentre sur 20 % des projets qui génèrent 80 % de l'impact. La part des budgets locaux doit être étudiée afin de mettre en place des mécanismes clairs, faute de quoi cela risque de creuser les inégalités en matière de qualité de l'éducation et de constituer un déni de responsabilité.
Parallèlement, il convient d'établir des règles minimales concernant le pourcentage du budget local consacré à l'éducation si la collectivité souhaite bénéficier du budget de l'État. Concernant la part du financement allouée aux universités et aux établissements d'enseignement supérieur, une étude devrait être menée afin de les classer et de s'assurer qu'elle ne dépasse pas les capacités financières de ces établissements dans les différentes filières.
Il convient d’encourager des mécanismes de partenariat public-privé (PPP) substantiels. D’autres sources de financement devraient être gérées, notamment par le biais du Fonds vietnamien d’innovation pour l’éducation, grâce à la privatisation partielle des actifs éducatifs, l’émission d’obligations éducatives, la mobilisation de ressources financières internationales préférentielles et l’apport de capitaux provenant de l’aide publique au développement (APD).
« Par ailleurs, le principal point aveugle réside dans la nécessité d’établir une matrice des risques de duplication entre les projets du programme et d’autres programmes nationaux, tels que le Programme national ciblé pour le développement socio-économique des zones montagneuses et des minorités ethniques, ou le Programme national de transformation numérique en cours de mise en œuvre. Il est indispensable de désigner un responsable chargé d’examiner les doublons afin d’éviter tout gaspillage. »
Le capital de 580 133 milliards de VND est relativement faible comparé aux 3,5 % du PIB consacrés à l’éducation. Un usage judicieux de ces ressources permettrait à l’économie de profiter pleinement de la période de forte croissance démographique. Face à l’augmentation des ressources, l’enjeu principal est de les gérer et de les utiliser efficacement, en évitant tout gaspillage.
« Si nous construisons des bâtiments, achetons du matériel et que nous l’abandonnons ensuite faute d’enseignants possédant des compétences numériques, d’entreprises disposées à coopérer, d’une culture de l’innovation, d’une passivité opérationnelle…, notre système éducatif sera comme un géant sans âme », a souligné le professeur agrégé Dr Tran Thanh Nam.
Afin de garantir la faisabilité et une efficacité durable, M. Tran Hoai An a souligné que le gouvernement devait rééquilibrer la structure du capital, augmenter la part des dépenses courantes (investissement dans les enseignants, le personnel de direction et la recherche scientifique) et, en même temps, mettre en place un mécanisme de soutien financier approprié pour les écoles publiques.
Le professeur agrégé Tran Hoai An a proposé de porter la part des dépenses courantes de 10-15 % actuellement à un minimum de 30-40 % du capital total, l'objectif à long terme étant de 60 % de capital d'investissement public et 40 % de dépenses courantes. Concernant les critères de priorité, le capital d'investissement public devrait être alloué de manière à combler intégralement les déficits dans les zones difficiles ou à se concentrer sur les projets clés, en évitant sa dispersion.
L’allocation des capitaux doit être liée à des indicateurs clés de performance (ICP) spécifiques et mesurables, et passer d’un mécanisme de financement basé sur les subventions à un mécanisme basé sur la performance.
Il a également plaidé pour une allocation prioritaire des ressources aux programmes de formation, l'amélioration des qualifications professionnelles, notamment en langues étrangères et en technologies de l'information/transformation numérique pour les enseignants ; l'augmentation des dépenses courantes afin de revaloriser les salaires de base et les indemnités des enseignants (niveau d'indemnité proposé : 70 % ou plus) ainsi que la construction de logements sociaux de qualité. Enfin, il est nécessaire de renforcer le contrôle indépendant et de définir et quantifier clairement les objectifs afin d'éviter la dispersion et les inefficacités.
Du point de vue des enseignants, le professeur agrégé Dr Le Hoang Anh estime que la structure d'allocation actuelle du programme est encore orientée vers l'investissement dans les infrastructures, sans accorder suffisamment d'attention au facteur décisif de la qualité de l'éducation, à savoir le personnel enseignant.
Il a notamment souligné que, dans le contexte de l'éducation à l'ère du numérique, le personnel enseignant doit être pleinement doté de nouvelles capacités d'adaptation, allant de l'élaboration de programmes de formation à l'innovation dans les méthodes de réflexion et d'enseignement, en passant par les tests, l'évaluation et la conduite de recherches scientifiques.
Pour investir efficacement, il a recommandé que l'investissement dans les infrastructures s'accompagne d'un engagement en faveur d'un budget de maintenance à long terme et de programmes de formation pour les enseignants afin qu'ils exploitent et utilisent efficacement le matériel, évitant ainsi la situation où de nombreuses écoles, après avoir été équipées de matériel moderne, ne l'utilisent pas efficacement, le laissant « prendre la poussière ».
Projets composantes du programme
Projet 1 : Garantir que les installations et les équipements répondent aux exigences de mise en œuvre des programmes d’enseignement préscolaire et général.
Projet 2 : Moderniser l’enseignement professionnel pour accroître la taille et améliorer la qualité des ressources humaines qualifiées.
Projet 3 : Renforcement des infrastructures des établissements d’enseignement supérieur ; investissement dans la mise à niveau et la modernisation des principaux établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils soient au même niveau que dans la région et dans le monde, capables de former des ressources humaines de haute qualité, de réaliser des percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.
Projet 4 : Développer une équipe d'enseignants, de gestionnaires d'établissements d'enseignement, d'administrateurs de l'éducation et d'apprenants dans le contexte de la transformation numérique, de l'intégration internationale et de l'innovation globale dans l'éducation et la formation.
Projet 5 : Inspection, suivi, évaluation, formation et accompagnement des organismes de mise en œuvre du programme.
Source : https://giaoducthoidai.vn/nguon-luc-hien-dai-hoa-toan-dien-giao-duc-post758361.html


![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la 15e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764245150205_dsc-1922-jpg.webp&w=3840&q=75)



![[Photo] Le président Luong Cuong assiste aux célébrations du 50e anniversaire de la fête nationale du Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F27%2F1764225638930_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)












































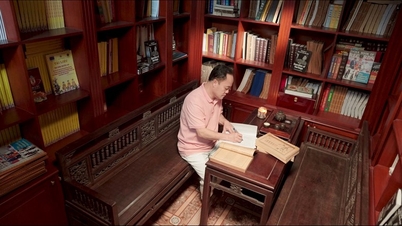























































Comment (0)