
Le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa délégation ont posé la première pierre de l'internat primaire et secondaire de la commune de Yen Khuong, dans la province de Thanh Hoa . Photo : Duong Giang/VNA
De plus, cet événement illustre comment nous préparons le terrain pour l'avenir du pays, dans le cadre des préparatifs du 14e Congrès national du Parti. Notre idéologie centrale, qui place le développement culturel et humain au même niveau que le développement économique, politique et social, n'est pas un slogan, mais une série d'actions concrètes et mesurables, même dans les régions les plus reculées. La cérémonie de pose de la première pierre de 72 internats de niveau intermédiaire, première phase du programme, devrait être achevée avant la rentrée scolaire 2026-2027. Cette étape importante témoigne de notre détermination à transformer la volonté politique en résultats concrets.

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre d'un projet d'école frontalière à Ha Tinh. Photo : Huu Quyet/VNA
Nouvelle « architecture sociale » pour les zones frontalières
En examinant de plus près les composantes des projets, on constate que le modèle d’« internat inter-niveaux » ne se limite pas à une simple solution d’infrastructure éducative. Il s’agit d’une nouvelle architecture sociale pour la zone frontalière : salles de classe, dortoirs, réfectoires, salles polyvalentes, bibliothèques et infrastructures techniques synchronisées. Chaque établissement peut accueillir entre 1 000 et plus de 1 200 élèves, ce qui permet de créer un véritable « pôle d’apprentissage ». Dans ces structures, les enfants n’ont plus à traverser les cours d’eau pendant la saison des crues ni à dormir dans des hébergements temporaires. Les repas, le sommeil, la santé, l’hygiène et la sécurité y sont standardisés selon un référentiel national.
Les paramètres d'investissement spécifiques dans des localités telles que Lao Cai (4 écoles cette fois-ci avec un investissement total de 945 milliards de VND, soit 28 à 36 classes par école), Lang Son (un projet initial de plus de 265 milliards de VND, soit une surface au sol de plus de 24 000 m²), ou encore des projets dans les régions du Nord-Ouest et des Hauts Plateaux du Centre… montrent que le problème a été soigneusement étudié pour non seulement « avoir des écoles », mais « avoir de bonnes écoles », c'est-à-dire garantir un niveau d'infrastructures de niveau 2 pour le secteur de l'éducation, jetant ainsi les bases d'un enseignement de qualité.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra en compagnie d'élèves dans la zone montagneuse de Lao Cai, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de quatre internats de niveau intermédiaire à la frontière de Lao Cai. Photo : VNA
L'importance capitale de cette décision réside dans le fait de placer l'éducation au cœur de la stratégie frontalière. La frontière n'est pas seulement une ligne géographique, mais aussi l'espace de vie des communautés ethniques, où l'identité se préserve et où la sécurité humaine et la sécurité culturelle sont intimement liées. Investir dans des internats de niveau intermédiaire dans les communes frontalières, c'est donc investir simultanément dans la sécurité sociale, la culture, la sécurité et l'économie. Un enfant Hong, Dao, Thaï, Ede, M'nong… qui peut rester à l'école, étudier toute la journée, manger dans un internat propre et sûr, avoir accès aux livres, aux technologies, au sport, aux arts… aura une plus grande probabilité de poursuivre sa scolarité, d'acquérir de meilleures compétences de base et constituera, lui seul, la main-d'œuvre qualifiée de la région frontalière dans les 10 à 15 prochaines années. Dès lors, « préserver le territoire dès sa racine » n'est plus un simple slogan pour les autorités, mais le fruit d'un écosystème social où l'école joue un rôle central.
Le second objectif est de réduire les inégalités d'accès aux ressources. Dans les zones de plaine, les enfants peuvent suivre des cours de soutien, apprendre des langues étrangères et se familiariser avec les outils numériques ; dans les zones montagneuses, un repas équilibré reste parfois un rêve. L'internat, s'il est bien organisé, est un outil pour égaliser les chances. L'État prend en charge les coûts que les familles les plus démunies ne peuvent assumer, créant ainsi les conditions d'un véritable programme d'apprentissage, et non d'un simple appel.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre du nouvel internat à Lang Son. Photo : Anh Tuan/VNA
Le troisième sens relève d'une dimension culturelle plus profonde : les internats des zones frontalières ne doivent en aucun cas être de simples copies de ceux du delta. Ils doivent constituer des espaces culturels et éducatifs intégrés, où l'identité est respectée, où la langue maternelle est valorisée aux côtés du vietnamien standard et des langues étrangères, et où les savoirs locaux (agriculture, tissage, instruments de musique traditionnels, rituels, connaissances ancestrales sur les forêts et l'eau) sont présentés comme un contenu précieux à intégrer dans les programmes scolaires.
À cette époque, les internats ne visent pas à estomper les différences, mais à créer un sentiment d'harmonie, forgeant une identité forte chez les jeunes des zones frontalières. Dès la conception, la construction et l'exploitation, il convient d'associer artisans, anciens du village et chercheurs en culture locale ; afin que la cour de réverbération résonne des sons du Khen et du Then ; que la bibliothèque propose des ouvrages bilingues ; que les repas soient composés de plats familiers pour les enfants ; que les fêtes traditionnelles trouvent leur place dans le calendrier scolaire. C'est ainsi que l'on éduque un peuple.
« Plateforme de lancement » pour une transformation numérique équitable
Le quatrième sens est celui de « tremplin » pour une transformation numérique équitable. Le projet de document du XIVe Congrès national réaffirme la nécessité de construire un système éducatif national moderne et équitable, répondant aux critères « standard – ouvert – flexible ». Chaque internat de niveau intermédiaire situé en zone frontalière devrait être conçu comme un « nœud numérique » : doté d'une connexion internet stable, d'une salle informatique, d'une bibliothèque numérique, d'une plateforme d'apprentissage en ligne, de la possibilité d'organiser des cours par simulation, d'un enseignement de base en sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques (STEAM), et d'un club d'innovation/startup à taille humaine. C'est ainsi que l'on permettra aux connaissances numériques de circuler là où elles sont le plus nécessaires. Il est indispensable d'élaborer rapidement un ensemble de critères minimaux pour l'infrastructure numérique de ces établissements, en parallèle avec la formation des enseignants à l'enseignement numérique.
Ces recommandations sont parfaitement compatibles avec la nouvelle résolution sur l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation, ainsi qu'avec la vision de la promotion de l'industrie culturelle à l'ère numérique, qui a été débattue à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale au cours des deux dernières années.
Cinquièmement, il s'agit d'un modèle d'« investissement d'amorçage » visant à mobiliser les ressources locales et à assurer une socialisation transparente. Un investissement étatique synchrone dans les infrastructures est une condition nécessaire. Une condition suffisante est la mise en place d'un mécanisme de fonctionnement ouvert permettant aux entreprises, aux organisations sociales et aux universités de « parrainer » chaque établissement scolaire, en fournissant le matériel, les ressources pédagogiques et les activités extrascolaires, selon un mécanisme de financement public supervisé.
Sixièmement, il s'agit de redéfinir les critères d'« excellentes écoles » pour les zones rurales et montagneuses. On a longtemps parlé de « ne laisser personne de côté », mais les investissements tombent souvent dans le piège d'un « nivellement superficiel et lent ». Cette fois-ci, privilégier les communes frontalières, opter pour le modèle internat inter-niveaux, investir de manière synchrone selon les normes du niveau 2 et se fixer pour objectif d'achever la phase 1 avant la rentrée 2026-2027 constitue une approche différente : ciblée, rapide et approfondie. Cela incitera le système scolaire public des zones difficiles à se conformer à des normes plus élevées, au lieu de se contenter du « minimum acceptable ».
Septième signification, d'un point de vue culturel et humain : les internats situés en zones frontalières peuvent devenir de « nouveaux centres culturels », des lieux de rencontre entre les connaissances scolaires et la vie communautaire. Le soir, le dortoir peut accueillir des activités d'art populaire ; le week-end, la cour de récréation se transforme en marché scolaire ; la bibliothèque devient un espace de lecture bilingue, donnant accès à un fonds documentaire ouvert sur les cultures ethniques. Dans de nombreux pays, ce sont ces internats isolés qui dynamisent l'espace culturel et artistique local.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a offert des cadeaux à des élèves issus de minorités ethniques de la commune frontalière d'Ia Rve lors de la cérémonie de pose de la première pierre d'un collège d'enseignement général dans la commune frontalière de Dak Lak. Photo : Ngoc Minh/VNA
Nécessité d'un mécanisme spécial d'attraction et de traitement pour les enseignants des zones frontalières
De cette vision découlent trois éléments qui devraient être directement intégrés au plan opérationnel dès la phase de fondation du projet.
Premièrement, il est essentiel de préparer l'équipe. Un dispositif spécifique de recrutement et de formation des enseignants des zones frontalières est nécessaire ; un programme régulier de formation continue sur les cultures ethniques, l'éducation inclusive, le numérique et le conseil scolaire est indispensable ; un système de rotation et de mentorat entre les écoles pédagogiques et les écoles classiques des zones urbaines est également requis. Deuxièmement, il faut standardiser les pratiques d'éducation, d'enseignement et de sécurité. Chaque école doit disposer de procédures claires en matière de nutrition, d'hygiène, de prévention des épidémies, de sécurité alimentaire et de prévention des violences et des abus ; d'un mécanisme de signalement et de gestion des incidents bien défini ; et d'un réseau de bénévoles et de parents impliqués. Troisièmement, il convient de créer un réseau de parrainages professionnels et culturels : un établissement urbain parrainé par un établissement frontalier ; une troupe artistique parrainée par un club d'art ; une entreprise technologique parrainée par un laboratoire STEM dans la zone frontalière. Si ces trois conditions sont remplies, l'internat deviendra un véritable second foyer.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung et sa délégation ont procédé à la pose de la première pierre d'un internat de niveau intermédiaire dans la commune frontalière de Minh Tan (Tuyen Quang). Photo : Duc Tho/VNA
Nous devons également relever ces défis de front. L'internat signifie que les enfants sont loin de leur famille et risquent de souffrir de solitude et de choc culturel si les institutions protectrices ne sont pas suffisamment solides. Dans ce contexte de promiscuité, une petite erreur (alimentation, maladie, sécurité électrique) peut avoir de graves conséquences. L'internat risque aussi d'entraîner une « urbanisation des modes de vie » en cas de manque d'orientation culturelle. Par conséquent, outre les investissements matériels, il est indispensable d'investir dans le « développement immatériel » : un cadre éthique et des normes de vie adaptés à l'école ; des programmes d'éducation à l'identité ; des mécanismes de participation des élèves ; et l'implication des parents et des aînés du village.
Entrer dans une nouvelle ère en investissant dans les personnes
En tant que membre de l'Assemblée nationale, je tiens à souligner le lien direct entre la décision d'aujourd'hui et les questions que nous débattons au cours du 14e Congrès.
Premièrement, si nous affirmons que « la culture et les individus constituent le fondement, les ressources, la force endogène et le principal moteur, le système régulateur du développement social durable », alors les écoles frontalières doivent être le « point de dépôt » spécifique de cette stratégie : un lieu où la dignité humaine, la discipline, l’esthétique, la langue, les compétences numériques et le désir d’apprendre sont cultivés au quotidien.
Deuxièmement, si nous voulons que la « science, la technologie et l’innovation » deviennent un pilier, investir dans les zones frontalières est le moyen de réduire dès le départ la « fracture numérique », car aucune plateforme numérique nationale ne peut être durable si elle ignore les 15 % de la population vivant dans des zones montagneuses, reculées et isolées.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a remis des cadeaux à des élèves des zones frontalières qui ont surmonté des difficultés pour réussir leurs études, lors de la cérémonie de pose de la première pierre d'un internat inter-niveaux à Lam Dong. Photo : Hung Thinh/VNA
Troisièmement, si l’objectif est « l’égalité et l’équité dans l’accès aux services publics », il n’y a pas de meilleur indicateur que le fait qu’un enfant vivant dans la zone frontalière bénéficie de repas, d’un sommeil, de cours et de possibilités d’apprendre des langues étrangères et de coder équivalents à ceux de ses pairs du centre-ville.
Quatrièmement, si l’on parle de « sécurité humaine – sécurité culturelle », personne ne peut mieux protéger la frontière que des citoyens instruits et fiers de leur identité.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a remis des cadeaux au lycée Luong An Tra lors de la cérémonie de pose de la première pierre d'écoles dans les communes frontalières de la province d'An Giang. Photo : Le Huy Hai/VNA
Et surtout, ce sont les pierres angulaires de la conviction que les enfants des minorités ethniques peuvent grandir dans des conditions d'apprentissage qui ne soient pas inférieures à celles des autres ; que la frontière n'est pas qu'une barrière géopolitique, mais une plaine riche en savoir, en culture et en opportunités ; que lorsque l'État affirme que « personne n'est laissé pour compte », cela se traduit concrètement par une école spacieuse, un internat chaleureux, une bibliothèque animée le samedi soir. À l'échelle nationale, c'est aussi une affirmation : le Vietnam entre dans une nouvelle ère en investissant résolument dans ce qu'il y a de plus fondamental : son peuple.
Les images du matin du 9 novembre témoigneront éloquemment d'une vision cohérente du développement : faire des zones difficiles un terrain d'expérimentation pour les politiques publiques, placer l'enfant au cœur des préoccupations et faire de la culture et de l'éducation un moteur de développement durable. Il est à espérer que, dans le programme d'action post-Congrès, le projet d'« internats de niveau intermédiaire dans les communes frontalières » devienne un pilier de la stratégie de développement des minorités ethniques et des zones montagneuses, étroitement lié à la transformation numérique de l'éducation, au développement des industries culturelles locales, à l'écotourisme culturel et à l'agriculture intelligente ; et, parallèlement, que ce modèle puisse être reproduit dans les communes insulaires et les zones côtières confrontées à de nombreuses difficultés.
Une fois la première pierre posée, la suite dépendra de la rigueur de l'exécution, de la transparence, de la participation de la communauté et de l'engagement des enseignants. Si nous agissons avec justesse et efficacité, à la clôture du 14e Congrès, dans le rapport de synthèse, nous pourrons sans aucun doute lire dans les yeux radieux des enfants de la frontière, le jour de leur rentrée dans la nouvelle école – des yeux qui nous confirmeront qu'investir dans l'humain est toujours un choix judicieux.
Source : https://daibieunhandan.vn/tu-cac-truong-hoc-vung-bien-den-tam-nhin-dai-hoi-xiv-cua-dang-10395027.html





















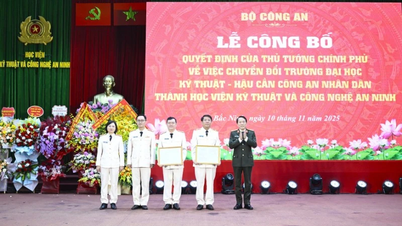






















































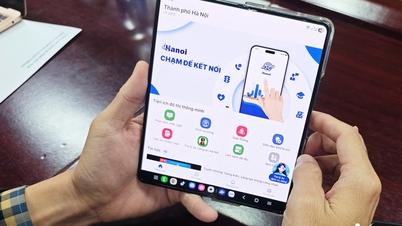
























![Transition de Dong Nai à l'OCOP : [Article 3] Lier le tourisme à la consommation de produits de l'OCOP](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/10/1762739199309_1324-2740-7_n-162543_981.jpeg)











Comment (0)