Le 22 juin, le président Donald Trump a annoncé sur le réseau social Truth Social que tous les avions américains participant à la campagne de frappes aériennes contre l'Iran étaient « rentrés sains et saufs » et a félicité « les grands guerriers américains ».
« Aucune autre armée au monde ne peut faire cela », a-t-il souligné, affirmant avec fierté la supériorité militaire absolue des États-Unis.
Cependant, sa déclaration ultérieure selon laquelle « l’heure est venue de faire la paix » a suscité des interrogations chez de nombreux observateurs. La paix ne peut véritablement être le fruit direct d’une attaque militaire de grande envergure sans une stratégie diplomatique préalable.
C’est dans cette contradiction interne que le message du président Donald Trump peut être compris comme une tactique de dissuasion à l’ancienne : forcer l’adversaire à choisir entre la paix aux conditions imposées par Washington, ou le risque d’une attaque plus sévère.
Frappe aérienne symbolique ou tournant décisif ?
La campagne militaire a été menée par les États-Unis à l'aide de moyens d'attaque de pointe :
Des avions furtifs B-2 ont largué au moins six bombes anti-bunker de 15 tonnes ;
Une trentaine de missiles de croisière Tomahawk ont été lancés depuis des sous-marins ;
Trois installations nucléaires iraniennes clés ont été attaquées : Fordow, Natanz et Ispahan.
Militairement, il s'agissait d'une frappe préventive stratégique, et non d'une simple représailles ou d'une démonstration de force. L'objectif des États-Unis semble être de paralyser, ou du moins de ralentir, le développement nucléaire iranien.
Mais selon l'orientaliste russe Andreï Ontikov, cette action présente également de nombreuses similitudes avec des campagnes précédentes qui visaient davantage l'impact médiatique que la mise en œuvre de changements militaires fondamentaux. M. Ontikov, faisant référence à l'assassinat du général Qassem Soleimani en 2020, a déclaré que les États-Unis réutilisent le même modèle : frapper fort pour marquer les esprits, sans pour autant nécessairement rechercher une guerre totale.
« Il s’agit d’un acte symbolique, à forte résonance politique , mais il est difficile d’induire des changements profonds si l’Iran ne réagit pas fermement », a commenté M. Ontikov au journal Izvestia.
Téhéran face à un dilemme
Suite à cette frappe aérienne américaine, l'Iran est confronté à trois choix stratégiques :
Une riposte militaire directe visant les forces américaines donnerait à Washington un prétexte pour déclencher une guerre à grande échelle.
Accepter des négociations aux conditions des États-Unis signifie perdre la face sur le plan politique intérieur et réduire son prestige régional.
Poursuivre les guerres par procuration, en ciblant des objectifs israéliens par le biais de forces telles que le Hezbollah, les Houthis... afin d'éviter une escalade directe avec les États-Unis.
Les premières indications laissent penser que Téhéran privilégie une troisième option : une riposte limitée et indirecte qui lui permettrait de conserver l’initiative sans créer de prétexte à une intervention américaine de grande envergure. Il s’agit d’un choix calculé, et aussi d’une manière de sauver la face dans une confrontation prolongée.
Israël face à la guerre entre Gaza et l'Iran et aux pressions exercées sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu
Il est impossible de dissocier l'intervention américaine de la campagne militaire israélienne au Moyen-Orient. La frappe aérienne s'inscrit dans un contexte de représailles aériennes entre Tel-Aviv et l'Iran, de tensions dans la bande de Gaza et d'affrontements avec le Hezbollah au Sud-Liban – forces appartenant à l'« axe de la résistance » dirigé par Téhéran dans la région.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu subit de fortes pressions, tant de l'opposition que de sa propre coalition au pouvoir, selon les analystes. La gauche critique l'accuse d'avoir entraîné Israël dans une série de campagnes militaires sans fin, tandis que l'extrême droite, son principal allié, lui reproche son manque de fermeté et sa trop grande faiblesse face aux menaces iraniennes et gazaouies.
« Le gouvernement Netanyahu est confronté à une profonde crise de confiance interne, et la campagne actuelle pourrait être une tentative de détourner l’attention vers l’extérieur pour maintenir sa position », a commenté Ontikov.
La frappe aérienne américaine contre l'Iran allait au-delà d'une simple action militaire : c'était un signe clair que le Moyen-Orient entrait dans un nouveau cycle d'instabilité, où la diplomatie était mise au pied du mur et où les mécanismes internationaux se révélaient impuissants face aux règles du jeu du pouvoir.
Pris en étau entre des pressions internes, des considérations électorales et les calculs stratégiques d'alliés comme Israël, Washington joue peut-être un jeu dangereux. La question n'est plus de savoir si l'Iran réagira, mais plutôt : comment le monde réagira-t-il si un conflit régional dégénère en crise mondiale ? Et alors, y a-t-il encore une chance de parler de paix ?
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/my-khong-kich-iran-dau-an-trump-va-ban-co-dia-chinh-tri-trung-dong-252895.htm





![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-Premier ministre et ministre de la Défense slovaque, Robert Kalinak](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763467091441_a1-bnd-8261-6981-jpg.webp)






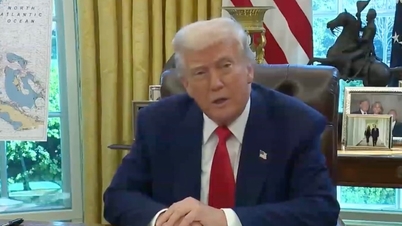






















![[CRITIQUE D'OCOP] Vermicelles de riz Duong Van - La quintessence du village artisanal de Hoang Dat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/18/1763460492510_review-ocop-mie-w1200t0-di2546d245d2170303t11920l1-525e8fd67833f466.webp)
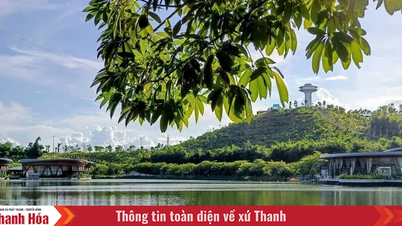























































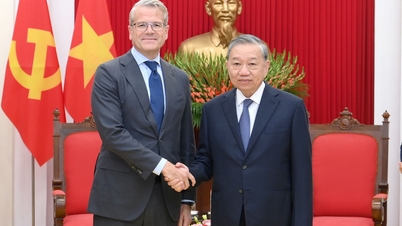





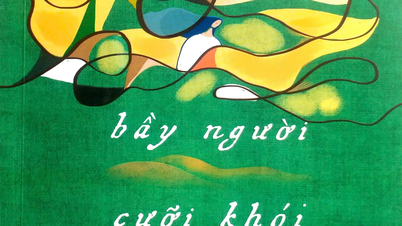












Comment (0)