Pour les calculs à l'unité, les habitants du delta du Mékong utilisent couramment la méthode « article/pièce ». Par ailleurs, certains objets ou types d'objets sont spécifiques : la médecine traditionnelle est comptée comme « thang » (enveloppé dans un carré de papier), le tabac à fumer comme « lang » ou « banh ». Le papier à rouler est compté en feuilles ; vendu au détail, il est découpé en morceaux dont la largeur correspond à la longueur d'une cigarette, puis roulé et appelé « dun paper » (papier dun).
La plupart des autres objets sont calculés en termes de poids, de mesure et de comptage, avec leurs propres caractéristiques culturelles étroitement liées à la production, à la vie professionnelle et aux conditions naturelles locales.
À propos de l'échelle
Pour les biens courants, selon la quantité, les anciens habitants du delta du Mékong utilisaient le kiem (50 g), le kg (12 kiem), le kg (1 000 g), le yen (6 kg), le tael (60 kg) et la tonne (1 000 kg). Par exemple, le charbon destiné à alimenter le four (qu’il s’agisse de charbon de mangrove ou de charbon mélangé) était mesuré en kiem.
Pour les bijoux en or, argent, cuivre, etc., utilisez une petite échelle, du plus petit au plus grand : ly, phan, chi, louong. Vous pouvez utiliser l’expression « Un côté pèse un demi-kilo, l’autre huit louong/lang » comme unité de conversion ; cela signifie que c’est égal.

Les femmes occidentales utilisent une balance pour peser les objets. Photo : DUY KHOI
Pour vendre des porcs entiers, on utilise une balance dans les plaines ; sur les marchés, on s’en sert également pour fixer le prix. Ce dernier varie selon le morceau de viande (gras, côtes, os de cuisse, etc.).
À propos des mesures
En Occident, on calculait le riz en boisseaux, on mesurait en pommes et on nivelait par unités (1 pomme = 20 litres ; 2 pommes = 1 boisseau). Plus tard, comme le marché vendait des barils de kérosène carrés en fer-blanc d'une capacité de 20 litres, on les appelait « barils » au lieu de « pommes ». Les ventes au détail se mesuraient au litre (aujourd'hui, on utilise des balances et on calcule au kilogramme).
Les produits agricoles comme les pommes de terre et les châtaignes d'eau sont calculés au boisseau, mesurés à la pomme et empilés. Les spécialités comme les moules bouillies (toute la chair) sont mesurées à la tasse. Les gros escargots (escargots pomme, escargots de laîche) sont vendus en bottes (aujourd'hui, ils sont pesés au kilogramme).

Quelques instruments de mesure. Photo : DUY KHOI
Les cendres de cuisine sont également utilisées comme engrais par les habitants du delta du Mékong. Les cendres de combustion du bois sont mesurées en grosses pommes (40 litres) et empilées. Les balles de riz et leurs cendres sont mesurées en sacs (les sacs en feuilles de palmier à bétel sont appelés « bao ca ron », et ceux en jute sont appelés « sacs de toile de jute »), qui peuvent être déchirés (sacs en bambou ou en roseau, d'une capacité de quelques boisseaux, munis de deux poignées pour faciliter le transport, ou d'une perche pour le transporter).
Lorsque les Occidentaux vendent du poisson frais aux marchands ambulants amarrés à l'étang, ils le pèsent à l'aide d'un panier en bambou très robuste, d'une contenance de sept tailles. Un panier de cette taille équivaut à sept petits paniers (« sàng »), et un petit panier peut contenir environ 40 kilos de poisson. À l'entrepôt ou au marché, on utilise une balance, généralement une balance à main (« giac »), plus avantageuse pour l'acheteur.
L'eau domestique est facturée par paires. Une paire d'eau correspond à deux seaux, chacun ne dépassant pas 20 litres. En fonction de la distance, la personne qui en a besoin négocie le prix avec le porteur. Si la livraison d'eau aux consommateurs se fait par bateau ou charrette, on parle d'« échange d'eau » et non de « vente d'eau ».
À propos des mesures
Lors de l'achat et de la vente de planches, le vendeur prend toujours des mesures supplémentaires et ne tient pas compte des éclats, des joints, des bords en diagonale, etc. Concernant les arbres, le prix est négociable en fonction de leur taille. La vente peut se faire à l'unité, en massif, en pépinière ou par l'acheteur lui-même. Si l'arbre est scié, la mesure est calculée en « volume de l'arbre » puis convertie en mètres ou en mètres cubes en fonction du « volume du bois sur pied ». Lors de la mesure, ne tenez pas compte des bords, des diagonales ni des éclats.
Autrefois, dans la campagne du delta du Mékong, la méthode traditionnelle consistait à mesurer les terres en prenant 10 coudées de côté (on parlait alors de « parcelle de dix coudées ») ou 12 coudées (on parlait alors de « parcelle de coudées coupées »). À chaque point de mesure, un arbre était planté pour marquer la limite. Lorsqu'il s'agissait de mesurer une rizière semée et de la confier à un riziculteur, la mesure était de 12 coudées. On arrachait alors une poignée de chaume sur 40 à 50 cm de profondeur, puis on enroulait plusieurs tours avec ce même chaume pour délimiter la parcelle. Si le propriétaire et le riziculteur s'accordaient sur « 12 coudées », c'est généralement parce que la riziculture était irrégulière : certaines parcelles étaient bien fournies, d'où l'appellation de « parcelle de coudées coupées ».
Le sable et les pierres de construction sont calculés au volume. Le bois de chauffage est coupé en morceaux d'environ 7,5 cm de long, empilé et mesuré en mètres carrés.
Le tissu se mesure au mètre et son prix dépend de sa largeur (autrefois, comme il était tissé à la main, sa largeur était réduite, généralement 8 pouces = 80 cm), on parlait alors de « tissu de huit pouces ». Quant à la soie, elle est vendue par écheveaux, chaque écheveau comptant pour une paire. Même pour la confection d'une chemise, on compte les paires : si vous souhaitez coudre un ensemble, vous devrez acheter deux paires.
À propos du comptage
Avec les feuilles de bétel, 20 feuilles comptent pour une douzaine, liées ensemble pour former un « op » ; 12 ops de ce type comptent pour une centaine, 1 000 pour mille (1 000 têtes complètes), et 10 000 pour dix mille (10 000 têtes complètes). « Assez de têtes » signifie ajouter un certain nombre ; par exemple, une douzaine de têtes complètes ne correspond pas à 10, qui serait « une simple douzaine », mais à 12, 14, 16… ; 100, 1 000, 10 000 têtes complètes sont également calculées sur cette base, ce qui est avantageux pour l’acheteur.
Fleurs de sesbania, pousses de courge, pousses de potiron… en général, les légumes et plantes sauvages sont vendus en bottes. Les nénuphars sauvages sont également vendus en bottes : quatre ou cinq tiges enroulées forment une botte ; le prix varie selon la longueur des tiges. Les nénuphars cultivés, dont les tiges sont aussi grosses qu’un doigt (nénuphars de Da Lat), sont vendus à l’unité.
Autrefois, les pastèques étaient vendues au marché par le producteur et l'acheteur, et leur poids était compté secrètement à l'aide de charrettes à buffles. Une charrette équivalait à environ 20 boisseaux de riz, calculés en fonction de la taille de la plus grosse pastèque, appelée « pastèque paire », puis venaient la première, la deuxième, la troisième ; les plus petites étaient appelées « pastèques râpées », tandis que les « dầu canh » (petites pastèques plates et difformes, utilisées uniquement pour la soupe) n'étaient pas comptabilisées. Le prix était négocié en fonction de la taille et de la qualité moyennes des pastèques. Aujourd'hui, les fruits sont vendus au marché, comptés, puis pesés à leur arrivée.
Les concombres sont vendus au panier ou à l'unité ; les melons mûrs (vendus au détail) sont vendus à l'unité. Les melons amers et les aubergines sont vendus au poids.
Les buffles et les vaches étaient vendus au poids, selon un accord mutuel. Autrefois, les poulets et les canards étaient souvent vendus au poids, notamment les canards d'élevage (par milliers). Lors de la vente des œufs de poule et de canard, on les comptait par dizaines. Les œufs de canard de Barbarie étaient plus chers que les œufs de canard locaux car ils étaient rares ; les œufs de canards d'élevage étaient les moins chers car ils étaient petits et provenaient de poules sans coq.
Les objets artisanaux tels que les articles en bois, la forge et la poterie ont des prix spécifiques qui varient selon les matériaux et le design. Du fait de leur volume, de leur poids et de la difficulté de leur transport, leur prix de détail est deux à trois fois supérieur à celui pratiqué à la ferme, à l'atelier ou en usine.
Les feuilles utilisées pour les toitures de chaume et les revêtements muraux (feuilles de cocotier fendues en deux) sont comptées à l'unité. Les tuiles et les briques de construction sont comptées par milliers, avec une petite marge (car certaines peuvent se casser ou s'ébrécher pendant le transport). Les hameçons sont également comptés par milliers, selon leur type.
Pour les produits « faits maison », ni le vendeur ni l'acheteur n'ont besoin de peser, de mesurer ou de compter, mais seulement d'estimer, de parler d'« achat et de vente par lots » (comme pour les légumes), ou de deviner implicitement puis de négocier (comme pour les fruits encore sur l'arbre : noix de coco, mangues, oranges, mandarines, etc.).
Comment calculer les formes de service courantes dans le passé
Pour la location de buffles et de bœufs destinés au labour ou au hersage, le calcul se base sur une « tat » (1 tat correspondant à une opération de labour ou de hersage), et le prix est calculé selon le tarif convenu. Le propriétaire fournit deux repas par jour aux buffles et aux bœufs. Pour le creusement de fossés, de tunnels ou le transport de terre pour les fondations d'une maison, le calcul se base sur le « volume inférieur » (terre non travaillée, encore meuble et non grumeleuse).
Le désherbage à façon est facturé à la journée. Le propriétaire doit collaborer avec le désherbeur pour donner l'exemple : s'il travaille vite, le désherbeur suivra et inversement. S'il ne peut pas s'en charger lui-même, il délègue cette tâche à une personne compétente.
Le coût des récolteurs de riz est calculé au « cong » (12 taels carrés). Selon la qualité de la récolte, le propriétaire paie le récolteur en grains de riz, généralement 1 gia par cong. Si la récolte est abondante, le tarif est de 1,5 gia par cong ; en cas de mauvaise récolte, il est de 0,5 gia par cong. Si l'unité de mesure est le tael, le propriétaire ajoute un peu plus.
La location de terres pour la culture du riz (riz saisonnier, une récolte par an) est calculée au prorata de la superficie. Le locataire paie le propriétaire en riz, lequel peut être converti en argent selon un accord préalable ou en fonction du cours du marché au moment de la récolte. La périodicité de cette conversion dépend de l'accord, généralement annuelle. La taxe foncière est versée par le propriétaire à l'État, qui la recouvre ensuite auprès du locataire. Après la récolte, le locataire peut cultiver lui-même le riz ou confier la culture d'une autre plante à un tiers. Lors de la restitution des terres, il doit les nettoyer (brûler les chaumes).
Si vous êtes salarié à la journée, on parle de salaire journalier. Quel que soit votre travail, l'employeur doit vous fournir du riz, trois repas par jour, ainsi que du thé, des gâteaux ou du café selon ses conditions. Si vous travaillez avec des produits, le prix est négocié pour chaque produit ou à chaque étape de sa transformation, conformément à l'accord.
Maçons, charpentiers, orfèvres… tous travaillent contre rémunération, calculée en fonction de l’objet. Les orfèvres, en plus de leur salaire, prennent également en charge les pertes : pour un objet en or d’une valeur d’un tael, ils déduisent une fraction de la perte (en réalité, s’ils sont habiles, ils ne perdront que quelques fractions d’un objet d’une valeur d’un tael).
Le vãn công désigne l'entraide villageoise lors de travaux (toiture, riziculture, etc.). Généralement, il n'y a pas de rémunération, mais le propriétaire doit prendre en charge les repas. Si le travail est trop pénible ou trop long, il peut envisager de verser une compensation financière ou de témoigner sa reconnaissance.
Certains aspects de la culture de gros dans le passé
Dans un esprit de solidarité, pour ceux qui sont trop pauvres pour avoir de l'argent, le vendeur est disposé à leur accorder un paiement à crédit, parlant de « vente à crédit », acceptant de payer pendant plusieurs mois ; parfois même « vente à crédit jusqu'à la saison des récoltes », laissant le soin de régler la facture sans ajouter d'intérêts jusqu'à la récolte du riz/du champ.
Cependant, les épiciers du quartier sont eux aussi à court de liquidités. S'ils pratiquent le crédit et que les clients tardent à payer, ils perdront leur capital. C'est pourquoi ils sont contraints d'écrire à la craie sur le mur : « Faible capital, pas de paiement à crédit, merci de votre compréhension ! »
Lorsqu'on vend au marché, les gens se méfient beaucoup de « l'achat et la vente en même temps », aussi, si une telle situation se produit, ils conseillent immédiatement : « Cent personnes vendent, dix mille personnes achètent. »
Une autre particularité culturelle qu'il ne faut pas négliger est que, lors de l'emballage des marchandises destinées à la livraison aux clients, les vendeurs ne font jamais de nœuds mais laissent toujours un lien de serrage à disposition des clients pour qu'ils puissent le défaire facilement.
Tous les éléments mentionnés ci-dessus présentent des aspects très méticuleux, mais sont considérés comme très libéraux, contribuant ainsi à former les caractéristiques uniques du marché du delta du Mékong.
NGUYEN HUU HIEP
Source : https://baocantho.com.vn/chuyen-can-dong-do-dem-va-net-van-hoa-cho-dbscl-a192575.html





![[Photo] Cat Ba - Île paradisiaque verte](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F04%2F1764821844074_ndo_br_1-dcbthienduongxanh638-jpg.webp&w=3840&q=75)





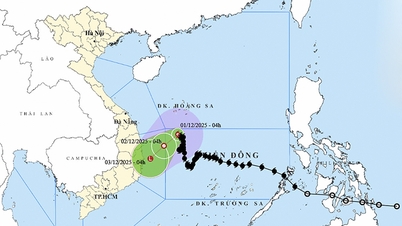


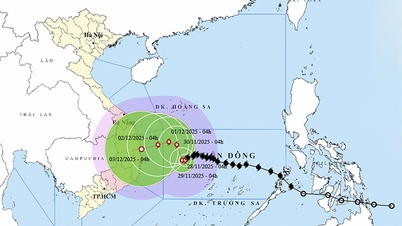






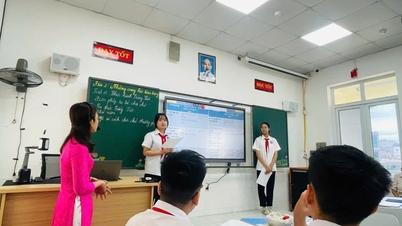









































![[VIMC 40 jours à la vitesse de l'éclair] Port de Da Nang : Unité - Vitesse fulgurante - Percée jusqu'à la ligne d'arrivée](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/04/1764833540882_cdn_4-12-25.jpeg)

















































Comment (0)