
Le durian dans les provinces occidentales - Photo : MAU TRUONG
Ces dernières années, le secteur agricole a réalisé d'importants progrès en matière de connexion entre la production et le marché. Cependant, de nombreux agriculteurs ignorent encore les informations disponibles et produisent en fonction de signaux de prix temporaires. Lorsque le marché s'inverse, les agriculteurs subissent toutes sortes de pertes.
La question demeure : « Que planter et que cultiver cette année ? »
« Que planter et que cultiver cette année ? » est une question que se posent de nombreux agriculteurs. La plupart des gens misent encore sur leurs rizières, leurs jardins et leurs étangs. Ils écoutent les informations sur les prix auprès des commerçants, de leurs connaissances ou des réseaux sociaux, puis décident de produire en fonction de leur intuition.
Quand le durian, le café, le fruit du dragon, les oranges, la canne à sucre ou le poisson tra ont de bons prix, les gens se précipitent pour les cultiver et les élever ; quand le marché se retourne, ils coupent les récoltes, « raccrochent les étangs » et abandonnent les champs.
Le cercle vicieux « planter – couper – élever – suspendre » n’est pas terminé, même si le secteur agricole a beaucoup parlé de transformation verte, de zones de matières premières, de codes de zones de culture ou de traçabilité.
La province de Hau Giang (qui fait aujourd'hui partie de Can Tho) possédait la plus grande zone de culture de canne à sucre du pays avec plus de 15 000 hectares, il n'en reste aujourd'hui que quelques hectares.
La « capitale du poisson-chat » exportait autrefois pour plus de 2 milliards de dollars américains, mais une année plus tard, le prix a chuté, forçant de nombreux éleveurs à abandonner leurs étangs. Le rêve d'exporter pour 10 milliards de dollars américains de crevettes reste un rêve.
La cause sous-jacente est que les informations sur le marché qui parviennent aux agriculteurs sont lentes et fragmentées.
En réalité, les agriculteurs manquent d'informations et de compétences pour analyser le marché. La plupart d'entre eux continuent de produire en se basant sur l'expérience et le ouï-dire, et non sur des données ou des prévisions. Ils produisent beaucoup de biens, mais ignorent qui les achète, où et à quel prix. Lorsque les prix chutent, ce sont souvent les agriculteurs qui en pâtissent.
Parallèlement, la planification et les prévisions restent rigides et lentes à s'adapter. De nombreux plans sont encore calculés en fonction des superficies et de la production, sans lien étroit avec la consommation. Lorsque les prix augmentent, les agriculteurs s'empressent d'étendre leurs superficies, dépassant ainsi les prévisions. Lorsque les prix baissent, ils les abandonnent. Les superficies consacrées à la culture du durian, de l'orange et du poisson-chat ont toutes connu une croissance rapide, dépassant les prévisions jusqu'en 2030, tandis que les infrastructures de conservation et les usines de transformation n'ont pas été développées à temps.
Un paradoxe réside dans le fait que de nombreux plans sont « élaborés et laissés là » sans mécanisme de suivi ni d'ajustement flexible. Lorsque le marché évolue, le plan reste inchangé, et les agriculteurs ignorent son contenu, son emplacement et sa date d'entrée en vigueur.
La réalité montre également que la chaîne de valeur reste fragile. L'agriculteur, premier maillon, reste le plus faible. Dans la filière du pangasius, les agriculteurs ne perçoivent que 10 à 20 % de la valeur, tandis que 70 % des coûts sont liés à l'alimentation animale et aux médicaments vétérinaires, dont la plupart sont détenus par des entreprises étrangères. Lorsque les prix sont élevés, les agriculteurs profitent peu ; lorsqu'ils baissent, ils supportent toutes les pertes.
De nombreux modèles associatifs ont été mis en place, puis… se sont effondrés faute de mécanismes contraignants et de partage des bénéfices et des risques. Le « mal » de l'offre excédentaire est diagnostiqué depuis de nombreuses années, mais le « remède » reste insuffisant. Nous devons changer d'approche, passer de « quoi planter, quoi cultiver » à « produire ce dont le marché a besoin et générer des profits ».
Les informations qui parviennent aux agriculteurs devraient être comparables aux prévisions météorologiques quotidiennes.
Il est temps de lancer une « transformation de l’information » dans l’agriculture, où les agriculteurs ne peuvent plus deviner, mais prendre des décisions basées sur des données réelles et des marchés réels.
Tout d'abord, nous avons besoin d'un système d'information agricole transparent et accessible. Le gouvernement, les associations et les entreprises doivent collaborer pour établir des cartes numériques des zones de production de matières premières, des prix, des saisons et de la demande du marché. Les informations doivent être régulièrement mises à jour et diffusées via les téléphones, les applications et les radios locales, comme les prévisions météorologiques quotidiennes.
Ensuite, nous devons améliorer la « culture numérique » des agriculteurs. La vulgarisation agricole ne doit pas se limiter aux techniques agricoles, mais aussi apprendre aux agriculteurs à lire des données, à signer des contrats électroniques, à vendre sur des plateformes de commerce électronique et à retracer l'origine de leurs produits.
Lorsque les agriculteurs seront propriétaires de l’information, ils ne se laisseront plus guider par les commerçants ou les rumeurs.
La planification agricole doit être numérisée et plus flexible. Au lieu d'une réglementation rigide des superficies, les zones de matières premières devraient être liées aux usines de transformation, la production devrait être liée à la consommation, et un mécanisme d'ajustement flexible devrait être mis en place en cas de fluctuations du marché.
Le modèle de riziculture de haute qualité et à faibles émissions d'un million d'hectares, associé à une croissance verte, mis en œuvre dans le delta du Mékong en est un bon exemple. Les agriculteurs peuvent y vendre non seulement du riz, mais aussi des crédits carbone, développer l'agrotourisme et créer de la valeur à partir de la même parcelle.
Les liens au sein de la chaîne de valeur doivent être solides. Les coopératives et les groupes coopératifs doivent être modernisés et dotés de la capacité de négocier, de signer des contrats et de partager les bénéfices et les risques. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant aux banques, aux entreprises et aux agriculteurs de s'asseoir à la même table, sans que chacun suive une direction différente.
Lorsque les agriculteurs seront autonomes grâce à la technologie et « entrepreneuriaux », ils ne seront plus de simples employés du marché, mais deviendront de véritables acteurs de l'économie agricole. Ils pourront calculer leurs profits et leurs pertes, prévoir les prix, choisir le moment de vendre, optimiser leurs exportations et protéger le fruit de leur travail par des contrats et des moyens légaux, et non par le hasard.
Pour parvenir à une agriculture durable, nous devons d'abord aider les agriculteurs à « ouvrir les yeux » sur le marché. Avec une information transparente, une planification flexible, des liens étroits et la technologie à la disposition des agriculteurs, la récolte ne sera plus un pari risqué.
Les agriculteurs qui comprennent le marché, savent utiliser les données et penser à long terme sont les seuls à pouvoir espérer une agriculture moderne et à s’engager dans le monde en toute confiance.
Source: https://tuoitre.vn/dua-thong-tin-den-nong-dan-phai-cap-nhat-thuong-xuyen-nhu-du-bao-thoi-tiet-2025102210220403.htm



![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside une réunion sur la construction d'une centrale nucléaire](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761137852450_dsc-9299-jpg.webp)

![[Photo] Da Nang : les forces de choc protègent la vie et les biens des personnes contre les catastrophes naturelles](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761145662726_ndo_tr_z7144555003331-7912dd3d47479764c3df11043a705f22-3095-jpg.webp)

![[Photo] Cérémonie de remise des prix du concours politique sur la protection des fondements idéologiques du parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/22/1761151665557_giaia-jpg.webp)













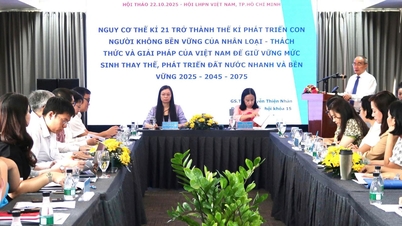













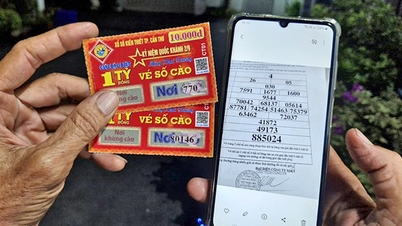























































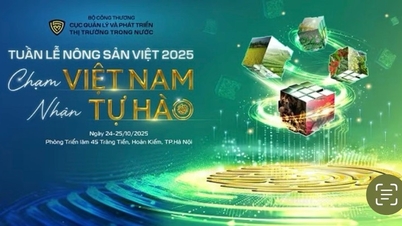










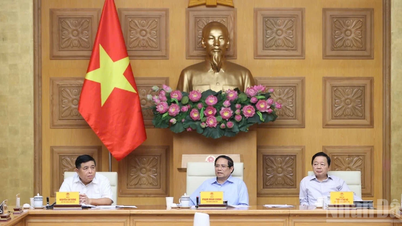






Comment (0)