Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane Al Saoud, accueille le président américain Donald Trump à l'aéroport Malik Khalid de Riyad, le 13 mai 2025. (Photo : AA/TTXVN)
Les « zones chaudes » régionales évoluent de manière complexe, ce qui représente un risque élevé de guerre à grande échelle.
Ces derniers temps, malgré les nombreux efforts de médiation de la communauté internationale et des pays de la région, les tensions et la violence continuent de s'exacerber dans certaines zones sensibles du Moyen-Orient. Selon les experts, la situation actuelle présente un risque élevé de conflit régional de grande ampleur, un scénario inédit depuis de nombreuses années. Cette évolution complexe est clairement illustrée par trois zones de tension, révélant un risque de perte de contrôle et d'instabilité généralisée de la situation sécuritaire régionale.
Tout d'abord, le conflit israélo-iranien s'est gravement intensifié avec des attaques directes sur le territoire de l'autre camp à partir de la mi-juin 2025, faisant craindre une guerre à grande échelle dans la région. Sous prétexte de la menace que représentent les programmes balistiques et nucléaires iraniens, Israël a lancé une campagne d'attaques massives, infligeant de lourds dégâts à l'Iran. De nombreuses installations militaires, nucléaires et civiles ont été détruites et un grand nombre de soldats, de civils et de hauts gradés militaires ont péri. L'Iran a rapidement riposté par des frappes aériennes d'envergure, exacerbant les tensions bilatérales à un niveau sans précédent. La situation s'est encore compliquée lorsque les États-Unis ont annoncé leur participation à l'attaque contre les cibles nucléaires iraniennes, marquant le début d'une nouvelle phase du conflit et menaçant de l'étendre à toute la région. Après douze jours de violents combats, les deux camps sont parvenus à un accord de cessez-le-feu temporaire grâce à la médiation de plusieurs pays de la région. Toutefois, cet accord n'est qu'une solution provisoire, dépourvue d'engagements politiques et sécuritaires à long terme et ne résolvant pas les désaccords fondamentaux relatifs aux questions nucléaires, aux missiles et à la présence militaire. Dans ce contexte, le risque de résurgence du conflit reste élevé, les deux camps maintenant une confrontation stratégique, une hostilité profonde et ne montrant aucun signe de concessions significatives.
Deuxièmement, le conflit dans la bande de Gaza continue de s'intensifier, faisant de plus en plus de victimes. Après l'échec de l'accord de cessez-le-feu de six semaines entre Israël et le Hamas, négocié par les États-Unis, Israël a fermé les voies d'acheminement de l'aide humanitaire et a repris ses attaques à travers la bande de Gaza à partir du 18 mars 2025. Les négociations indirectes, menées sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, se sont poursuivies mais n'ont pas permis de parvenir à un consensus, en raison de nombreux désaccords entre les deux parties. Israël exigeait la libération des otages, le désarmement et le retrait du Hamas de son rôle de chef d'État dans la bande de Gaza ; tandis que le Hamas réclamait un cessez-le-feu durable et le retrait total d'Israël. Le conflit a aggravé la crise humanitaire dans la bande de Gaza, les dégâts étant estimés à environ 50 milliards de dollars américains (1) . À la mi-septembre 2025, de nombreuses sources internationales ont fait état d'une attaque visant des cibles liées au Hamas au Qatar, faisant des victimes et provoquant une crise diplomatique . Le 29 septembre 2025, le Premier ministre israélien B. Netanyahu s'est entretenu par téléphone avec le dirigeant qatari, réaffirmant la position officielle et s'engageant à ce que de tels agissements ne se reproduisent plus ; dans le même temps, le Qatar continue d'être considéré comme un intermédiaire clé pour les canaux de négociation indirects sur le cessez-le-feu, l'échange d'otages et les accords de sécurité.
Troisièmement, la situation sécuritaire au Yémen, au Liban et en Syrie demeure complexe, marquée par une intensification des combats entre les États-Unis, Israël et les forces d'opposition dans la région. Au Yémen, les États-Unis ont intensifié leurs opérations militaires contre les forces houthies, notamment suite à la décision du président américain Donald Trump de mettre en œuvre des mesures strictes pour prévenir les attaques contre les voies maritimes traversant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Au Liban, malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis et toujours en vigueur depuis novembre 2024, Israël a étendu ses frappes aériennes contre les forces du Hezbollah, y compris dans la région de Beyrouth, afin de prévenir tout risque de réarmement. Le 6 juin 2025, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé que les mesures militaires se poursuivraient jusqu'à ce que la sécurité des frontières soit assurée. En Syrie, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur plusieurs cibles militaires et déployé des forces dans la zone tampon du Golan, marquant ainsi son retour dans la région près de 50 ans après l'accord de retrait de 1974. Ces développements montrent que le risque d'extension du conflit dans la région persiste et nécessite une surveillance et un contrôle étroits.
Cependant, malgré les tensions, certaines zones de conflit dans la région ont enregistré des progrès positifs, ouvrant la voie à la stabilité et à la reconstruction. En Syrie, la situation s'est progressivement stabilisée, inaugurant une période de transition de cinq ans. Le 29 janvier 2025, près de deux mois après la chute du régime du président syrien Bachar al-Assad, les principales forces armées ont tenu une Conférence nationale et ont nommé à l'unanimité M. Ahmed al-Charia, chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), président de la Syrie . Simultanément, l'ancienne Constitution a été abrogée, l'Assemblée nationale dissoute et un gouvernement de transition a été mis en place. Immédiatement après, le nouveau président syrien a œuvré pour l'unité nationale, a coopéré avec les Forces démocratiques syriennes (FDS) , a promulgué une Constitution intérimaire et a lancé la reconstruction du pays. En matière de politique étrangère, la nouvelle administration a activement amélioré les relations avec les pays voisins et les partenaires internationaux, notamment grâce à la première rencontre historique en 25 ans entre le président américain D. Trump et le président syrien Ahmed al-Sharaa, ouvrant la voie à une levée partielle des sanctions par les États-Unis et l'Union européenne (UE).
Des progrès significatifs ont également été enregistrés dans les négociations nucléaires iraniennes. D'avril à mai 2025, les États-Unis et l'Iran ont tenu cinq cycles de négociations indirectes à Oman et en Italie, parvenant à un certain consensus sur les principes et les techniques. L'Iran a repris sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), autorisant des équipes d'experts à inspecter ses installations nucléaires. Le 7 juin 2025, le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé sa volonté de coopérer pleinement pour garantir la sûreté et la sécurité nucléaires (6) .
Au Liban , la crise politique qui a duré plus de deux ans a officiellement pris fin après l'élection, le 9 janvier 2025, du commandant de l'armée, le général Joseph Aoun, à la présidence du Liban par le Parlement libanais. Puis, le 8 février 2025, un nouveau gouvernement a été formé, remplaçant le gouvernement intérimaire et promettant des réformes globales, ouvrant ainsi une nouvelle période de redressement et de développement pour le pays.
La compétition stratégique entre les grandes puissances du Moyen-Orient continue de s'intensifier et de s'étendre.
De par son rôle géostratégique majeur, le Moyen-Orient demeure un enjeu crucial de la compétition stratégique entre grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Cette compétition ne se limite pas à la défense, à la sécurité et à la présence militaire, mais s'étend également à des domaines stratégiques tels que les sciences et technologies et les ressources rares.
Pour les États-Unis, le second mandat du président Donald Trump a marqué un tournant, passant d'une logique de « contrôle » à une logique de « compétition », avec une réduction de l'implication directe et une priorité donnée à une stratégie moins coûteuse, tout en préservant la capacité de dominer la région. La politique étrangère a connu plusieurs ajustements notables : le rétablissement de la politique de « pression maximale » sur l'Iran ; la réaffirmation du rôle du Moyen-Orient, illustrée par la première visite du président Trump dans la région ; et la promotion de la coopération avec les partenaires dans les domaines technologiques stratégiques, tels que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et l'informatique quantique. La nouvelle politique tarifaire américaine a contraint de nombreux pays de la région à réorienter leur économie et leurs échanges commerciaux vers une augmentation des importations de produits américains et l'ouverture de leurs marchés. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis se sont engagés à réaliser des investissements massifs aux États-Unis, pour un montant total pouvant atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, témoignant du renforcement des liens économiques et stratégiques entre les États-Unis et leurs principaux partenaires régionaux.
Parallèlement, la Russie et la Chine continuent d'accroître leur présence et de renforcer leurs liens stratégiques avec les pays du Moyen-Orient. La Russie privilégie la consolidation de son influence dans la région par un renforcement de sa présence militaire, une coopération accrue en matière de sécurité et la mobilisation de ses forces. En janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un accord de coopération de 20 ans, élevant leurs relations au rang de partenariat stratégique global et faisant de l'Iran un allié clé de la Russie dans la région, notamment dans un contexte de détérioration des relations avec la Syrie (7) . Dans le même temps, la coopération entre la Russie et les pays du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, poursuit son expansion. Non seulement ces pays maintiennent une position neutre face aux résolutions s'opposant à la Russie aux Nations Unies, mais ils encouragent également la coopération en matière d'investissements et de commerce avec la Russie, notamment par le développement de lignes ferroviaires reliant la Russie au Moyen-Orient et l'exploitation de la Route maritime du Nord (RMN) à travers l'Arctique, reliant ainsi la Russie à la région Asie-Pacifique.
Le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, à Moscou, en Russie, le 7 août 2025. Source : middle-east-online.com
La Chine privilégie une approche ciblée de la coopération économique et commerciale, fondement de son développement dans les domaines politique, sécuritaire et des nouvelles technologies. Elle accorde la priorité à la négociation d'un accord de libre-échange (ALE) avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), tout en renforçant sa coopération dans le cadre de la « Communauté de destin commun sino-arabe » et de l'initiative de haute qualité « Ceinture et Route » (BRI). Les relations politiques et stratégiques entre la Chine et l'Iran, les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et l'Égypte continuent de se consolider, illustrant clairement le rôle croissant de la Chine dans la configuration de la situation régionale. À titre d'exemple, la visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en Chine en avril 2025, pour discuter et donner des consultations sur le processus de négociation entre l'Iran et les États-Unis, a mis en évidence le rôle d'intermédiaire de plus en plus important de la Chine.
L'intelligence artificielle et les nouvelles technologies restent prioritaires en matière de développement.
Ces dernières années, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël se sont imposés comme des pays pionniers dans le développement des industries de haute technologie au Moyen-Orient. Ces pays ont encouragé la coopération internationale, notamment avec les États-Unis et l'Europe, afin d'accéder aux technologies d'intelligence artificielle (IA), aux puces dédiées à l'IA et de construire une infrastructure numérique moderne. Parmi les projets phares, citons la construction par les Émirats arabes unis, à Abou Dhabi, la capitale, du plus grand centre d'IA de la région, d'une capacité de 5 GW. Israël a lancé la construction du plus grand centre de données du pays (30 MW) en coopération avec Nvidia Technology Group (États-Unis) et intégrera un programme d'enseignement sur l'IA à partir de 2025. Le groupe saoudien Aramco a signé un accord avec BYD High Technology and Industry Group (Chine) et Tesla Technology Group (États-Unis) pour développer des technologies de véhicules électriques, avec pour objectif que 30 % du parc automobile du pays soit électrique d'ici 2030. Ces initiatives témoignent de la forte évolution du Moyen-Orient vers un modèle de développement fondé sur l'innovation et les hautes technologies, visant à diversifier l'économie et à renforcer la compétitivité mondiale.
Au-delà du simple développement de leurs technologies nationales, les pays du Moyen-Orient, notamment les pays du Golfe, investissent activement à l'étranger pour accéder aux technologies clés et partager leurs expériences de développement avec des pays dotés de plateformes technologiques avancées, tels que les États-Unis, la France, l'Italie et l'Albanie. Les accords de coopération portent sur les hautes technologies, l'intelligence artificielle, les centres de données, les télécommunications et les infrastructures stratégiques. Parmi les projets notables, citons : les Émirats arabes unis s'engagent à investir entre 30 et 50 milliards d'euros dans la construction d'un centre de données d'IA de 1 GW en France, qui deviendra l'un des plus grands au monde ; le groupe DataVolt (Arabie saoudite) s'engage à investir 80 milliards de dollars dans les technologies de pointe et 20 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA et d'énergie aux États-Unis ; le Qatar investit 1 milliard de dollars dans le groupe Quantinuum (États-Unis) pour développer la technologie quantique (8) . Par ailleurs, les pays de la région encouragent l'application de l'IA et des hautes technologies dans l'industrie pétrolière et gazière, un pilier de nombreuses économies. Lors de la Conférence sur l'économie numérique 2025 qui s'est tenue au Qatar, de nombreux experts ont déclaré que les investissements mondiaux dans l'IA dans l'industrie pétrolière et gazière pourraient atteindre 1 000 milliards de dollars américains au cours des 10 prochaines années (9) , dont une grande partie serait détenue par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), tels que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.
Un statut international renforcé en tant que « médiateur de paix »
S’appuyant sur des politiques étrangères indépendantes et autonomes, de nombreux pays du Moyen-Orient ont intensifié leur participation à la médiation pour résoudre les points chauds régionaux et internationaux, affirmant ainsi leur rôle de plus en plus affirmé sur la scène internationale au cours du premier semestre 2025. Des pays comme la Turquie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, ainsi que des pays à l’influence plus limitée comme la Jordanie et l’Irak, promeuvent activement le rôle de médiateur par le biais de canaux bilatéraux et multilatéraux.
Les activités de médiation se manifestent clairement à travers les principaux processus suivants : premièrement, la promotion des négociations de cessez-le-feu et de l’aide humanitaire dans le conflit russo-ukrainien. De février à mars 2025, l’Arabie saoudite a organisé de nombreuses négociations de haut niveau entre les États-Unis, la Russie et l’Ukraine, une étape importante après trois ans d’interruption. Les Émirats arabes unis ont joué un rôle prépondérant en présidant avec succès 15 échanges de détenus, concernant plus de 4 100 personnes, et en accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une visite officielle en février 2025. Deuxièmement, la promotion du dialogue russo-américain. La Turquie et l’Arabie saoudite ont organisé deux cycles de négociations directes entre les deux parties en 2025, contribuant à la reprise progressive des activités diplomatiques bilatérales. Troisièmement, l’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Irak ont activement œuvré à la médiation pour résoudre le conflit dans la bande de Gaza, appelant à la création d’un État palestinien souverain. Le 34e sommet de la Ligue arabe en Irak (mai 2025) constitue une étape importante dans la promotion d’un cessez-le-feu et la reconstruction de la bande de Gaza. Quatrièmement, l'Égypte, la Jordanie et l'Irak coordonnent leurs efforts pour promouvoir le dialogue politique et le processus de stabilisation en Syrie, contribuant ainsi à l'instauration d'une période de transition pacifique après les bouleversements politiques dans ce pays.
Ces efforts ont contribué à rehausser l'image, le rôle et le prestige international de nombreux pays de la région, faisant du Moyen-Orient un point d'appui pour la réconciliation des conflits complexes qui secouent le monde actuel.
Quelques caractéristiques clés de la région du Moyen-Orient dans les prochains mois
Face à des changements rapides, complexes et imprévisibles, de nombreux experts régionaux et internationaux estiment que la situation au Moyen-Orient restera potentiellement instable dans les prochains mois. Cependant, une nouvelle situation se dessine progressivement, marquée par un rôle de plus en plus prépondérant des pays de la région. Cette évolution se caractérise notamment par les éléments suivants :
Premièrement, les questions de sécurité et de stabilité demeurent la principale préoccupation des pays de la région et d'ailleurs, mais elles seront confrontées à de nombreux défis. Les tensions entre Israël et l'Iran, ainsi que la confrontation entre Israël et les pays arabes au sujet de la guerre dans la bande de Gaza et de la question palestinienne, rendent difficile toute avancée significative dans la résolution des points chauds de la région à court terme. La guerre dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen et le conflit israélo-irano-américain continueront d'évoluer de manière complexe, avec le risque de s'enliser et de devenir un terrain d'affrontement entre grandes puissances. Le dossier nucléaire iranien devrait connaître de nombreux développements lorsque certaines dispositions de l'Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA) expireront en octobre 2025, notamment celles relatives à la levée des sanctions. Par ailleurs, les menaces non traditionnelles à la sécurité, en particulier le terrorisme, présentent toujours un risque potentiel de propagation et continuent de constituer un défi majeur pour la sécurité nationale et la stabilité institutionnelle de nombreux pays de la région.
Deuxièmement, les pays de la région, notamment ceux qui exercent une grande influence, comme l'Iran, Israël, l'Arabie saoudite et la Turquie, continueront d'adapter leurs stratégies de développement afin de participer plus activement à la construction du nouvel environnement coopératif et concurrentiel du Moyen-Orient. Dans un contexte de promotion des intérêts nationaux et ethniques, les politiques étrangères de ces pays tendent à devenir plus pragmatiques, privilégiant le renforcement de leur autonomie et une adaptation souple à un contexte international instable. Les relations entre les pays de la région demeureront à la fois coopératives et compétitives, avec l'émergence de pôles de puissance régionaux, tels que l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte, jouant un rôle dans la résolution des problèmes régionaux et la promotion de la stabilité.
Troisièmement, le processus de paix au Moyen-Orient, et notamment les efforts de normalisation des relations entre Israël et les pays de la région, continuera d'être encouragé, malgré de nombreux défis. La politique de fermeté menée par Israël à l'égard de la Palestine et de l'Iran, sa volonté d'étendre les colonies juives dans les zones contestées, ainsi que ses campagnes militaires unilatérales dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie, exacerbent les tensions avec de nombreux pays de la région. Parallèlement, le processus d'amélioration des relations entre l'Iran et les pays du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, progresse positivement, en vue d'une coopération plus globale. Les relations entre l'Iran et l'Égypte, ainsi qu'entre l'Iran et le Bahreïn, devraient également évoluer favorablement après l'obtention de résultats concrets au cours du premier semestre 2025 (10) .
Quatrièmement, la tendance à l'innovation du modèle de croissance économique, axée sur le développement des industries de haute technologie (telles que l'IA, les centres de données, l'économie numérique et les énergies renouvelables), continuera d'être fortement encouragée, des pays potentiels comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis jouant un rôle de premier plan. Il s'agit d'une orientation stratégique visant à réduire la dépendance au pétrole et à accroître la compétitivité dans un contexte de mutations technologiques et énergétiques mondiales. Cependant, le processus de développement économique dans certains pays touchés par des conflits, comme le Liban (11) , le Yémen, Israël et la Palestine, continue de se heurter à de nombreuses difficultés. Dans ce contexte, l'implication des grandes puissances s'intensifie, engendrant une concurrence stratégique et un regroupement des forces non seulement dans le domaine militaire et sécuritaire, mais aussi dans les domaines civil, technologique et de l'investissement. Depuis fin mai 2024, plusieurs pays européens ont reconnu l'État de Palestine (l'Espagne, l'Irlande et la Norvège le 28 mai 2024 ; la Slovénie le 4 juin 2024), réaffirmant ainsi l'objectif de « deux États ». Les 21 et 22 septembre 2025, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont annoncé leur reconnaissance de l'État de Palestine, soulignant ainsi l'importance de maintenir la perspective d'une solution politique durable au conflit israélo-palestinien. En particulier, les ajustements politiques notables de l'administration Trump lors de son second mandat devraient avoir un impact significatif sur la situation régionale. Parallèlement, les mouvements de solidarité en faveur de la lutte palestinienne et les manifestations contre la guerre en Israël, ainsi que dans de nombreux pays de la région, devraient continuer de prendre de l'ampleur, contribuant à façonner l'opinion publique internationale et appelant à des actions responsables pour un Moyen-Orient pacifique, stable et durable dans les années à venir.
-----------------------------
(1) Selon les estimations publiées en février 2025 par la Banque mondiale (BM), les Nations Unies et l'Union européenne (UE), les dommages matériels en Syrie après le conflit et la période de transition politique se chiffrent en centaines de milliards de dollars américains, parmi lesquels les besoins financiers pour la reconstruction des infrastructures de base, le redressement économique et la stabilité institutionnelle sont particulièrement urgents au cours des 5 premières années.
(2) Hayat Tahrir al-Sham (HTS) fut jadis la force d'opposition la plus importante et la mieux organisée de Syrie sous le régime du président Bachar al-Assad, contrôlant et dirigeant la province d'Idlib pendant de nombreuses années. Le 9 décembre 2024, HTS a joué un rôle clé dans la coordination avec les forces d'opposition pour renverser l'ancien régime. Après la nomination de son chef à la présidence de la Syrie, l'organisation a officiellement annoncé sa dissolution et s'est simultanément intégrée aux institutions nationales afin de servir le processus de transition et de reconstruire le pays sur des bases unifiées.
(3) Par ailleurs, la Conférence a publié une déclaration officielle sur la victoire de la révolution syrienne et a fixé le 9 décembre comme Jour de l'Indépendance du pays. Elle a décidé de dissoudre le parti Baas syrien, force au pouvoir sous la présidence de Bachar al-Assad, et d'unifier les groupes armés et politiques au sein d'institutions fédérales, afin d'établir un cadre institutionnel unifié pour la période de transition.
(4) Le 11 mars 2025, le président syrien et les dirigeants des Forces démocratiques syriennes (FDS) ont signé un accord visant à intégrer au système institutionnel de l'État les institutions administratives établies par les FDS dans les zones qu'elles contrôlent. Les deux parties se sont également engagées à coordonner leurs actions contre les éléments fidèles à l'ancien régime du président Bachar al-Assad, renforçant ainsi le processus de transition et l'unité du pouvoir dans la période post-conflit.
(5) Le 13 mars 2025, la Syrie a officiellement promulgué la Constitution intérimaire, marquant une nouvelle étape dans le processus de reconstruction institutionnelle. Conformément aux dispositions de cette Constitution, le président exerce les fonctions de chef du pouvoir exécutif et a le droit de nommer les membres du cabinet, établissant ainsi les fondements de la structure du pouvoir pendant la période de transition post-conflit.
(6) Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Iran possède actuellement près de 275 kg d'uranium enrichi à 60 %, approchant ainsi le seuil de 90 % nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires. Cette situation a suscité des inquiétudes au sein de la communauté internationale et accru la pression sur le processus de négociation nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances.
(7) Malgré le soutien continu du nouveau gouvernement syrien au maintien de la coopération et de la présence militaire sur deux bases stratégiques situées sur son territoire, la Russie observe un changement progressif de la position diplomatique de la Syrie au sein des instances internationales. Plus précisément, concernant la résolution A/RES/ES-11/7 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 février 2025 relative au conflit en Ukraine, la Syrie est passée du vote contre à l'abstention. Ce changement est notable, car la Syrie avait voté contre les résolutions condamnant la Russie à neuf reprises sur dix lors des précédents votes depuis le début du conflit en Ukraine.
(8) Communiqué de presse de la Maison Blanche à l'occasion de la visite du président américain Donald Trump dans trois pays du Moyen-Orient en mai 2025, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/
(9) Voir : Joel Johnson : « Les investissements en IA dans le secteur pétrolier et gazier devraient atteindre environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 », The Peninsula Qatar , 6 février 2025, https://thepeninsulaqatar.com/article/06/02/2025/ai-investments-in-oil-and-gas-to-reach-around-1-trillion-by-2030-expert
(10) En décembre 2024, le président iranien a effectué une visite officielle en Égypte – la première en onze ans – afin de promouvoir la normalisation des relations bilatérales. Parallèlement, les relations entre l'Iran et Bahreïn ont également connu une évolution positive, les contacts diplomatiques se renforçant sous la médiation de la Russie, ce qui ouvre des perspectives d'amélioration des relations bilatérales à venir.
(11) Le 27 mai 2025, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a annoncé que le pays avait besoin d'environ 14 milliards de dollars pour se relever et se reconstruire après le grave conflit avec Israël, impliquant le Hezbollah. Cette estimation témoigne de l'ampleur des dégâts causés aux infrastructures, à l'économie et à la société, et illustre l'immense défi que représente le rétablissement de la stabilité au Liban après la guerre.
Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/1146302/nhung-chuyen-dong-moi-tai-khu-vuc-trung-dong-trong-thoi-gian-gan-day.aspx





![[Photo] Ouverture de la 14e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/05/1762310995216_a5-bnd-5742-5255-jpg.webp)





























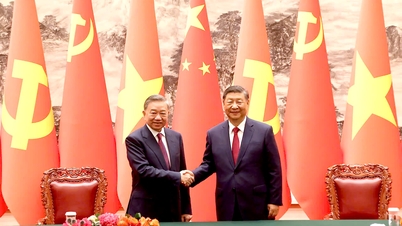





![[Photo] Panorama du Congrès d'émulation patriotique du journal Nhan Dan pour la période 2025-2030](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)

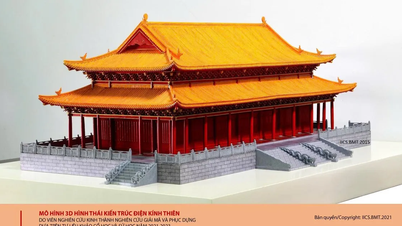
































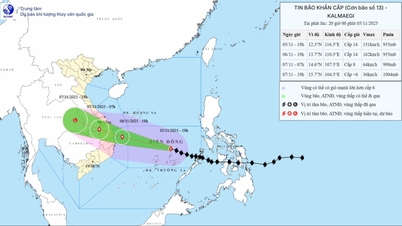







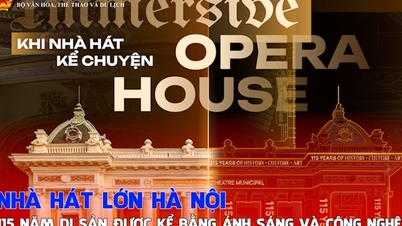









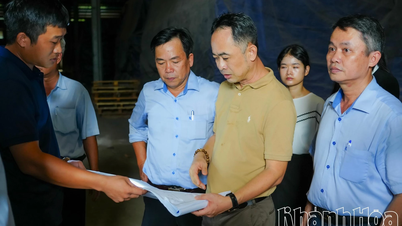


















Comment (0)