Lundi matin, j'ai été témoin d'une scène qui m'a interpellé : une enseignante se tenait devant le portail de l'école, penchée pour lacer les chaussures d'un élève de sixième. Le garçon s'est baissé pour éviter la circulation, serrant toujours son sac à dos usé contre lui. L'enseignante a noué chaque lacet avec soin, s'est essuyé les genoux et a souri : « D'accord, va en classe. »
Ce ne fut que quelques secondes, mais dans le regard de l'élève, il y avait une expression à la fois reconnaissante et chaleureuse. En observant cette scène, je me suis souvenu d'innombrables petites anecdotes sur les enseignants – des détails si ordinaires que parfois même ceux qui les concernent les oublient – mais suffisants pour faire réfléchir à l'expression « former des personnes ».
Ces derniers temps, on parle beaucoup d'innovation, de normes de rendement ou de compétences numériques, mais on s'arrête rarement pour s'intéresser à la dimension humaine de l'éducation , là où les enfants sont véritablement accompagnés, petit à petit, par leurs enseignants. Beaucoup pensent que le métier d'enseignant se résume à des préparations de cours et des notes ; qu'il suffit de remplir ses obligations. Or, d'après les témoignages que j'ai recueillis, ce qui définit un enseignant, ce sont ces gestes spontanés : un repas partagé, une paire de pantoufles offerte à un élève en difficulté, un message d'encouragement envoyé à minuit à un élève en difficulté. C'est cet esprit de « seconde famille » qui marque les esprits.

Ces actions silencieuses découlent de causes multiples. Elles sont en partie dues à la spécificité de la situation, où les disparités régionales restent marquées. En milieu urbain, les enseignants doivent gérer la pression psychologique des adolescents ; en milieu rural, les problèmes d’alimentation, de vêtements, d’éloignement et de précarité s’aggravent insidieusement. Dans les régions montagneuses, les enseignants transportent du riz par-dessus les cols pour préparer le déjeuner des internes ; ailleurs, ils sont confrontés à la dépression, à la violence scolaire, voire à la solitude des élèves à l’ère des réseaux sociaux. Les données de psychologie scolaire montrent que le nombre d’enfants présentant des troubles émotionnels augmente régulièrement chaque année, tandis que le système de soutien reste très insuffisant. Face à ce manque, les enseignants deviennent des « gardiens spirituels » – un rôle qui n’a jamais été officiellement défini.
Au fond, ce sont toujours les personnes qui comptent le plus. L'enseignante qui partage son déjeuner avec un élève qui arrive en classe affamé chaque matin. Celle qui, sans un mot, règle discrètement la dette de petit-déjeuner d'un élève pendant des mois. Celle qui, recevant un message de détresse à une heure du matin, enfile rapidement un t-shirt et court chez l'élève paniqué par la dépression. Ou encore, dans un village reculé, elle prend soin de chaque enfant, se coupe les ongles et lui apprend les règles d'hygiène comme s'il s'agissait du sien. Ces petits gestes, discrets et difficiles à quantifier, sont pourtant les liens qui unissent l'élève à la vie. Lorsqu'un élève accro aux jeux vidéo a été intégré à l'équipe de football par son enseignante et nommé capitaine, il a trouvé une nouvelle raison de persévérer.
Si ces réalités ne sont pas prises en compte, le prix à payer sera exorbitant. Pour les élèves, cela signifie un sentiment d'abandon dans leurs moments les plus vulnérables. Pour les enseignants, cela signifie l'épuisement, face à l'incompréhension de leurs sacrifices silencieux. Et pour la société, cela signifie la perte d'un pilier culturel fondamental : la confiance envers les enseignants. Une génération de jeunes grandissant sans soutien affectif sera vulnérable, facilement désorientée et perdra facilement confiance en elle ; une situation que l'éducation seule, par une réforme des programmes, ne saurait compenser.
Malgré ces défis, nous constatons encore de nombreuses lueurs d'espoir. En y regardant de plus près, nous percevons de nombreux changements positifs, même les plus modestes. Les parents devraient cesser de comparer leurs enfants et reconnaître plutôt leurs efforts quotidiens. Les écoles devraient créer davantage d'espace permettant aux enseignants d'interagir avec les élèves et de les écouter, sans être trop dépendants des dossiers et des bulletins. La société devrait témoigner de la reconnaissance envers le corps enseignant en respectant son temps, sa santé et sa réputation, plutôt que de se contenter d'exprimer sa gratitude par des bouquets de fleurs. Plus largement, des politiques de soutien à la psychologie scolaire et d'amélioration des conditions de travail des enseignants dans les zones défavorisées contribueront à renforcer leur engagement envers leur profession.
Quand je repense à l'image du professeur se baissant pour lacer ses chaussures devant le portail de l'école le premier matin de la semaine, je me dis que ce n'était pas un geste anodin. C'est le symbole des innombrables fois où les enseignants se baissent dans la vie : se baisser pour ramasser un rêve brisé ; se baisser pour relever un enfant tombé ; se baisser pour regarder l'élève dans les yeux et lui dire : « Je crois en toi », « Je crois en toi ». Et peut-être que, lorsqu'un élève devient adulte et revient, serre son professeur dans ses bras et lui dit, la voix étranglée par l'émotion : « Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui », c'est à ce moment précis que l'on comprend le mieux le sens de ces deux mots : « la vocation d'accompagner et de former ». Une vocation discrète, loin des projecteurs, mais qui suffit à changer le destin d'une personne. Préserver ces petits riens, chérir les mains qui nous ont soutenus et vivre de manière à rendre fiers nos professeurs – voilà peut-être la plus belle marque de gratitude que chacun de nous puisse exprimer.
Source : https://vietnamnet.vn/cha-me-thu-hai-trong-su-nghiep-trong-nguoi-2464298.html



![[Photo] Lam Dong : Vue panoramique de la cascade de Lien Khuong qui déferle comme jamais auparavant](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763633331783_lk7-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat de la République tchèque, Miloš Vystrčil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)












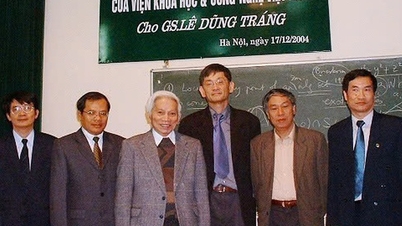























































































Comment (0)