
La question des notes aux examens d'entrée à l'université au Vietnam témoigne d'une longue transformation – Illustration par IA
Souvenirs d'une époque où il était « difficile de respirer »
Revenons au début des années 2000, dans les universités prestigieuses aux systèmes d'évaluation rigoureux, comme l'architecture, l'ingénierie et la médecine. Là-bas, la clémence dans la notation était devenue une norme tacite, perpétuée depuis des générations.
Même le projet architectural le plus méticuleusement conçu et peaufiné peut difficilement dépasser la note de 7. Un 8 est déjà une réussite louable, tandis qu'un 9 est si rare qu'il devient légendaire, souvent « conservé » par les enseignants comme preuve d'excellence que les générations futures pourront imiter.
Derrière cette rigueur se cache une philosophie éducative claire : la vie réelle est bien plus complexe. Une note objective permettra aux élèves d’évaluer leurs compétences avec réalisme, de se défaire de leur complaisance et de progresser constamment. C’est avant tout une leçon d’humilité et de soif d’apprendre.
Cependant, cette philosophie n'est pas sans inconvénients. Elle crée un paradoxe qui donne à réfléchir : ces relevés de notes « modestes », remplis de 5 et de 5, deviennent un fardeau pour les étudiants lorsqu'ils entrent sur le marché du travail ou lorsqu'ils postulent à des bourses pour étudier à l'étranger.
Aux yeux de nombreux employeurs ou universités internationales – notamment en Europe, où des exigences minimales de moyenne générale sont souvent imposées – ces notes sont facilement interprétées à tort comme un manque de capacités, privant ainsi involontairement de nombreuses opportunités précieuses d'étudiants compétents.
Le tournant du système de crédit et le paradoxe précaire.
Un tournant majeur s'est produit avec l'adoption généralisée du système de formation par crédits et du système de notation sur 4 points. Notre promotion 2009 à l'École d'Architecture fut parmi les premières à vivre cette transition. Un paradoxe apparut : alors que l'école maintenait le niveau d'exigence élevé du système de notation sur 10 points, pour obtenir un A (4,0) sur une échelle de 4 points, les étudiants devaient obtenir au minimum 8,5/10.
Les conséquences étaient prévisibles. Nos relevés de notes, une fois classés par ordre alphabétique, sont devenus pitoyablement « modestes ». Même les meilleurs élèves n'ont obtenu qu'un B (3,0), soit tout juste la note suffisante pour obtenir leur diplôme, selon les exigences de certaines universités américaines (les étudiants doivent maintenir une moyenne générale minimale de 3,0/4,0 pour être diplômés).
Nous, les élèves, étions confrontés à un dilemme : malgré tous nos efforts, nos notes ne pouvaient rivaliser avec celles des autres établissements, ce qui nous désavantageait même lors de nos candidatures pour des études à l’étranger ou des emplois dans des multinationales. Les enseignants étaient tout aussi perplexes, tiraillés entre leurs anciennes habitudes d’évaluation et la pression d’un nouveau système.
L’ère de « l’inflation ponctuelle » et ses conséquences imprévisibles.
Alors que le souvenir des notes « insupportables » de la génération précédente persiste, la réalité de l’enseignement supérieur d’aujourd’hui révèle un paradoxe saisissant.
On tombe souvent, dans les médias, sur des chiffres étonnants : le pourcentage d’étudiants obtenant leur diplôme avec mention et distinction dans de nombreuses grandes universités ne cesse d’augmenter, certains dépassant même les 80 % d’ici 2025.
Une analyse attentive des données de classement des diplômés des dernières années révèle une tendance marquante : une augmentation continue, parfois spectaculaire, du pourcentage d’étudiants obtenant des distinctions académiques élevées.
Dans les principaux établissements de formation spécialisés en économie notamment, le pourcentage d'étudiants obtenant d'excellentes et de bonnes notes est non seulement élevé, mais aussi considérable, représentant la majorité du nombre total de diplômés.
Cette disparité soulève inévitablement des questions quant à l'uniformité des critères d'évaluation dans les différents domaines d'études, et plus encore, quant à la véritable signification des diplômes d'excellence sur le marché du travail actuel.
La cause profonde n'a rien de mystérieux. Elle réside dans le système de notation lui-même. La règle qui stipule qu'un étudiant doit obtenir au moins 8,5/10 pour recevoir un A – la meilleure note – a involontairement encouragé un assouplissement des critères d'évaluation. De ce fait, il n'est plus rare de voir des classes où 50 %, voire 70 à 80 % des étudiants obtiennent un A.
Les conséquences de la « surévaluation des notes » ne se limitent pas à l'obtention de relevés de notes parfaits. Elle compromet la fonction première des notes : la différenciation des compétences réelles. Lorsque tout le monde est considéré comme excellent, personne ne l'est véritablement aux yeux de l'employeur.
Ils sont contraints d'approfondir leurs recherches, en utilisant des outils de sélection sophistiqués tels que des tests d'aptitude, des entretiens comportementaux ou des centres d'évaluation pour mener des tests supplémentaires, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts et des délais de recrutement. La véritable valeur d'un diplôme universitaire s'en trouve donc remise en question.
« Bell Curve » – Un miracle ou une dose nécessaire de médecine amère ?
Dans ce contexte, la méthode de notation par « courbe de Gauss » est présentée comme une solution technique viable pour maîtriser l'inflation. Le principe de la courbe de Gauss ne repose pas sur une modification des méthodes d'enseignement ou de notation. Il n'est pas non plus nécessaire de réformer ou de modifier les méthodes d'évaluation existantes ; le changement réside dans le processus final de conversion et de classement.
Au lieu d'un seuil fixe pour obtenir la note A, directement converti en notes alphabétiques (A, B, C, D), cette méthode classe les élèves en fonction de la répartition relative de leurs aptitudes au sein de la classe. Seul un certain pourcentage (par exemple, 10 à 15 %) obtient la note A, la majorité se situe aux niveaux B et C, et une petite fraction au niveau D.
Cette approche, appliquée dans de nombreuses universités internationales telles que Stanford, Harvard et même à RMIT Vietnam, contribue à garantir que les notes reflètent relativement fidèlement la position d'un étudiant au sein du groupe, contrôlant ainsi la situation de « que des A » ou d'une classe remplie de 5 ou de 5 qui réussissent tout juste le cours.
Ses avantages sont évidents : rétablir la différenciation, valoriser les qualifications et fournir aux employeurs un point de repère plus fiable.
Cependant, tout n'est pas rose. La courbe de Gauss présente aussi des inconvénients indéniables. Elle peut engendrer une concurrence inutile, voire parfois déloyale.
Dans une classe regroupant d'excellents élèves (comme une classe de haut niveau ou une classe pour élèves surdoués), un élève vraiment doué, même avec d'excellentes notes aux examens, peut n'obtenir qu'un B ou un C s'il ne fait pas partie des meilleurs élèves de la classe, ou si plusieurs autres obtiennent des notes encore plus élevées. Cette méthode présente également des limites : elle peut notamment rendre difficile l'intégration d'élèves talentueux dans un environnement où se côtoient de nombreux élèves tout aussi talentueux, ou encore lorsque la classe compte un nombre insuffisant d'élèves.
Alors, quelle est la solution ?
La courbe de Gauss n'est pas une solution miracle, et son application rigide ne fera que remplacer un problème par un autre. La solution réside probablement dans une philosophie d'évaluation plus équilibrée et flexible.
Premièrement , son application doit être flexible. La répartition des notes selon la courbe de Gauss ne doit pas être une valeur fixe (par exemple, si un examen comporte 10 % d'étudiants pouvant obtenir un A et 30 % un B) pour chaque matière et chaque classe ; elle doit au contraire être ajustée et équilibrée en fonction des spécificités de chaque domaine (ingénierie, arts, commerce, etc.), de la taille des classes, voire du niveau des étudiants admis.
Deuxièmement , et c'est peut-être le plus important, nous devons revoir notre conception de la finalité des notes. Celles-ci ne devraient pas constituer une fin en soi, mais simplement un moyen d'évaluer le processus d'apprentissage. La véritable valeur de l'enseignement supérieur réside dans les connaissances, les compétences et la pensée critique acquises par les étudiants, et non dans une simple note figurant sur un diplôme.
En définitive, trouver une méthode d'évaluation qui reconnaisse fidèlement l'effort individuel tout en garantissant objectivité, transparence et impartialité est essentiel pour valoriser pleinement les diplômes universitaires vietnamiens à l'ère nouvelle. Ce processus requiert la collaboration non seulement des responsables de l'éducation, mais aussi des enseignants, des étudiants et du monde des affaires.
Source : https://tuoitre.vn/chuyen-diem-so-o-dai-hoc-viet-nam-tu-thoi-ky-kho-tho-den-cau-chuyen-lam-phat-diem-20251010231207251.htm







![[Photo] Deux vols ont atterri et décollé avec succès à l'aéroport de Long Thanh.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F15%2F1765808718882_ndo_br_img-8897-resize-5807-jpg.webp&w=3840&q=75)







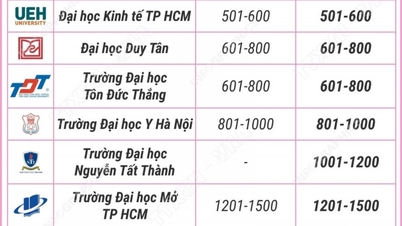




























































































Comment (0)