Plus important encore, l'indépendance financière des Conseils populaires au niveau communal.
Lors des débats, de nombreux députés ont souligné un paradoxe : le Conseil populaire, organe représentatif du peuple, voit son pouvoir de contrôle, notamment au niveau local, restreint. Je partage pleinement l'avis des députés Vu Hong Luyen (Hung Yen) et Siu Huong (Gia Lai), qui ont insisté sur la nécessité de définir clairement les pouvoirs de contrôle des délégations du Conseil populaire. Seule la légalisation de ces pouvoirs permettra de garantir la proximité avec le peuple, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de gouvernement local à deux niveaux. Faute de quoi, le canal de contrôle le plus efficace et le plus proche des citoyens restera inexploité. « Comme l'a suggéré le député Siu Huong, le projet de loi devrait préciser les responsabilités du Comité permanent du Conseil populaire en matière d'attribution des missions et de suivi des résultats des délégations, afin que cette activité ne soit pas une simple formalité », a déclaré M. Pham Van Hien, électeur du quartier de Hai Van, à Da Nang .

Le député Vu Hong Luyen ( Hung Yen ) prend la parole dans l'hémicycle. Photo : Ho Long
M. Kieu Quang Ha, électeur du quartier de Bac Hong Linh, dans la province de Ha Tinh, a déclaré sans ambages : « Légaliser le pouvoir de contrôle de la délégation du Conseil populaire est nécessaire, mais surtout, il faut garantir l’indépendance financière du Conseil populaire au niveau communal. Actuellement, pour exercer un contrôle, les fonds doivent être demandés à l’organisme même contrôlé ; comment l’objectivité peut-elle être assurée ? Si ce blocage n’est pas levé, le contrôle sera inefficace. Par conséquent, la réglementation relative aux activités de contrôle devrait stipuler plus clairement l’obligation de fournir des ressources et garantir l’indépendance financière du Conseil populaire. »
Cet avis a mis en lumière le principal obstacle au contrôle local : la dépendance financière de l’organisme supervisé lui-même. De ce fait, nombreux sont ceux qui estiment que la réglementation imposant un seul titulaire de compte, le président du comité populaire communal, comme dans l’ancien modèle de gouvernement local à trois niveaux, ne devrait pas être maintenue. Il conviendrait plutôt d’envisager des ajustements afin de permettre au conseil populaire communal de disposer de son propre titulaire de compte, garantissant ainsi son indépendance dans ses activités, notamment en matière de contrôle. En effet, le niveau communal a aujourd’hui un champ d’action, une envergure et une nature d’activités considérablement plus importants qu’auparavant.
Dans de nombreuses localités, des organismes et entreprises tels que les compagnies d'électricité, les sociétés de distribution d'eau, les services d'assainissement, les services fiscaux régionaux, les tribunaux populaires, les parquets populaires, etc. – bien qu'étant au service direct de la population – ne relèvent pas de la compétence de la commune. En cas de problème, le Conseil populaire communal n'a pas le pouvoir d'intervenir. Les électeurs s'interrogent : si le Conseil populaire communal ne peut pas les superviser, qui le fera ? C'est précisément pourquoi ils attendent du projet de loi qu'il élargisse le champ de la supervision, non seulement « selon les niveaux administratifs », mais aussi selon les zones résidentielles et les sphères de la vie quotidienne. Lorsque le Conseil populaire communal pourra superviser tous les organismes et services opérant sur son territoire, la loi sera véritablement au plus près des citoyens et aura un impact concret sur leur vie.
Suivi post-opérationnel - « la destination finale qui doit être atteinte »
Le suivi ne doit pas se limiter à la simple « détection des problèmes », mais doit déboucher sur des « changements concrets ». Or, il existe actuellement une lacune majeure dans la pratique. « Je partage l'avis de la députée Nguyen Thi Suu (délégation de Thua Thien Hue) lorsqu'elle a déclaré sans ambages : la loi actuelle n'impose pas l'obligation de mettre en œuvre les recommandations après le suivi, ce qui conduit à considérer ce dernier comme terminé une fois achevé. Il est donc essentiel de prévoir clairement des sanctions dans la loi afin de garantir la mise en œuvre des recommandations – c'est ce qui assure l'efficacité de cette activité », a exprimé l'espoir de M. Ngo Duc Thai, électeur de la commune de Hung Nguyen, province de Nghe An.
En réalité, de nombreuses conclusions de suivi sont « mises de côté » par les administrations, avec des rapports tardifs, des réponses superficielles, voire aucune réaction concrète. Les électeurs partagent l'avis des délégués et ajoutent qu'il est temps d'instaurer des procédures claires de « suivi post-contrôle ». Chaque recommandation de suivi devrait constituer un « ordre politique » – avec un responsable désigné, un délai de mise en œuvre et un rapport public. La Commission permanente de l'Assemblée nationale pourrait publier périodiquement une liste des organismes et des collectivités locales qui tardent à appliquer les conclusions de suivi ou qui n'y parviennent pas, à titre de sanction « souple mais efficace ». La pression en faveur de la transparence obligera le système administratif à progresser véritablement.
Au cours des débats, de nombreux délégués ont également soulevé un autre point important : l’organe de contrôle doit lui aussi être soumis à un contrôle. Le Conseil populaire et ses comités ne peuvent se contenter de « donner des ordres et de les laisser à l’abandon ». Les résultats de chaque contrôle doivent être rendus publics, leur efficacité évaluée, et les responsables doivent rendre des comptes aux électeurs. Ce n’est que lorsque le Conseil populaire osera s’examiner lui-même que ses activités de contrôle gagneront en profondeur et instaureront la confiance.
Un suivi pour détecter les changements – et pas seulement pour connaître.
Le contrôle n'est pas seulement un droit, mais aussi une mesure de confiance. Dans un État de droit socialiste, l'essence du contrôle ne réside pas dans la question de savoir « qui contrôle qui », mais dans son objectif ultime. Le contrôle doit susciter le changement et inciter à l'action, et non se contenter de constater les infractions et de classer l'affaire.
De nombreux électeurs estiment qu'il est temps de considérer le contrôle comme un processus structuré en quatre étapes : sélectionner les enjeux pertinents ; mener un contrôle rigoureux et objectif ; tirer des conclusions claires en attribuant les responsabilités ; et suivre et encourager la mise en œuvre des résultats. Ce n'est qu'une fois ces quatre étapes accomplies que le contrôle pourra devenir un véritable moteur de régulation des comportements publics. Dès lors, le Conseil populaire communal ne se contentera plus d'« écouter le peuple », mais « incitera le gouvernement à agir » ; les élus ne seront plus seulement des reflets, mais aussi des acteurs du changement.
Alors que le vice-président de l'Assemblée nationale, le lieutenant-général Tran Quang Phuong, concluait la session : aucune opinion n'a été négligée et prise en compte. Il s'agit là non seulement d'un engagement de l'Assemblée nationale, mais aussi d'un rappel à tous les niveaux de gouvernement de s'interroger sur leurs pratiques – afin que le contrôle ne se limite pas à l'hémicycle, mais imprègne chaque localité et chaque aspect de la vie. Lorsque le contrôle deviendra véritablement un outil de maîtrise du pouvoir, sera légalisé et garanti par un mécanisme indépendant et transparent, chaque conclusion de contrôle constituera un engagement de l'État envers le peuple. Et alors seulement, le peuple aura le sentiment d'être écouté, respecté et protégé – non pas par de simples promesses, mais par des actes.
Source : https://daibieunhandan.vn/du-thao-luat-hoat-dong-giam-sat-cua-quoc-hoi-va-hdnd-sua-doi-de-quyen-luc-nhan-dan-duoc-thuc-thi-tron-ven-10392843.html


![[Photo] Cérémonie de clôture de la 10e session de la 15e Assemblée nationale](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F11%2F1765448959967_image-1437-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient par téléphone avec le PDG de la société russe Rosatom.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F11%2F1765464552365_dsc-5295-jpg.webp&w=3840&q=75)































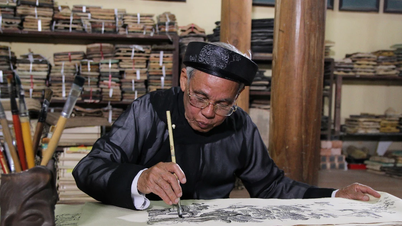















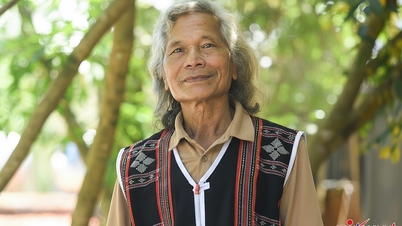



![[OFFICIEL] LE GROUPE MISA ANNONCE SON POSITIONNEMENT DE MARQUE PIONNIER DANS LA CONSTRUCTION D'IA AGENTE POUR LES ENTREPRISES, LES MÉNAGES ET LE GOUVERNEMENT](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/11/1765444754256_agentic-ai_postfb-scaled.png)

























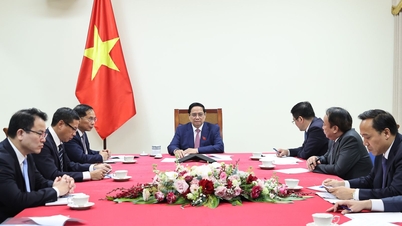




![[Galerie photos] L'aéroport de Long Thanh s'illumine, prêt à accueillir son premier vol](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/11/1765467251707_bia_20251211222704.jpeg)





















Comment (0)