Vo Van Thuong, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat, ainsi que des dirigeants du Parti et de l'État et des délégués, ont visité l'exposition de documents et d'images historiques lors de la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la signature de l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (27 janvier 1973 - 27 janvier 2023). _Photo : VNA
L'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam a été officiellement signé le 27 janvier 1973 à Paris, marquant un tournant décisif dans la lutte de résistance du peuple vietnamien contre les États-Unis pour sauver le pays. Cet accord a ouvert de nouvelles perspectives à la révolution vietnamienne, lui permettant de progresser et d'engranger de nouvelles victoires, aboutissant à la Grande Victoire du Printemps de 1975, qui a libéré le Sud et réunifié le pays. Le caractère novateur de l'Accord de Paris s'est manifesté clairement et de façon éclatante dès son entrée en vigueur et jusqu'à la victoire totale du 30 avril 1975.
Le caractère historique et novateur de l'Accord de Paris
Qualifier un document ou un événement de novateur, c'est évoquer un tournant décisif, créant les conditions propices à une nouvelle étape et à la réalisation complète de l'objectif stratégique. L'Accord de Paris sur le Vietnam a marqué une nouvelle étape dans la longue guerre de résistance contre les États-Unis, visant à sauver le pays du peuple vietnamien, et a permis d'atteindre l'objectif de « faire partir les États-Unis ». Cette victoire stratégique a instauré un contexte favorable, propice à l'harmonie, et a insufflé au peuple vietnamien la force nécessaire pour aller de l'avant et « renverser le régime fantoche », mettant ainsi un terme à la longue guerre de résistance. S'étendant du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973, avec plus de 200 réunions publiques et 45 réunions privées de haut niveau, 1 000 entretiens et des centaines de rassemblements en soutien au Vietnam, il apparaît que l'Accord de Paris fut le fruit d'une lutte inébranlable et persistante, témoignant à la fois de la détermination de fer et de la volonté de paix du peuple vietnamien, sous la direction du Parti des travailleurs du Vietnam, d'ouvrir la voie et de créer un nouveau tournant décisif pour mettre fin à la guerre.
Premièrement, l'Accord de Paris a permis au Politburo et à la Commission militaire centrale de finaliser le plan stratégique visant à réunifier rapidement le pays et, simultanément, à rectifier au plus vite les manifestations de droite apparues après l'Accord au sein d'une partie des forces armées et civiles. La signature de l'Accord de Paris a modifié la configuration du champ de bataille dans une direction favorable à la révolution. Suite à cet accord, les États-Unis ont dû se retirer et les forces armées des deux camps sont restées sur place. Grâce à cela, nous avons déjoué le complot de l'ennemi visant à établir une « ligne de démarcation ». Nos troupes n'ont pas eu à se rassembler en un seul lieu (comme lors des accords de Genève de 1954), mais nous avons au contraire maintenu une situation de dispersion sur le champ de bataille, une situation très avantageuse pour nous et désavantageuse pour l'ennemi (1) .
Notre Parti a reconnu qu'après l'Accord de Paris, nous disposions de nouveaux facteurs de victoire et de nouvelles capacités, à savoir le gouvernement et les forces armées révolutionnaires, les zones libérées, les forces politiques et les mouvements de lutte politique des masses dans les zones contrôlées par l'ennemi, ainsi que les droits fondamentaux reconnus par l'Accord. Par conséquent, nous devons tirer parti de ces facteurs et de ces capacités pour « aller de l'avant et mener à bien la cause de la révolution démocratique nationale populaire dans tout le pays » (2) .
Dans la conclusion de la première phase de la Conférence du Politburo du 10 octobre 1974, notre Parti a estimé que nous avions alors une opportunité et a souligné qu’« en dehors de cette opportunité, il n’y en a pas d’autre. Si nous tardons encore dix ou quinze ans, les marionnettes se rétabliront, les forces d’invasion se rétabliront… alors la situation sera extrêmement compliquée » (3) ; à partir de là, la Conférence a décidé : « Dès maintenant, nous devons procéder d’urgence à tous les préparatifs, créer les conditions et les bases matérielles les plus complètes pour frapper fort, frapper vite, gagner proprement et gagner complètement au cours des deux années 1975-1976 » (4) .
Cependant, avant, pendant et après l'entrée en vigueur des Accords de Paris, le gouvernement et l'armée de la République du Viêt Nam ont poursuivi une série de plans obstinés et ambitieux visant à envahir, pacifier et s'emparer de territoires et de populations. L'empiètement et la pacification du territoire par l'ennemi sont devenus de plus en plus flagrants, mais dans certaines régions, notre réaction a été lente, permettant ainsi à l'ennemi d'occuper des terres et de libérer des populations. Lors de l'entrée en vigueur des Accords de Paris, le président de la République du Viêt Nam, Nguyen Van Thieu, a déclaré avec arrogance : « Ne pas appliquer les Accords de Paris, ne pas se réconcilier, s'opposer à toute réconciliation avec les communistes. » Il a ordonné à l'armée de continuer à attaquer, à envahir les terres, à capturer des populations, à planter des drapeaux et à inonder le territoire.
Pendant ce temps, de notre côté, un groupe de cadres, de membres du parti et de soldats, qui venaient de traverser des années de guerre acharnée et qui bénéficiaient désormais de l'Accord de Paris, développèrent une idéologie de droite et relâchèrent leur vigilance face aux complots et aux manœuvres de l'ennemi. De plus, lors de notre commandement initial, nous n'avons pas pleinement évalué la capacité de l'ennemi à mener à bien ses complots et nous n'avons pas prévu que les impérialistes américains, bien que vaincus, resteraient très obstinés et chercheraient des moyens de soutenir l'Armée de la République du Vietnam pour qu'elle puisse poursuivre la guerre. Au cours des premiers mois de 1973, sur certains champs de bataille, l'ennemi prit l'initiative, mit partiellement en œuvre sa politique de pacification, gagna des partisans, s'implanta dans certaines localités et commença à pénétrer profondément dans les zones libérées de B2.
Face à cette situation, le Comité du Parti de la Zone 9 a pris l'initiative d'ouvrir avec succès la voie à la lutte contre la pacification (5). Le secrétaire du Comité du Parti de la Zone 9, le camarade Vo Van Kiet, et le commandant, le camarade Le Duc Anh, ont dirigé et commandé avec détermination les hommes et les troupes de la Zone 9 afin de repousser avec acharnement les incursions de l'armée fantoche, forçant le retrait de nombreux postes ennemis, poursuivant l'expansion des zones libérées et protégeant la population et les rizières d'importance stratégique. Grâce à cela, la Zone 9 a remporté de nombreuses victoires remarquables dans la lutte contre les incursions ennemies, devenant ainsi un exemple à suivre pour les autres unités.
La 21e Conférence du Comité exécutif central, IIIe législature (juillet 1973), a rapidement cerné la situation et proposé des orientations pour les actions entreprises, avec pour principal objectif la poursuite de l'offensive et le maintien de la perspective d'une révolution violente. Le 15 octobre 1973, le Commandement régional (6) a émis l'ordre suivant : « Résistez résolument aux actions de guerre du gouvernement de Saïgon ; combattez résolument partout, avec les moyens et les moyens appropriés. » Cet ordre du Commandement régional affirmait clairement le droit de riposter des forces armées révolutionnaires, créant ainsi les conditions nécessaires à une intensification des opérations militaires afin de reprendre l'initiative sur l'ensemble du champ de bataille (7) .
Suite à la proposition de renforcer le champ de bataille B2 (8) , approuvée par le Comité central du Parti et l'état-major général, durant la saison sèche de 1974-1975, le commandement régional a dirigé les forces du champ de bataille B2 afin de mener de nombreuses offensives, tant principales que combinées, dans le delta du Mékong. Ces offensives ont permis d'obtenir d'importantes victoires sur la route 14 (Phuoc Long) et dans la région militaire 9, poursuivant ainsi plusieurs objectifs : tester la réaction du gouvernement et de l'armée de la République du Vietnam, notamment des États-Unis ; évaluer la capacité de nos forces principales face à celles de l'armée de la République du Vietnam ; et mesurer l'aptitude des forces armées révolutionnaires à libérer de vastes zones interconnectées. L'expérience a démontré que ces objectifs étaient tous atteints après les victoires des campagnes de la saison sèche de 1974-1975, et notamment la victoire de la route 14 (Phuoc Long). Immédiatement après la victoire de Phuoc Long, le Parti a intégré au plan l'attaque et la libération de Saïgon. Le Parti décida d'attaquer et de libérer Saïgon en avril, car la saison des pluies commencerait en mai dans le Sud, rendant notre mobilité, notamment celle des chars, de l'artillerie et des engins de chantier, difficile, surtout à l'ouest et au sud-ouest de Saïgon, dans la région de Long An, caractérisée par de vastes champs, des canaux et des marécages. Parallèlement à l'élaboration du plan, un « Plan de Combat » fut établi, comprenant un schéma définissant cinq axes d'attaque contre le repaire ennemi.
Dans un esprit de proactivité, le commandement régional, dès les premiers jours d'avril 1975, élabora rapidement un plan de campagne pour libérer Saïgon et le soumit au Bureau central du Sud, qui l'approuva. Ce plan permit au Comité central du Parti d'affiner sa stratégie, de s'adapter à l'évolution extrêmement rapide du champ de bataille, de créer un effet de surprise et de modifier la décision initiale de libérer le Sud en deux ou trois ans. Il opta alors pour un plan opportuniste ramené à un an, puis, fin mars, début avril 1975, le Politburo décida de libérer Saïgon en avril 1975.
Ainsi, à chaque étape du développement, l'art de diriger le Parti repose toujours sur la pensée dialectique et une pratique historique objective. Il s'agit, d'une part , de tirer parti des phases successives de la révolution pour mobiliser et rallier les masses à la lutte, animées par la conviction que rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté ; d'autre part , de savoir orienter tous nos efforts vers la création et la saisie d'opportunités pour remporter des victoires progressives et totales. C'est là une véritable œuvre majeure, qui enrichit, diversifie et vivifie le trésor de la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et de la pensée d'Hô Chi Minh.
Deuxièmement, sur le champ de bataille, l'Accord de Paris a ouvert la voie, opéré un changement stratégique et généré de nouveaux atouts : (i) Nous avons pris l'initiative sur tous les champs de bataille, puni les incursions ennemies, reconquis les populations et les territoires perdus, et étendu nos zones libérées ; (ii) Nous avons consolidé et parachevé notre position stratégique du Nord au Sud, des monts Tri-Thien et des forêts jusqu'aux Hauts Plateaux du Centre, au Sud-Est et au delta du Mékong ; (iii) Nous avons constitué et renforcé des corps de forces mobiles dans les montagnes et les forêts ; concentré nos réserves stratégiques dans les zones clés ; (iv) Nous avons amélioré la situation dans les campagnes et les plaines, créant des bases d'appui aux abords des grandes villes ; (v) Nous avons lancé un mouvement de lutte politique sous le slogan de la paix, de l'indépendance et de l'harmonie nationale ; (vi) Nous avons continué à bénéficier de la sympathie et du soutien indéfectible des forces révolutionnaires et des peuples progressistes du monde entier (9) . On peut dire que l'Accord de Paris a suivi le scénario prédit par notre Parti et le Président Hô Chi Minh, lorsque des centaines de milliers de soldats expéditionnaires américains ont envahi le Sud : l'Amérique est riche, mais sa puissance n'est pas illimitée ; l'Amérique est agressive, mais elle a des faiblesses ; nous savons combattre, nous savons vaincre, alors la résistance triomphera assurément (10). L'Accord de Paris a parfaitement illustré l'art de « savoir gagner étape par étape » pour parvenir à la victoire totale de notre Parti dans un contexte de déséquilibre des forces.
Avec l'entrée en 1973-1974, les opérations sur le champ de bataille se coordonnèrent de manière rythmée, adoptant une posture proactive d'attaque. La force combinée des trois axes, des trois types de troupes et des trois zones (point médian et zone, point culminant et troupes régulières) fut constamment renforcée, créant une tension et un confinement importants de l'ennemi, déjouant ainsi son plan de pacification et le contraignant à la passivité et à la confusion. De ce fait, l'Accord de Paris de 1973 créa une situation militaire nouvelle et extrêmement favorable. Le rapport de forces était alors largement en notre faveur, tant que nous maintenions toutes nos forces sur le front sud. C'est sur cette base que toute notre armée et notre peuple se lancèrent dans la lutte pour « renverser l'armée fantoche ».
Troisièmement, pour l'humanité éprise de paix et de justice, l'Accord de Paris a ouvert la voie au règlement pacifique des conflits internationaux, influençant profondément le progrès de nombreuses nations et constituant un grand encouragement pour celles qui, comme notre pays, partageaient le même destin et le même point de départ dans la protection des droits fondamentaux nationaux. L'Accord préliminaire du 6 mars 1946, l'Accord provisoire du 14 septembre 1946, les Accords de Genève du 21 juillet 1954 et l'Accord de Paris du 27 janvier 1973 ont clairement démontré une vérité essentielle : pour parvenir à la paix, le peuple vietnamien doit non seulement savoir faire des concessions, mais aussi se battre ; non seulement se battre, mais aussi saisir la moindre occasion de rechercher la paix. Telle est la dialectique de la guerre révolutionnaire vietnamienne, de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne sous Hô Chi Minh.
L'ancien secrétaire américain à la Défense, Robert S. McNamara, l'un des acteurs de la politique américaine durant la guerre d'agression contre le Vietnam, a tiré onze leçons de la « tragédie du Vietnam », dont celle-ci : « Nous avons sous-estimé le pouvoir du nationalisme à motiver une nation à se battre et à se sacrifier pour ses idéaux et ses valeurs… » ; « cela reflétait notre profonde méconnaissance de l'histoire culturelle et politique des peuples de la région, ainsi que de la personnalité et des habitudes de leurs dirigeants » (11) . Les « idéaux et leurs valeurs » évoqués par M. McNamara sont les droits nationaux fondamentaux : l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale, l'idéal d'indépendance nationale associé au socialisme auquel tout le peuple vietnamien, sous l'égide du Parti, adhère fermement. L’Accord de Paris de 1973 est le fruit de la lutte de toute une nation, aspirant sans cesse au respect de ses droits fondamentaux, comme le reconnaît respectueusement l’article 1 de cet Accord : « Les États-Unis et les autres pays respectent l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, telles que reconnues par l’Accord de Genève de 1954 sur le Vietnam. » Le camarade Pham Van Dong a déclaré : « Il ne saurait y avoir de compromis contraire aux droits fondamentaux de notre peuple vietnamien, contraire à la morale commune de tous les peuples du monde » (12) .
La ministre des Affaires étrangères du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, Nguyen Thi Binh, a signé l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam le 27 janvier 1973 au Centre international de conférences de Paris (France). _Photo : Documents de l'agence VNA
Quelques leçons pour les activités diplomatiques actuelles
L'Accord de Paris représente l'apogée de la victoire diplomatique vietnamienne durant la période de résistance anti-américaine et de salut national, marquant la maturité de la diplomatie révolutionnaire sous Hô Chi Minh. Fruit d'une lutte acharnée et complexe sur les trois fronts – politique, militaire et diplomatique –, il incarne l'art de conjuguer combat et négociation. Il est aussi le résultat d'une pensée à la fois révolutionnaire et scientifique : combattre en comprenant l'ennemi et soi-même ; travailler en synthétisant les pratiques, en les enrichissant, les développant et les perfectionnant progressivement au fil des étapes de la résistance. L'Accord de Paris témoigne profondément de l'audace du combat, de l'audace de vaincre et de la capacité du peuple vietnamien à lutter et à triompher.
Dans le contexte actuel d'intégration internationale et de mondialisation profonde, l'importance et la portée de l'Accord de Paris offrent de nombreux enseignements précieux pour les activités diplomatiques du Vietnam.
En premier lieu, il faut toujours veiller aux intérêts nationaux supérieurs, dont l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale sont le cœur.
L'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale sont des valeurs sacrées dont toute nation, même petite et défavorisée, a le droit de jouir, car elles constituent les droits les plus fondamentaux et, simultanément, le socle minimal de son existence et de son développement normaux. La constance et la fidélité de notre Parti et de notre peuple dans la défense de ce système de valeurs, de 1945 à nos jours, et notamment dans l'Accord de Paris, demeureront à jamais une leçon précieuse et un exemple inspirant pour les nations éprises de paix du monde entier. L'Accord de Paris de 1973 a constitué une victoire décisive, ouvrant la voie et constituant la condition nécessaire au retrait des troupes américaines et alliées du Sud-Vietnam, et créant ainsi les conditions propices à la fin de la guerre pour l'armée et le peuple vietnamiens.
Dans ce nouveau contexte, la résolution de la 8e Conférence centrale du 13e mandat affirme la nécessité de garantir les intérêts nationaux supérieurs en se fondant sur la protection ferme de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Patrie ; mettant en œuvre la devise « avec l'inchangé, répondant à tous les changements », dans laquelle les intérêts nationaux sont immuables.
Deuxièmement, soyez doux et habile, mais très déterminé et résolu.
L'attitude empreinte de douceur, d'intelligence, mais aussi de fermeté et de résolution, du Parti des travailleurs du Vietnam lors de la Conférence de Paris de 1973 constitue un précieux enseignement de l'art diplomatique de la révolution vietnamienne. Aujourd'hui, le contexte international et la situation intérieure, outre des aspects et des opportunités favorables, présentent également de nombreuses difficultés, des risques et des évolutions imprévisibles, exigeant du Parti, du peuple et de l'armée vietnamiens une fermeté constante, une analyse approfondie des relations entre partenaires et parties prenantes, et une capacité d'adaptation à chaque situation et circonstance.
L’image du « bambou vietnamien », avec ses « racines solides, son tronc robuste et ses branches flexibles , imprégné de l’âme, du caractère et de l’esprit du peuple vietnamien » (13) , selon les termes du secrétaire général Nguyen Phu Trong, constitue le pilier de la politique étrangère vietnamienne moderne. Grâce à une habile combinaison de flexibilité et de créativité tactiques, alliée à une fermeté, une détermination et une persévérance stratégiques, le Vietnam, autrefois assiégé et soumis à un embargo, a « élargi et approfondi ses relations avec 193 pays et territoires, dont 3 pays avec lesquels il entretient des relations spéciales, 5 pays avec lesquels il a noué des partenariats stratégiques globaux, 13 partenaires stratégiques et 12 partenaires globaux » (14), contribuant ainsi à créer un contexte favorable à la réalisation de l’idéal d’indépendance nationale et de socialisme.
Troisièmement, promouvoir de manière proactive et active les forces combinées pour atteindre une efficacité maximale.
La promotion de la force combinée a toujours été considérée par le Parti comme un facteur essentiel du succès de la révolution. Il s'agit de la force combinée des forces internes et externes ; de la force des forces ; de l'union des localités, de la force économique, politique, militaire, culturelle et diplomatique ; de la combinaison de la force nationale avec la force de l'époque, de l'équilibre des relations entre les grandes puissances, tant par le combat que par la négociation ; de la force du grand bloc d'unité nationale ; de la force du patriotisme, de la volonté que rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté… C'est pourquoi elle a contribué de manière significative à la victoire de la guerre de résistance contre l'impérialisme américain, à la libération complète du Sud et à l'unification du pays. Il s'agit de mobiliser pleinement la force combinée de toute la nation et de tout le système politique, conjuguée à la force de l'époque, de tirer le meilleur parti de la sympathie et du soutien de la communauté internationale pour défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, pour protéger le Parti, l'État, le peuple, le régime socialiste, la culture et les intérêts nationaux ; pour maintenir l'environnement, la stabilité politique, la sécurité nationale et la sécurité humaine. bâtir une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine afin de développer le pays dans la direction du socialisme.
Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis la signature de l'Accord de Paris. Le monde a considérablement évolué, mais la portée novatrice et l'importance historique de cet accord demeurent indéniables, témoignant de la diplomatie unique du Vietnam sous Hô Chi Minh. Rétrospectivement, l'Accord de Paris nous éclaire sur l'importance d'une analyse et d'une anticipation justes de la situation et des tendances mondiales, ainsi que sur la nécessité de déployer des efforts constants pour atteindre les objectifs de développement de la nation. Il s'agit d'apporter une contribution essentielle au progrès de l'humanité et de poursuivre avec vigueur la lutte pour l'égalité nationale, la démocratie sociale et le développement humain.
--------------------------------
(1) Conformément aux accords de Paris, plus d'un demi-million de soldats américains et alliés se retireront du Vietnam. Parallèlement, 13 divisions révolutionnaires principales maintiennent fermement leurs positions dans des zones stratégiques du Sud, appuyées par des dizaines de milliers de soldats locaux et de guérilleros. (Source : Ministère de la Défense, Région militaire 7 : Histoire du commandement régional, Maison d'édition politique nationale, Hanoï, 2004, p. 485)
(2) Documents complets du Parti , Maison d'édition politique nationale, Hanoï, 2004, vol. 35, p. 186
(3) Documents complets des parties , op. cit ., p. 177
(4) Documents complets des parties , op. cit ., p. 183
(5) La zone 9, désignée par le code T3, comprenait alors les provinces d'An Giang, Vinh Long, Can Tho, Rach Gia, Tra Vinh, Soc Trang et Ca Mau. Dès le départ, le comité du Parti de la zone 9 fit preuve d'une intuition juste et se montra déterminé à hisser l'étendard révolutionnaire pour attaquer, malgré l'absence d'ordres du gouvernement central. (Extrait de : Ministère de la Défense nationale, Zone militaire 7 : Histoire du commandement régional, op. cit. , p. 508-509)
(6) Le Commandement des Forces armées populaires pour la libération du Sud-Vietnam (abrégé en Commandement régional, appelé Commandement régional à partir du 18 mars 1971), le Commandement régional est sous la direction du Politburo, directement du Bureau central pour le Sud, conseillant le Bureau central pour le Sud dans la conduite des mouvements de lutte politique et armée.
(7) Ministère de la Défense nationale, Région militaire 7 : Histoire du commandement régional , op. cit., p. 530
(8) B2 comprend 5 régions militaires : la région militaire 6 (l’extrême sud de la côte centre-sud et les hauts plateaux du centre-sud, incluant les provinces de Lam Dong, Tuyen Duc et Quang Duc, ainsi que les plaines étroites des provinces de Ninh Thuan, Binh Thuan et Binh Tuy) ; la région militaire 7 (région sud-est : Binh Long, Phuoc Long, Tay Ninh, Bien Hoa, Long Khanh et Phuoc Tuy) ; la région militaire 8 (région centre-sud : Tan An, My Tho, Go Cong, Long Xuyen, Chau Doc, Sa Dec et Ben Tre) ; la région militaire 9 (région sud-ouest : Vinh Long, Tra Vinh, Can Tho, Soc Trang (plus une partie de la province de Bac Lieu), Rach Gia et Ca Mau (incluant une partie des provinces de Bac Lieu et Ha Tien) ; et la région militaire de Saigon-Gia Dinh.
(9) Documents complets des parties , op. cit ., p. 187
(10) Comité directeur du résumé de guerre (sous l'égide du Politburo) : La guerre révolutionnaire vietnamienne 1945-1975 - Victoire et leçons , Maison d'édition politique nationale, Hanoï, 2000, p. 173
(11) Robert S. McNamara : Retour sur le passé : La tragédie et les leçons du Vietnam , Maison d'édition politique nationale, Hanoï, 1995, p. 316
(12) Tran Nham : La bataille intellectuelle au sommet du renseignement vietnamien , Maison d'édition de théorie politique, Hanoï, 2005, p. 270
(13) Nguyen Phu Trong : « Héritier et promoteur de la tradition nationale et de l’idéologie diplomatique de Hô Chi Minh, déterminé à construire et à développer une politique étrangère et une diplomatie modernes et globales, imprégnées de l’identité du “bambou vietnamien” », https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/ke-thua-phat-huy-truyen-thong-dan-toc-tu-tuong-ngoai-giao-ho-chi-minh-quyet-tam-xay-dung-va-phat-trien-nen-doi-ngoai-ngoai-giao-toan-dien-hien-dai-man , consulté le 14 décembre 2023.
(14) Nguyen Phu Trong : « Héritier et promouvant les traditions nationales et l'idéologie diplomatique de Ho Chi Minh, déterminé à construire et à développer des affaires étrangères et une diplomatie complètes et modernes, imprégnées de l'identité du « bambou vietnamien » » , ibid.
Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/quoc-phong-an-ninh-oi-ngoai1/-/2018/869602/hiep-dinh-paris-mo-duong-thong-nhat-dat-nuoc-va-bai-hoc-cho-hoat-dong-ngoai-giao-cua-viet-nam-hien-nay.aspx






![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629724919_hq-5175-jpg.webp&w=3840&q=75)

![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Sénat de la République tchèque, Miloš Vystrčil](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F11%2F20%2F1763629737266_ndo_br_1-jpg.webp&w=3840&q=75)



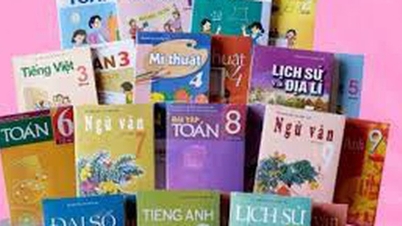









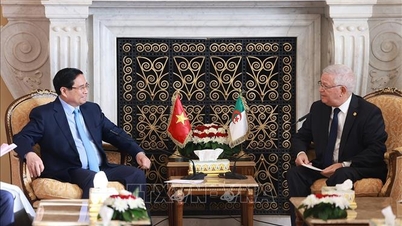



















































































Comment (0)