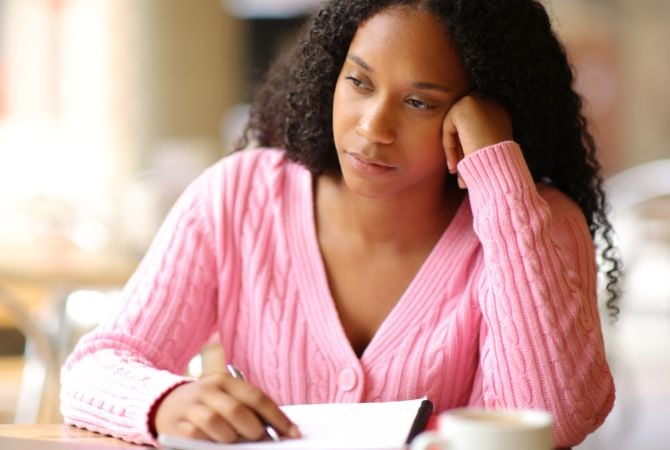
Photo d'illustration
Selon l'étude, le pourcentage d'adultes déclarant souffrir de troubles cognitifs (le CDC définit les « troubles cognitifs » comme de graves difficultés de concentration, de mémorisation ou de prise de décision dues à un problème physique, mental ou émotionnel) est passé de 5,3 % en 2013 à 7,4 % en 2023. Toutefois, la plus forte augmentation a été observée chez les jeunes adultes de moins de 40 ans, où le pourcentage de personnes déclarant de graves problèmes de mémoire, de concentration ou de prise de décision a presque doublé, passant de 5,1 % à 9,7 %.
En revanche, les chercheurs ont constaté que le taux chez les personnes âgées de 70 ans et plus avait même diminué, passant de 7,3 % à 6,6 %.
Inégalités en matière de santé cognitive
Les recherches montrent également que les troubles cognitifs n'affectent pas la communauté de manière uniforme. Les résultats indiquent que les déficiences cognitives sont étroitement liées à des facteurs économiques et sociaux.
En termes de revenus : les ménages dont le revenu est inférieur à 35 000 $ ont systématiquement enregistré les taux les plus élevés, passant de 8,8 % à 12,6 %. À l’inverse, les ménages dont le revenu dépasse 75 000 $ ont affiché des taux beaucoup plus faibles, n’augmentant que de 1,8 % à 3,9 %.
Éducation : La proportion d'adultes sans diplôme d'études secondaires est passée de 11,1 % à 14,3 %, tandis que la proportion de ceux qui possèdent un diplôme universitaire est passée de 2,1 % à 3,6 %.
Par origine ethnique : les adultes qui s’identifient comme Amérindiens, autochtones d’Alaska et hispaniques présentent les taux les plus élevés de déficience cognitive, tandis que les adultes asiatiques présentent les taux les plus faibles.
Le Dr de Havenon a fait remarquer que ces résultats suggèrent que « l’augmentation la plus marquée des problèmes de mémoire et de réflexion concerne les personnes déjà structurellement désavantagées ».
Malgré certaines limites, comme le fait que les données reposent sur des déclarations subjectives et que la collecte ait été effectuée par le biais d'enquêtes téléphoniques, les chercheurs soulignent néanmoins l'importance de cette tendance.
De Havenon a déclaré que cette augmentation pourrait refléter de réels changements dans la santé cérébrale. Il a appelé à des recherches plus approfondies afin de comprendre les raisons de cette hausse significative chez les jeunes, compte tenu des implications potentielles à long terme pour la santé de la population, la productivité et le système de santé.
Source : https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/bao-dong-nguy-co-khuet-tat-nhan-thuc-trong-gioi-tre-my/20250929112903806





![[Photo] Panorama de la finale des Community Action Awards 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763206932975_chi-7868-jpg.webp)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre des représentants d'enseignants exceptionnels](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763215934276_dsc-0578-jpg.webp)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le vice-président du groupe Luxshare-ICT (Chine)](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/15/1763211137119_a1-bnd-7809-8939-jpg.webp)















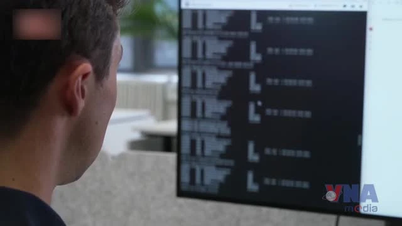


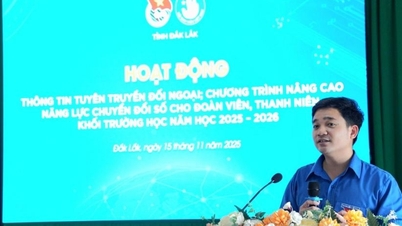

























































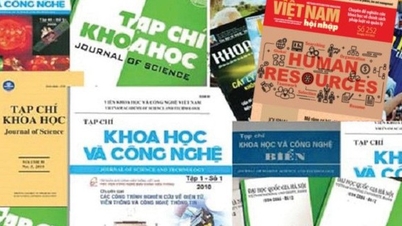
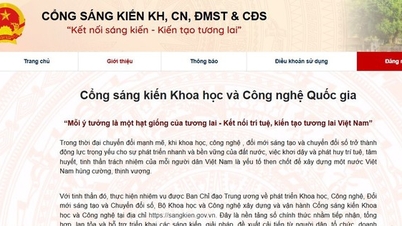























Comment (0)