Le monde a connu de nombreux changements profonds au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, avec une série de conflits armés de plus en plus complexes et imprévisibles.
 |
| Les conflits qui éclatent à travers le monde assombrissent de plus en plus le paysage sécuritaire international. (Image d'illustration. Source : AFP) |
Des guerres civiles interminables au Moyen-Orient et en Afrique aux conflits territoriaux intenses en Asie et en Europe de l'Est, le paysage sécuritaire mondial semble de plus en plus sombre. Les attentats terroristes du 11 septembre ont non seulement ébranlé les États-Unis, mais ont aussi inauguré une nouvelle ère où la frontière entre guerre traditionnelle et menaces sécuritaires non traditionnelles est plus floue que jamais.
Dans ce contexte, la révolution numérique et l'intelligence artificielle (IA) transforment rapidement et profondément les interactions humaines, y compris les méthodes de guerre et de conflit. Parallèlement, la course à l'influence entre les grandes puissances s'intensifie, menaçant de fragiliser des institutions multilatérales déjà précaires. Les conséquences de ces conflits ne se limitent pas à des tragédies immédiates ; elles laissent également des séquelles profondes, entravant les efforts de développement durable de l'humanité tout entière.
Une image complexe
Au cours des deux dernières décennies, le monde a connu plus de 100 conflits armés d'ampleur variable, inégalement répartis selon les régions. L'Afrique est devenue le principal foyer de tensions avec près de 50 conflits, soit environ 40 % du total. Vient ensuite le Moyen-Orient avec une trentaine de conflits, tandis que d'autres régions comme l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est ont connu une forte instabilité.
Les conflits se concentrent principalement dans les pays en développement. La guerre civile au Soudan, qui dure depuis 2003, a engendré l'une des plus graves crises humanitaires au monde, forçant des millions de personnes à fuir leurs foyers. Au Moyen-Orient, la guerre civile en Syrie, qui a débuté en 2011, a entraîné l'intervention de nombreuses puissances, provoquant un exode de près de 5 millions de réfugiés et bouleversant le paysage géopolitique de la région.
Quant aux causes, les luttes de pouvoir politique (environ 25 % des cas) et les différends territoriaux (près de 20 %) demeurent les deux principales sources de conflit. Cela est particulièrement visible dans les tensions russo-ukrainiennes, où les questions de sécurité nationale et les conflits territoriaux jouent un rôle central. Par ailleurs, le terrorisme représente environ 15 % des cas, comme en témoigne la lutte contre le groupe terroriste État islamique en Irak et en Syrie.
En termes d'ampleur et d'intensité, près de la moitié des conflits ont entraîné la mort de plus de 1 000 personnes. Certains conflits, comme la guerre au Darfour, la guerre civile irakienne et le conflit russo-ukrainien, ont notamment fait plus de 100 000 victimes. Cela témoigne d'une tendance à l'intensification et à la destruction croissantes des conflits, en particulier sur le plan humanitaire.
En termes de durée, la tendance à l'allongement des conflits s'accentue, plus d'un tiers restant non résolus, certains durant depuis plus de dix ans. Seuls 30 % environ des conflits se sont terminés en moins d'un an, ce qui témoigne de la complexité croissante de la situation actuelle et de l'inefficacité des mécanismes internationaux de résolution des conflits.
Enfin, le rôle de la technologie est de plus en plus prépondérant. La prédominance du numérique et des réseaux sociaux a créé un environnement propice à la guerre de l'information, favorisant la diffusion des idéologies extrémistes et devenant un outil puissant pour les groupes terroristes afin de se propager et de recruter des membres. Les cyberattaques se multiplient, comme en témoigne le conflit russo-ukrainien, ouvrant un nouveau front dans la guerre moderne. Globalement, l'évolution des conflits armés au cours des deux dernières décennies présente un tableau complexe, marqué par une augmentation du nombre, de l'intensité et de la durée des conflits, reflétant une profonde mutation de la nature de la guerre au XXIe siècle.
Conséquences généralisées
Les conflits armés des deux dernières décennies ont eu des conséquences considérables qui dépassent largement le cadre des pays et régions directement concernés. Des crises humanitaires à l'instabilité politique mondiale, leurs répercussions redessinent le paysage mondial de manière complexe.
Environ un quart de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones touchées, et le nombre de réfugiés et de personnes déplacées internes a dépassé les 100 millions en 2022 – un chiffre record depuis la Seconde Guerre mondiale. Derrière ces chiffres se cachent d'innombrables tragédies personnelles et familiales, ainsi que des traumatismes physiques et psychologiques durables.
Les conflits engendrent des conséquences économiques dévastatrices. Les infrastructures, notamment essentielles, sont détruites, les ressources s'épuisent et la croissance économique stagne – une réalité courante dans de nombreux pays. Selon la Banque mondiale, les pays touchés affichent des taux de pauvreté supérieurs de 20 points de pourcentage à ceux des pays non touchés par le conflit. Cette situation affecte non seulement les pays concernés, mais entrave également les efforts collectifs de la communauté internationale pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Sur le plan politique international, les conflits ont creusé le fossé entre les grandes puissances, affaiblissant ainsi l'efficacité des mécanismes multilatéraux. Le risque de prolifération nucléaire est généralisé et hors de contrôle. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est retrouvé à plusieurs reprises dans l'impasse lorsqu'il a dû adopter des résolutions importantes, comme dans le cas du conflit syrien ou, plus récemment, en Ukraine. De ce fait, le prestige des organisations internationales s'en est trouvé amoindri et la capacité de la communauté internationale à prévenir et à résoudre les conflits s'en est trouvée considérablement réduite.
Les conflits armés créent également un environnement propice au développement de menaces non traditionnelles à la sécurité. L'instabilité prolongée offre un terreau fertile aux organisations terroristes et aux criminels transnationaux, tels que l'État islamique en Irak et en Syrie. De plus, les conflits exacerbent des problèmes mondiaux comme le changement climatique, l'insécurité alimentaire et les maladies.
La tendance à la sur-sécurisation et à l'augmentation des dépenses militaires mondiales détourne des ressources considérables des objectifs de développement. Cela soulève des questions majeures quant à la capacité de l'humanité à relever des défis communs tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.
L’impact des conflits armés des deux dernières décennies a été considérable et profond, dépassant largement le cadre géographique et temporel de ces conflits spécifiques. Des crises humanitaires à l’instabilité politique mondiale, des récessions économiques aux nouveaux défis sécuritaires, les conséquences des conflits constituent d’immenses obstacles à la paix, à la sécurité et au développement durable pour toute l’humanité.
Nouveaux problèmes
La tendance aux conflits armés au cours des deux dernières décennies a mis en lumière plusieurs questions importantes.
Premièrement, la complexité et la diversité des causes de conflits exigent une approche plus proactive et globale, plaçant la sécurité humaine au cœur de la sécurité nationale. Si les menaces traditionnelles persistent, des facteurs tels que les conflits liés aux ressources, les inégalités économiques et le changement climatique deviennent des sources croissantes d'instabilité. Ceci contraint les nations à élargir la notion de sécurité nationale au-delà des seules sphères militaires pour y inclure les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Deuxièmement, la tendance à l’enlisement et à la persistance des conflits souligne l’importance de la prévention et du renforcement de la confiance. Au lieu de se concentrer uniquement sur le renforcement de leurs capacités militaires, les pays devraient privilégier la diplomatie préventive, promouvoir le dialogue et mettre en place des mécanismes efficaces de gestion des crises aux niveaux régional et mondial.
Troisièmement, le rôle de plus en plus important des technologies dans les conflits modernes rend urgent le renforcement des capacités en matière de cybersécurité et de technologies militaires de pointe. Les États devraient envisager d'investir dans la recherche et le développement dans ces domaines, tout en renforçant la coopération internationale en matière de cybersécurité et en encadrant le développement et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine militaire.
Enfin, la baisse d’efficacité des mécanismes multilatéraux de résolution des conflits exige de la communauté internationale qu’elle adopte une nouvelle approche de la gouvernance mondiale. Tout en maintenant son attachement au multilatéralisme, les pays devraient se montrer plus proactifs dans la réforme des organisations internationales existantes et la mise en place de mécanismes de coopération flexibles, axés sur des enjeux spécifiques tels que la sécurité maritime, la gestion des ressources transfrontalières ou la lutte contre le changement climatique.
Source : https://baoquocte.vn/nhung-gam-mau-xung-dot-vu-trang-trong-20-nam-qua-284304.html








































![[Photo] Aider d'urgence les personnes à trouver rapidement un logement et à stabiliser leur vie.](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F09%2F1765248230297_c-jpg.webp&w=3840&q=75)













































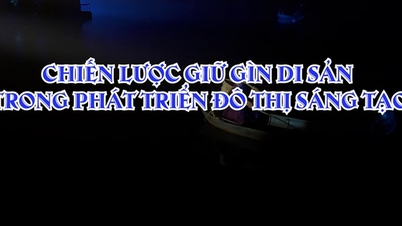



























Comment (0)