Une identité instable au cœur du tourbillon de l'intégration
La « tempête 4.0 » a non seulement balayé les distances géographiques, mais aussi les valeurs culturelles autochtones. Expressions hybrides, cultes étrangers et imitation aveugle des tendances en ligne gagnent progressivement en popularité parmi les jeunes des hautes terres. Ils se laissent facilement entraîner dans les modes de vie virtuelles, dans une culture « plate » sans sélection, où toute frontière identitaire s'efface.
Le plus flagrant est l'hybridation culturelle sur les réseaux sociaux. Les jeunes des Highlands adoptent les tendances mondiales à une vitesse vertigineuse, mais manquent de choix. De nombreuses vidéos sur TikTok, Facebook et YouTube utilisent des images de costumes traditionnels, mais ceux-ci sont trop transformés, devenant des accessoires de la vie virtuelle plutôt que des symboles culturels. On observe de nombreux cas de jeunes portant des costumes stylisés offensants, dansant dans des lieux sacrés, faisant du patrimoine un outil pour attirer les vues et les likes.
Un exemple controversé est celui des touristes en costumes exotiques prenant des photos au bord de la rivière Nho Que (Tuyen Quang), une terre associée à la vie spirituelle et aux croyances du peuple Mong. Ce geste apparemment anodin touche à la fierté culturelle, car ce lieu est non seulement un lieu pittoresque, mais aussi un espace identitaire. Lorsque le tourisme devient une « mode », introduire arbitrairement des éléments exotiques dans les symboles culturels nationaux est le moyen le plus rapide d'« éroder » l'identité.
 |
| Le groupe ethnique Thuy du village de Thuong Minh, commune de Minh Quang, ne conserve actuellement que 3 ensembles de vêtements traditionnels. |
Non seulement l'originalité disparaît, mais la jeune génération perd aussi la capacité d'identifier sa propre culture. La langue maternelle est remplacée par un « langage internet » hybride : « Xoa », « khia », « mlem », « viral », « check-in »… Tandis que les enseignements des anciens du village sont éclipsés par des idoles virtuelles, les appels entre amis cèdent peu à peu la place à des vidéos de mauvais goût qui se répandent sur internet.
Au marché de Sa Phin, où autrefois les sons des flûtes de pan et des flûtes résonnaient comme des appels entre amis, la musique électronique étouffe désormais les appels des vendeurs. Les exquises robes en brocart tissées à la main ont cédé la place à des vêtements confectionnés bon marché. Mong Sung Thi Sinh, 16 ans, rit de bon cœur au téléphone : « Aujourd'hui, acheter des vêtements confectionnés est très pratique, bon marché et beau, et regarder des vidéos sur son téléphone est amusant. » Des mots innocents, mais déchirants, à l'heure où les valeurs culturelles millénaires sont submergées par le monde virtuel chez la jeune génération.
Mme Ly Gia Tan, de l'ethnie Nung, commune de Ho Thau, a déclaré : « Les jeunes d'aujourd'hui adorent surfer sur TikTok et Facebook, à la recherche de standards communs de beauté et de style. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes à comparer et à penser que leur culture ethnique est « rustique » et dépassée. Nombre d'entre eux abandonnent leurs costumes traditionnels pour porter des jeans et des t-shirts, parlent le kinh au lieu de leur langue maternelle, chantent de la musique commerciale au lieu de leurs propres chansons folkloriques. Je suis très triste ! »
La culture traditionnelle véhicule des valeurs humanistes telles que la piété filiale, la foi et la cohésion communautaire. Cependant, faute de connaissances culturelles et de moyens pour discerner le vrai du faux, les réseaux sociaux contribuent également à la diffusion de mauvaises coutumes, transformant les valeurs en fardeaux, les rituels en formalités et le patrimoine en outils de communication.
En 2023, M. VMG, de la commune de Meo Vac, a organisé les funérailles de sa mère selon les anciennes coutumes : trois jours de funérailles, abattage de nombreux animaux et absence de cercueil. Après les funérailles, il a accumulé une lourde dette et sa famille a sombré dans la pauvreté. Sur les réseaux sociaux, les images de ces funérailles somptueuses ont été partagées et commentées, ce qui a involontairement présenté cette coutume comme une manifestation de piété filiale ou de « respect des anciennes coutumes », alors qu'elle est en réalité rétrograde et coûteuse.
Les réseaux sociaux ne sont pas seulement un lieu de diffusion de tendances déviantes, ils deviennent aussi un outil pour les réseaux de fraude, le trafic d'êtres humains, la propagation d'hérésies et d'idées fausses. Des arnaques telles que « travail facile, salaire élevé », « mariage riche » ou « gagner de l'argent grâce à TikTok » ont entraîné de nombreux habitants des hautes terres dans des pièges. Récemment, Thao Mi Sinh (commune de Son Vi, Tuyen Quang , né en 1995) a été arrêté pour avoir détourné plus de 556 millions de VND de 11 personnes en créant un compte sur les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. C'est une démonstration flagrante du côté obscur de la technologie, en cas de manque de compréhension et de vigilance. Un simple clic virtuel peut avoir des conséquences bien réelles : perte d'argent, perte de confiance et atteinte à la confiance de la communauté.
Le risque d'érosion identitaire ne provient pas seulement du tourbillon technologique ou de l'adoption des modes de vie modernes, mais aussi de la mondialisation et de l'influence insidieuse de forces hostiles. Plus inquiétant encore, ces forces ont exploité les réseaux sociaux pour modifier pacifiquement les sphères idéologiques et culturelles.
De nombreuses sectes et organisations réactionnaires se faisant passer pour des religions ont infiltré les zones frontalières, propageant la superstition et divisant les croyances de la population. Un exemple typique est le culte « San su khe to », qui a autrefois ensorcelé plus de 1 200 foyers comptant près de 6 000 personnes sur le plateau rocheux de Dong Van, plongeant de nombreux villages dans le chaos. On peut également citer le phénomène du culte « Duong Van Minh », qui, au cours des trois dernières décennies, a eu de graves conséquences sur la vie spirituelle d'une partie du peuple Mong de Tuyen Quang.
Sous couvert de « nouvelles croyances », Duong Van Minh a propagé une idéologie séparatiste, escroqué de l'argent grâce au stratagème du « Fonds d'or » et même comploté pour établir un « État Mong ». Bien que cette organisation hérétique ait été combattue, des traces de cette idéologie extrémiste subsistent, telles des graines toxiques, couvant dans le cyberespace. Des éléments clés se sont alliés aux organisations réactionnaires Viet Tan et Dan Lam Bao, ont créé des pages de fans et des chaînes YouTube pour déformer, attiser les divisions ethniques et semer la confusion au sein de la communauté Mong.
Ces manifestations ne sont pas seulement le reflet d'une « faiblesse identitaire », mais aussi un avertissement quant au fossé entre les connaissances et l'identité culturelle. Lorsque la jeune génération est de plus en plus absorbée par les réseaux sociaux, ignorant ses racines ; lorsque les valeurs matérielles prennent le pas sur les valeurs spirituelles, la confiance et l'identité sont facilement ébranlées – et c'est cette faiblesse que les forces hostiles exploitent pour attaquer.
Le « gardien du feu » et la peur des braises
Chaque artisan est une flamme vivante qui préserve l’âme de la nation. Mais lorsque cette flamme s’éteint peu à peu, lorsque la langue maternelle disparaît des voix des enfants, l’inquiétude ne porte pas seulement sur la perte des coutumes ou de la langue, mais aussi sur le rétrécissement du « territoire mou » – le cœur même qui constitue la résilience culturelle de la frontière.
Dans les communes frontalières, où les Hmong représentent plus de 80 % de la population, le son de la flûte Hmong est l'âme, la source éternelle. Pourtant, la génération qui sait encore fabriquer et jouer de cet instrument se compte sur les doigts d'une main. Dans une petite maison nichée à flanc de coteau rocheux à Dong Van, l'artisan Ly Xin Cau interrogeait ses petits-enfants, absorbés par leurs téléphones :
« Après ma mort, saurez-vous, mes enfants, jouer de la flûte Mong ? »
Le neveu innocent a répondu : « Je vais te filmer et poster la vidéo en ligne, peut-être qu'elle aura un million de vues. »
M. Cau garda le silence. La jeune génération croit que les réseaux sociaux peuvent « sauver » la culture, mais il comprend parfaitement que la culture ne peut se limiter aux vidéos. Elle a besoin de s'incarner dans la réalité, de la fierté et de l'amour que les jeunes portent à leurs racines.
Dans le village de Ma Che, commune frontalière de Sa Phin où cohabitent les Mong et les Co, le tissage était autrefois considéré comme un véritable musée vivant. Cependant, selon le secrétaire de la cellule du Parti de Sinh Mi Minh, il ne reste aujourd'hui que huit familles qui perpétuent cette tradition. Chaque paire de mains qui cesse de tisser est un fil de mémoire rompu, une part du patrimoine qui se perd silencieusement dans le tourbillon de la vie quotidienne.
La crainte du déclin ne se limite pas à un seul village. Début 2023, la nouvelle du décès de l'artisan Luong Long Van, un Tay du quartier d'An Tuong (Tuyen Quang), à l'âge de 95 ans, a profondément marqué les esprits. Il était l'un des rares à maîtriser encore l'écriture Tay Nom, véritable « clé culturelle » donnant accès à un trésor de savoir populaire. Toute sa vie, il a compilé, traduit et enseigné discrètement plus d'une centaine d'ouvrages anciens, ainsi que des dizaines de recueils de prières, d'admonitions et de recettes médicinales. Des œuvres telles que « Quelques anciens palais Then en écriture Nom-Tay » ou « Van Quan du village de Tuyen Quang » témoignent d'une vie consacrée à la culture. La petite maison, jadis animée par les voix des élèves, est désormais aussi silencieuse qu'un « trésor vivant » qui vient de fermer ses portes.
Les Dao et les Tay conservaient jadis les livres de prières et les manuels scolaires comme des trésors, transmettant ainsi l'esprit de leur clan de génération en génération. Mais aujourd'hui, de nombreuses familles ont oublié comment lire et recopier ; ce patrimoine, plié et relégué au fond d'un placard, est voué à prendre la poussière. Pour les Lo Lo, qui ne possèdent pas d'écriture, ce danger est encore plus réel. Lorsque les anciens – véritables « bibliothèques vivantes » du village – disparaissent peu à peu, ce trésor de savoir oral populaire s'évanouit lui aussi.
Lo Si Pao, artiste de renom de la commune de Meo Vac, s'inquiète : « Aujourd'hui, les jeunes ne parlent plus que la langue commune, rares sont ceux qui utilisent leur langue maternelle. Ils ont peur de parler et finissent par oublier, jusqu'à perdre leur propre langue. » Un constat simple, mais qui porte en lui la douleur de toute une culture au bord de l'oubli.
Non seulement la langue, mais aussi les vêtements et le mode de vie – symboles de l'identité culturelle – évoluent rapidement. Dans de nombreux villages, les couleurs indigo et lin, autrefois emblématiques des Giay et des Mong, disparaissent également. L'artisan Vi Dau Min, un Giay de la commune de Tat Nga, a déclaré avec tristesse : « Le vêtement n'est pas seulement un vêtement, c'est aussi l'identité du peuple Giay. Aujourd'hui, les enfants n'aiment que les vêtements modernes. Lorsqu'on leur demande de porter des tenues traditionnelles, ils rient en disant : "Ce n'est que pour les fêtes". Je crains qu'à l'avenir, les anciennes coutumes ne disparaissent avec les personnes âgées. »
Manque d'espace pour que la culture « respire »
Si l'identité est l'âme d'une nation, alors l'espace culturel est le souffle de cette âme. Dans de nombreux villages des hauts plateaux, ce souffle s'éteint, non par manque de conscience, mais par manque d'espace pour que la culture puisse s'épanouir.
La faiblesse des institutions culturelles, la faiblesse des infrastructures, la lenteur des mécanismes et la difficulté de la vie quotidienne ont entraîné la disparition de nombreuses activités communautaires. Dans de nombreux endroits, les fêtes traditionnelles ne se limitent plus qu'à des représentations, voire à des mises en scène et à une commercialisation, perdant ainsi leur âme. Parallèlement, les nouveaux espaces culturels – tourisme et urbanisation – manquent de profondeur pour nourrir le cœur national. La culture est « suspendue » entre deux brèches : le passé est oublié, et le présent n'a plus de place pour se nourrir.
Dans les communes frontalières comme Son Vi, Bach Dich, Dong Van, etc., les maisons en terre dorée, symboles de l'architecture mong, sont remplacées par des maisons en béton de style transfrontalier. L'artiste populaire Mua Mi Sinh, du village de Sang Pa B, commune de Meo Vac, s'inquiète : « Améliorer l'habitat est une bonne chose, mais la disparition de l'architecture traditionnelle entraîne la disparition de l'espace culturel. La maison en terre n'est pas seulement un lieu de vie, mais aussi la cristallisation des mains, des esprits et de la philosophie de vie en harmonie avec les montagnes et les forêts. Lorsque la maison perd son âme autochtone, le village perd également sa dimension culturelle. »
Dans le village de Lung Lan, commune frontalière de Son Vi, vivent ensemble 121 foyers appartenant à neuf groupes ethniques, dont 40 Xuong, soit près de 200 personnes. Mme Hoang Thi Tuong, 63 ans, a déclaré : « Sur notre carte d'identité, nous sommes enregistrés comme “groupe ethnique Xuong (Nung)”, ce qui signifie que les Xuong ne sont qu'une branche du peuple Nung. Bien qu'ils aient leur propre langue, leurs coutumes et leurs costumes, faute de mécanismes de reconnaissance et d'espace vital, la culture Xuong s'assimile progressivement et doit s'intégrer aux autres groupes ethniques. »
Non seulement les Xuong, mais aussi de nombreuses autres petites communautés disparaissent peu à peu du paysage culturel ethnique. Dans le village de Thuong Minh, commune de Minh Quang, l'ethnie Thuy – la seule encore présente au Vietnam – ne compte plus que 21 foyers et moins de 100 personnes. M. Mung Van Khao, 81 ans, véritable « trésor vivant » des Thuy, déplore : « Aujourd'hui, nos cartes d'identité portent toutes le nom de l'ethnie Pa Then. Les générations futures ne sauront plus qu'elles sont Thuy. Seuls les anciens se souviennent encore de l'ancienne langue, et il ne reste plus que trois costumes traditionnels dans tout le village. »
Ces histoires montrent que lorsque la culture n'a pas d'espace pour « respirer », le patrimoine ne peut pas survivre, quelles que soient les qualités des politiques mises en place.
En 2016, le Conseil populaire de la province de Ha Giang (anciennement) a promulgué la résolution n° 35, censée insuffler un nouvel élan au tourisme communautaire et créer des moyens de subsistance durables liés à la culture locale. Plus de 24,6 milliards de dongs ont été investis pour soutenir 285 organisations et particuliers dans l'hébergement et le développement du tourisme communautaire – un modèle qui devait transformer la culture en levier de développement. Cependant, après seulement trois ans, la résolution n° 35 a dû être abandonnée. Faute de politiques et de capitaux adéquats, mais sans planification, mécanismes opérationnels et acteurs culturels de premier plan, ces modèles restent superficiels et ne parviennent pas à devenir de véritables piliers identitaires.
L'histoire du peuple Pa Then en est un autre exemple. Ce groupe ethnique vit dans les communes de Tan Trinh, Tan Quang, Minh Quang et Tri Phu, réputées pour leur riche patrimoine de danses du feu, de pilonnage, de prières pour les récoltes et de tissage – un héritage à la fois sacré et unique. Mais le nombre d'artisans possédant ce savoir et capables de le transmettre diminue.
En 2022, le Projet 6 du Programme national de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques a été mis en œuvre, visant à restaurer l'identité touristique. Ce projet comprend 19 volets spécifiques. Entre 2022 et 2025, grâce à un investissement total de plus de 224 milliards de dôngs, sept festivals ont été préservés, trois cultures menacées de disparition ont été restaurées et 19 établissements d'enseignement ont été ouverts.
Mais ce chiffre reste insuffisant par rapport à la réalité : selon le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Tuyen Quang, près de 30 % des festivals des hautes terres risquent de disparaître au cours des cinq dernières années seulement. De nombreuses institutions culturelles sont dégradées, les maisons culturelles des villages sont abandonnées et les espaces de vie communautaires se rétrécissent, rendant impossible la pleine reproduction des rituels et des festivals. Les gens n'ont plus d'endroit pour chanter le then, danser le sluong, exécuter le khen ou battre les tambours des festivals. Pour que la culture vive, elle doit d'abord trouver un lieu où « respirer ».
Préserver l'espace nécessaire à l'épanouissement de la culture ne relève donc pas seulement de la préservation du patrimoine, mais aussi du maintien des fondements spirituels et de la protection naturelle que constitue la sécurité des frontières. La culture ne vit pleinement que lorsque les populations en sont les acteurs, la pratiquent et en sont fières. Il est indispensable de faire renaître dans les villages les maisons culturelles illuminées, les lieux de fête animés par les chants du khen, les cours de langue et la renaissance de l'artisanat traditionnel. C'est seulement ainsi que la culture pourra véritablement s'épanouir et que la frontière pourra être durable.
(À suivre)
Interprété par : Mai Thong, Chuc Huyen, Thu Phuong, Bien Luan, Giang Lam, Tran Ke
Source : https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202510/vanh-dai-van-hoa-soi-sang-bien-cuong-ky-2-nguy-co-xoi-mon-cot-moc-van-hoa-a483a3a/


![[Photo] Les projets de documents du 14e Congrès du Parti parviennent aux bureaux de poste culturels des communes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761642182616_du-thao-tai-tinh-hung-yen-4070-5235-jpg.webp)
![[Photo] Inondation sur le côté droit de la porte, entrée de la citadelle de Hué](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761660788143_ndo_br_gen-h-z7165069467254-74c71c36d0cb396744b678cec80552f0-2-jpg.webp)

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a reçu une délégation du Parti social-démocrate d'Allemagne](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761652150406_ndo_br_cover-3345-jpg.webp)


































![[Photo] Le président Luong Cuong assiste au 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces armées de la région militaire 3](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/28/1761635584312_ndo_br_1-jpg.webp)










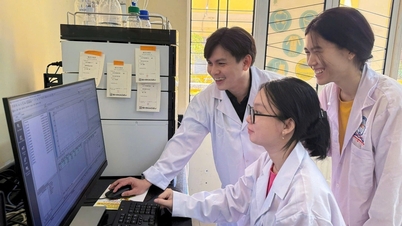












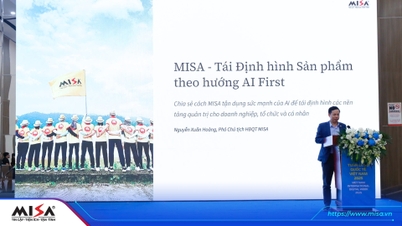


















































Comment (0)