Le président américain Donald Trump a annoncé une taxe supplémentaire de 10 % sur les marchandises importées de Chine, portant le taux d'imposition total à 20 %. Ces droits de douane élevés risquent d'entraîner une hausse des prix aux États-Unis et de pénaliser les consommateurs américains.
Cette mesure est perçue comme faisant partie de la stratégie plus large de Donald Trump visant à contenir la croissance de Pékin, à regagner sa position et à affirmer le rôle de l'Amérique en tant que première superpuissance.
Mesures visant à contenir la Chine
Depuis son entrée en fonction officielle pour son second mandat le 20 janvier, le président Donald Trump n'a pas perdu de temps pour relancer la « guerre commerciale » qu'il avait lancée lors de son premier mandat.
Le 27 février, M. Trump a annoncé qu'il imposerait une taxe supplémentaire de 10 % sur les marchandises importées de Chine après avoir imposé 10 % début février, portant ainsi la taxe totale sur ce pays à 20 %, à compter du 4 mars.
Auparavant, M. Trump avait menacé d'imposer une taxe de 25 % sur les marchandises provenant de l'Union européenne (UE), du Mexique et du Canada, les accusant de « profiter » des États-Unis dans des relations commerciales inéquitables.
Fin janvier 2025, M. Trump a également choqué le monde en menaçant d'imposer une taxe de 100 % aux pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et nouveaux membres comme l'Iran et l'Égypte) s'ils osaient abandonner le dollar américain ou développer une monnaie alternative.
M. Trump a également déclaré sans ambages : « Dites adieu aux États-Unis » si ces pays osent défier le dollar, affirmant ainsi sa détermination à protéger le rôle du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.
Un autre aspect marquant de la stratégie de Trump réside dans ses efforts pour contrôler les zones et les ressources géostratégiques. Il a maintes fois évoqué son intention de « reprendre le contrôle du canal de Panama », lequel a signé en 2017 un mémorandum d'entente avec la Chine intitulé « Coopération sur la Ceinture économique de la Route de la Soie (SREB) et la Route maritime de la Soie du XXIe siècle (MSR) ».
Cet accord permet à Pékin d'accroître son influence sur le canal de Panama, voie maritime essentielle reliant les océans Atlantique et Pacifique , par laquelle transitent plus de 60 % des marchandises destinées aux États-Unis. M. Trump y voit une menace directe pour le commerce et la sécurité nationale des États-Unis et menace de prendre des « mesures fermes » si le Panama ne modifie pas sa politique.
Début février, le Panama a envoyé une note diplomatique annonçant son retrait de l'initiative chinoise « Ceinture et Route ».
Dès ses premières semaines à la Maison-Blanche, Trump a accéléré le processus d'achat du Groenland au Danemark, une région riche en ressources minérales et stratégiquement située dans l'Arctique. Il souhaite également conclure un accord de coopération avec l'Ukraine sur les ressources minérales et, éventuellement, avec la Russie afin de réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine pour les terres rares, matériaux essentiels aux hautes technologies et à la défense. Ces initiatives pourraient permettre de briser le monopole de Pékin sur les ressources et de renforcer la position des États-Unis dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Une stratégie de confinement radicale mais risquée
Au cours des deux dernières décennies, la Chine a connu une ascension fulgurante, passant d'une économie en développement à une superpuissance économique et militaire , remettant directement en cause l'hégémonie des États-Unis. Avec un PIB en forte croissance depuis le début du XXIe siècle, la Chine représente aujourd'hui environ 19,5 % du PIB mondial, se classant deuxième derrière les États-Unis, et devrait atteindre 22,1 % d'ici 2030.
L’initiative « la Ceinture et la Route » a permis à Pékin d’étendre son influence géopolitique de l’Asie à l’Afrique et à l’Europe. La Chine contrôle notamment environ 80 % de l’approvisionnement mondial en terres rares, ce qui rend les États-Unis et leurs alliés occidentaux dépendants.
L'interdépendance entre la Russie et la Chine s'est accrue suite aux sanctions imposées par l'Occident à Moscou après le conflit ukrainien début 2022. La Chine est devenue un partenaire économique essentiel pour la Russie, lui fournissant pétrole et gaz ainsi que des biens technologiques, tandis que la Russie soutient la Chine grâce à ses abondantes ressources. Cette relation complexifie la situation géopolitique, obligeant les États-Unis à composer simultanément avec ces deux puissances.
Parallèlement, l’UE, alliée transatlantique traditionnelle des États-Unis, s’affaiblit. Le bloc est confronté à une crise énergétique suite à l’abandon des approvisionnements en gaz russe, à des divisions internes sur les politiques économiques et de défense, et à la pression des partis populistes anti-américains. La dépendance commerciale de l’UE vis-à-vis de la Chine, avec des échanges bilatéraux qui devraient atteindre 760 milliards de dollars d’ici 2024, rend l’alliance encore plus réticente à soutenir une position américaine ferme contre Pékin.
En un peu plus d'un mois à la Maison-Blanche, M. Trump a lancé une série de mesures inattendues qui, bien qu'apparemment imprévisibles, semblent cohérentes, fondées sur le principe de « l'Amérique d'abord ». Homme d'affaires avant de devenir président, Trump a appliqué une mentalité commerciale à la politique internationale : utilisant les droits de douane comme moyen de pression pour contraindre d'autres pays à faire des concessions.
Auparavant, M. Trump avait menacé d'imposer une taxe pouvant atteindre 60 % sur les produits chinois. La menace d'une taxe de 100 % sur les BRICS est perçue comme une mesure audacieuse visant à protéger le dollar américain, pilier de la puissance financière des États-Unis.
Il est clair que si les BRICS parviennent à créer une monnaie alternative, l'influence des États-Unis sur le marché mondial en sera fortement compromise. M. Trump l'a bien compris et est prêt à tout mettre en œuvre pour empêcher un tel scénario. De même, les pressions exercées sur le Panama, l'Union européenne, le Mexique et le Canada montrent qu'il n'hésite pas à s'opposer aussi bien à ses alliés qu'à ses adversaires pour défendre les intérêts américains.
La recherche d'une coopération avec la Russie et l'Ukraine en matière de ressources témoigne du pragmatisme de Trump. Bien que la Russie soit un rival géopolitique, il est disposé à négocier pour réduire la dépendance à l'égard de la Chine.
En revanche, la stratégie de Trump comporte également des risques importants. Elle pourrait certes engendrer des succès à court terme : ralentir la croissance chinoise, contraindre les alliés à revenir dans l’orbite américaine et protéger le dollar.
Mais à moyen et long terme, des droits de douane élevés pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, faire flamber les prix aux États-Unis et pénaliser les consommateurs américains. De plus, l'exacerbation des tensions avec l'UE et des pays voisins comme le Mexique et le Canada pourrait fragiliser l'alliance transatlantique, offrant ainsi à la Chine l'opportunité d'étendre son influence.
Le grand jeu d'échecs États-Unis-Russie-Chine qui se profile pourrait bien être imprévisible. Quoi qu'il en soit, la stratégie de Trump a replacé l'Amérique au centre de la scène internationale. Par son style pragmatique et décisif, il oblige le monde à réévaluer la puissance américaine, rendant impossible la sous-estimation de ce « géant ». Après les droits de douane, la prochaine confrontation s'annonce comme une bataille acharnée autour des technologies, qui illustrera sans aucun doute l'ambition de Trump de redonner à l'Amérique le prestige qu'il s'était promis.

Source : https://vietnamnet.vn/trump-ap-thue-20-len-trung-quoc-ban-co-lon-con-kho-luong-2375934.html



![[Photo] Défilé pour célébrer le 50e anniversaire de la fête nationale du Laos](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764691918289_ndo_br_0-jpg.webp&w=3840&q=75)


![[Photo] Vénération de la statue de Tuyet Son - un trésor vieux de près de 400 ans à la pagode Keo](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F02%2F1764679323086_ndo_br_tempimageomw0hi-4884-jpg.webp&w=3840&q=75)




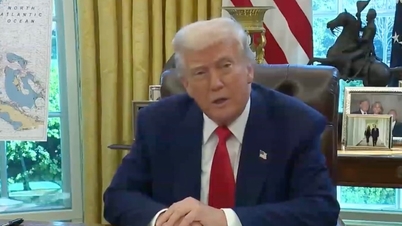





















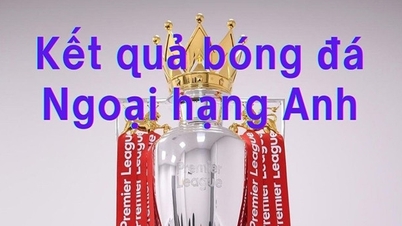









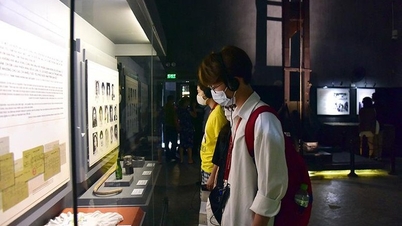


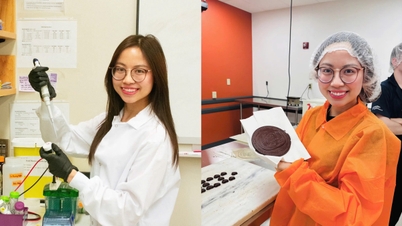


















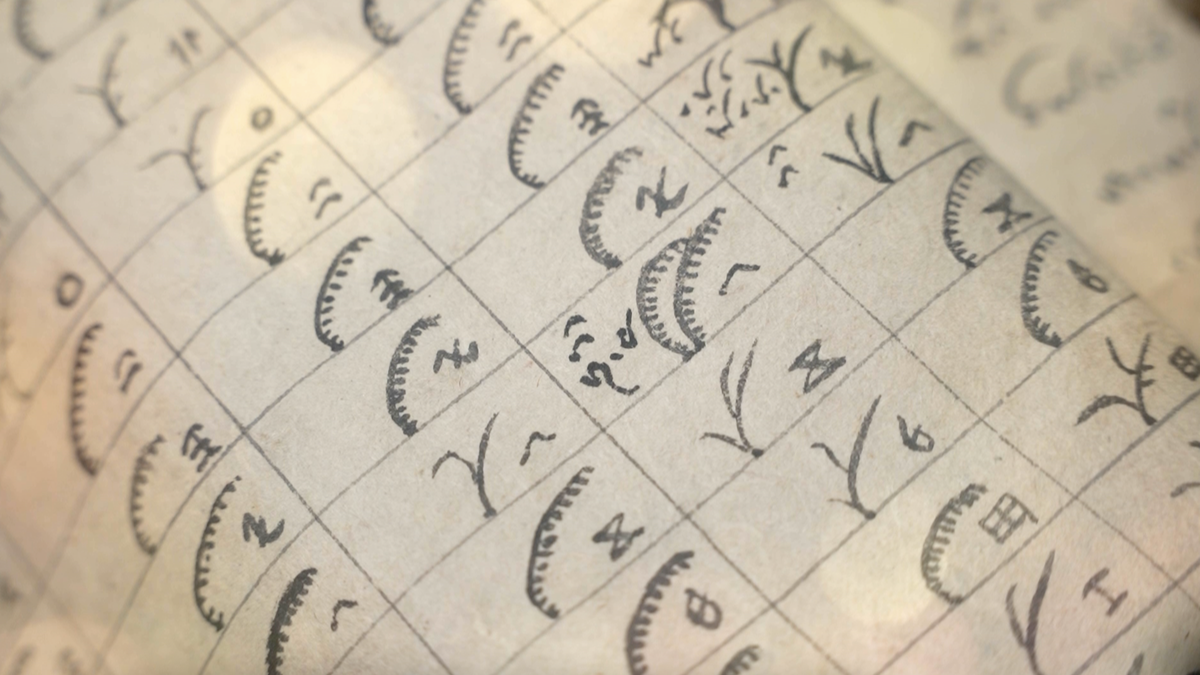





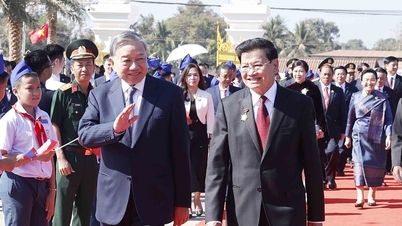







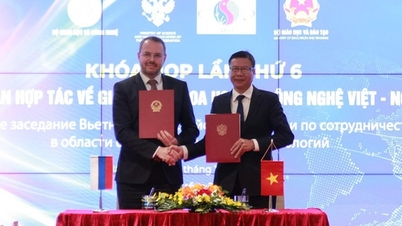













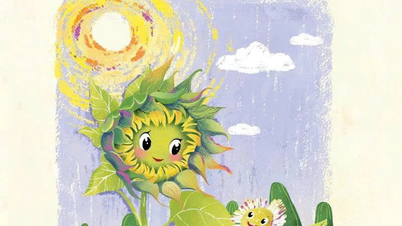















Comment (0)